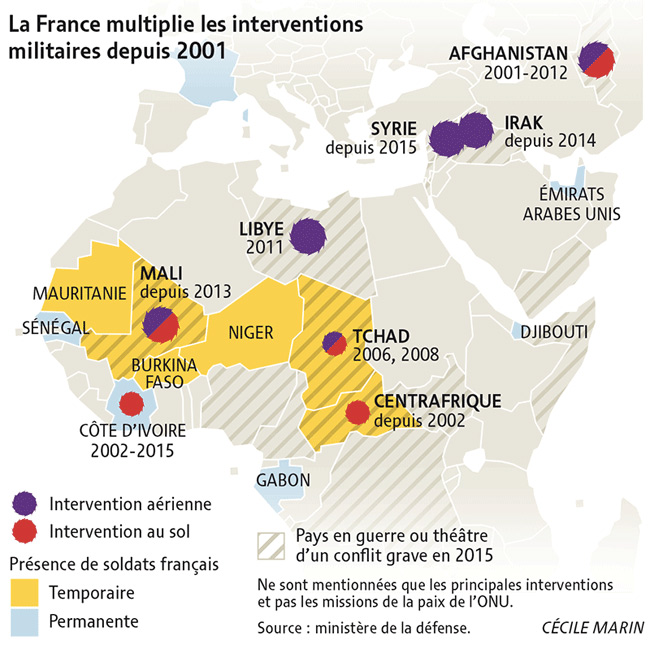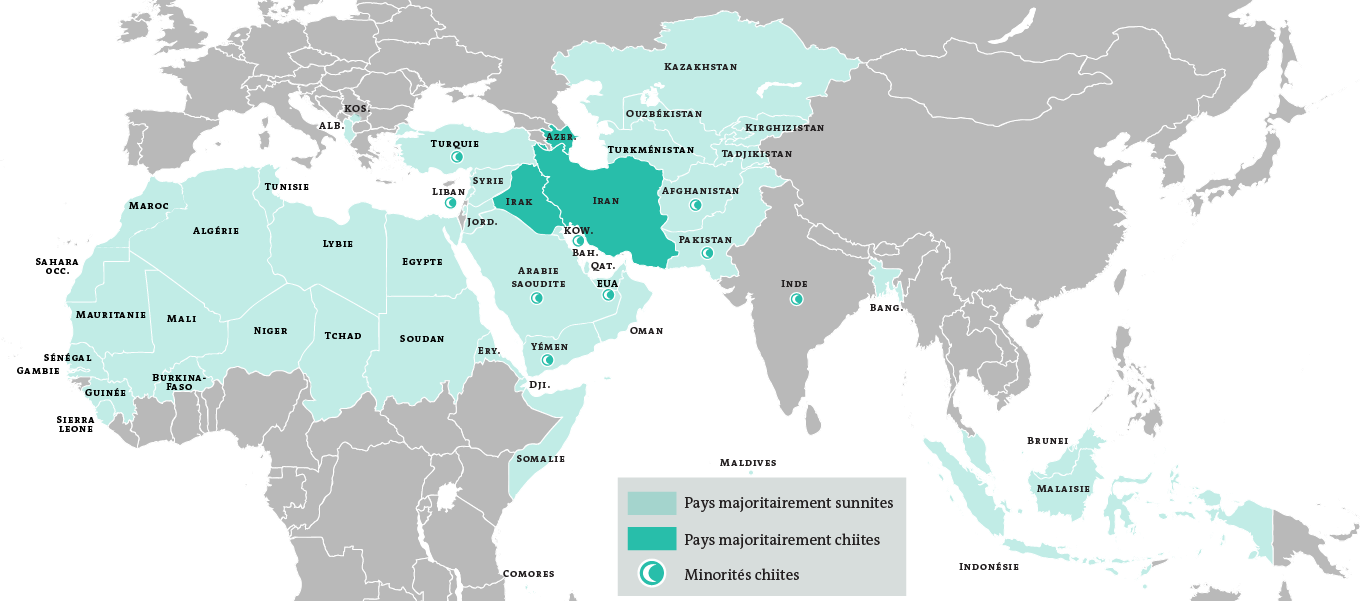Marche pour l’égalité entre les femmes et les hommes à Tunis, en mars 2018; © Reuters
Selon une interprétation littérale du Coran, les hommes se taillent la part du lion en matière d’héritage, au détriment des femmes. Depuis des décennies, le combat pour l’égalité successorale divise les sociétés musulmanes. Le président tunisien promet une loi très rapidement, déclenchant un tollé dans les rangs conservateurs au-delà de la Tunisie. Tour d’horizon des résistances au Maghreb.
a Tunisie va-t-elle encore une fois marquer l’Histoire et prouver qu’elle est à l’avant-garde des droits des femmes, comme aucun autre pays du monde arabo-musulman ? Son président, le nonagénaire Béji Caïd Essebsi, dont le mandat s’achève fin 2019, veut faire sauter l’inégalité entre les sexes devant l’héritage. Il a demandé aux parlementaires de l’Assemblée des représentants du peuple (ARP) de légiférer au plus vite pour une égalité successorale entre femmes et hommes de même degré de parenté. Le projet de loi doit être présenté cet automne au Parlement.
C’est osé, tant le sujet est hautement inflammable, tant les oppositions et les conservatismes sont forts au sein de la société tunisienne, comme dans toutes les sociétés musulmanes du Maghreb et au-delà. Et ce n’est pas acquis, même dans le « laboratoire de la démocratie », comme l’Occident aime à désigner désormais la Tunisie depuis la chute du dictateur Ben Ali en 2011, ce petit pays coincé entre l’Algérie et la Libye, qui en dépit d’un Parlement dominé par un parti islamiste (Ennahda), a su débarrasser globalement sa constitution de la référence à l’islam.
Il faut encore que le texte soit voté par un Parlement imprévisible, cacophonique, déjà très en retard sur de nombreux projets de loi, miné par l’absentéisme et les clivages entre modernistes et conservateurs, mais aussi entre membres d’une même famille politique, à l’instar du parti présidentiel Nidaa Tounes, ébranlé par des luttes internes de pouvoir.
Béji Caïd Essebsi, qui avait l’an dernier abrogé la circulaire de 1973 interdisant aux Tunisiennes d’épouser un non-musulman, poursuit sa lancée dans les pas modernistes et sécularistes de Habib Bourguiba, le pionnier de l’émancipation féminine en 1956, avec la réforme du code du statut personnel abolissant notamment la polygamie, la répudiation, le mariage avant 18 ans… Il va même plus loin que « le père de la nation » en s’attaquant à une inégalité reposant sur le Coran, le Sacré. La loi actuelle, qui prévoit qu’une femme hérite moitié moins qu’un homme du même rang de parenté, s’appuie sur le droit islamique. « Au fils, une part équivalente à celle de deux filles », consacre le Coran (sourate 4, verset 11).
Conscient du feu qu’il allume et pour ménager les plus rétrogrades, le chef de l’État tunisien propose de faire de l’égalité la règle par défaut et de l’inégalité, une dérogation, une exception. Il laisse la possibilité à ceux qui refusent que leurs filles héritent autant que leurs fils de le matérialiser de leur vivant par testament chez un huissier-notaire. Il suit ainsi les recommandations de la Commission pour les libertés individuelles et l’égalité, la Colibe, qui regroupe une dizaine d’islamologues, juristes et intellectuels de différentes sensibilités.
Chargée en 2017 de recenser les dispositions contraires aux principes de liberté et d’égalité consacrées par la Constitution de 2014, et de proposer des solutions pour les amender, la Colibe subit les foudres des milieux conservateurs depuis qu’elle a publié son rapport le 12 juin dernier. Elle y propose d’instaurer l’égalité devant l’héritage mais aussi de dépénaliser l’homosexualité ou de supprimer au moins les peines de prison, d’abolir la peine de mort, la dot, etc.
Deux jours avant l’annonce du président Essebsi, le 13 août dernier, lors de la « fête de la femme », jour férié en Tunisie qui célèbre la promulgation du code du statut personnel en 1956, plus de 5 000 personnes, emmenées par des associations religieuses, ont manifesté devant le Parlement tunisien contre les propositions de la Colibe, reprenant les plus folles rumeurs selon lesquelles la Colibe militerait pour la suppression de l’appel à la prière ou encore de la circoncision…
La première cible des attaques est la présidente de la Colibe, Bochra Belhaj Hmida. Députée indépendante et cofondatrice de l’Association tunisienne des femmes démocrates (ATFD), l’une des associations féministes les plus en pointe, qu’elle a présidée de 1995 à 2001, Bochra Belhaj Hmida essuie insultes, menaces de mort et se voit diabolisée dans les prêches par de nombreux imams : « Ils pensent que je suis contre l’islam et que l’islam est contre l’égalité ! » s’indigne-t-elle auprès de Mediapart. Si « la fureur s’est un peu calmée », elle reste sous protection très rapprochée : « On veut même me rajouter des agents mais je résiste. »
Bochra Belhaj Hmida se veut « très confiante » : « On ne convaincra pas les dogmatiques, très bien organisés, qui manipulent les gens en jouant sur le sentiment religieux : “Viens manifester contre cette réforme ou tu finiras en enfer.” Mais nous pouvons l’emporter en faisant preuve de beaucoup de pédagogie. C’est le choc, la peur du changement, le “on a toujours vécu ainsi” qui paralysent. Il faut expliquer aux femmes comme aux hommes que nous avons tous intérêt à l’égalité. »
Depuis des décennies, la question de l’égalité dans l’héritage divise les sociétés musulmanes, où le religieux est un puissant marqueur identitaire, soulève les haines des plus fondamentalistes, qui voient là encore et toujours la main de l’étranger, de l’Occident. Au Maghreb, le débat va et vient, entre tabou et confusion, depuis les années 1990. Et les rares sondages continuent de donner « l’opinion publique » vent debout contre ce droit des femmes, au prétexte qu’il violerait la sunna, la loi de Dieu. Au Caire, l’initiative du président tunisien est considérée comme « une violation flagrante des préceptes de l’islam » par les autorités de la mosquée Al-Azhar, qui font référence dans le monde musulman sunnite.
Si à Tunis, défilent aujourd’hui dans les rues, les médias, les foyers, les mosquées les “pour” et les “contre”, hier, c’était au Maroc. Dernier bastion de résistance à l’avènement de l’égalité entre les sexes, le droit successoral, à l’instar du droit de la famille, récuse toute séparation du civil et du religieux, devenant le lieu où s’écharpent traditionalistes et modernistes. « L’Association marocaine des droits de l’homme (AMDH) revendique une réforme depuis la fin des années 1990. À l’époque, même les associations féministes n’en parlaient pas, se souvient Khadija Ryadi, figure du militantisme au Maroc, qui anime la Coordination maghrébine des organisations de défense des droits humains. Lors de la grande campagne en 1992 pour le changement de la Moudawana [le code de la famille marocain – ndlr], l’égalité devant l’héritage n’était pas au programme. Et déjà, sans cela, les femmes qui menaient cette campagne et osaient revendiquer leurs droits avaient été la cible de menaces ; dans les mosquées, des imams ont prêché, des fatwas de mort ont été prononcées. »
En octobre 2015, c’est une institution officielle, le Conseil national des droits de l’homme (CNDH), qui lançait le pavé dans la mare en dénonçant cette injustice qui « augmente la vulnérabilité des femmes à la pauvreté » et en appelant à une réforme pour que le Maroc soit enfin dans les clous de sa constitution et des conventions internationales qu’il a signées pour l’élimination de toutes les formes de discrimination à l’égard des femmes. Tollé dans le royaume où les partisans du statu quo envoyaient, en tête de cortège, des femmes dire non à l’égalité devant l’héritage, avec toujours cet argument triomphant que l’on retrouve partout dans les pays arabo-musulmans : « C’est aux hommes de se tailler la part du lion, car c’est eux qui subviennent aux besoins du foyer », une réalité sociologique d’un autre âge.
Celui « de l’Arabie du VIIe siècle », pointe la sociologue et féministe Hanane Karimi, dans une tribune ici au site Middle East Eye. « La finalité principale poursuivie par les lois successorales dans le Coran est d’assurer une répartition équitable et juste de la succession du défunt entre ses proches, écrit-elle. Après le paiement des frais de funérailles et d’enterrement, le paiement des dettes et des legs, le Coran propose un schéma de distribution de la succession qui correspond à la répartition économique des rôles dans les familles de l’Arabie du VIIe siècle. Dans ce contexte, la condition de l’application de l’héritage était l’entretien et la protection des parentes par les héritiers. Les hommes avaient pour responsabilité de subvenir aux besoins du foyer – femme et enfants –, ainsi que de tout membre féminin sous leur protection – sœur ou tante non mariée par exemple. Or aujourd’hui, dans un contexte où les femmes pourvoient aux besoins du foyer aux côtés des hommes et parfois seules, cet arrangement des rôles est caduc. L’évolution moderne de la famille marocaine ne permet plus de postuler d’une solidarité mécanique effective. »

Chefchaouen, Maroc, 2016. © Rachida El Azzouzi
« La dévalorisation des femmes est structurelle aux mentalités, toutes tendances confondues »
Parmi les plus farouches adversaires politiques d’un progrès, on trouve les islamistes du PJD au pouvoir (Parti de la justice et du développement), furieux de cette « recommandation irresponsable », mais pas seulement. En matière d’égalité femmes-hommes, au Maroc comme ailleurs, les lignes de fracture habituelles sont brouillées. Les plus progressistes des politiques, mais aussi des activistes ou des érudits, peuvent parfois apparaître comme de redoutables conservateurs. À l’opposé, un ancien prédicateur repenti comme le salafiste Mohamed Abdelouahab Rafiki, dit Abou Hafs, condamné à 30 ans de prison après les attentats de Casablanca en 2003, est devenu, lui, un premier soutien et appelle à l’ijtidhad – soit à une réinterprétation des textes sacrés, car « la question de l’héritage doit être cohérente avec les évolutions de la société ».
« Il y a une matrice commune de fond, où la dévalorisation des femmes est structurelle aux mentalités, toutes tendances confondues. Et sur cette question, précisément, il y a des divisions internes au sein même des moins conservateurs », remarque la théologienne marocaine Asma Lamrabet, l’une des personnalités les plus inspirantes du féminisme musulman, mondialement connue pour ses travaux de réinterprétation du Coran et sur la place des femmes en Islam (lire ici notre entretien avec elle).
« L’héritage est le nœud gordien de la question de l’égalité parce qu’elle touche au pouvoir matériel des hommes. Questionner cette donnée religieuse, c’est remettre en cause les fondements du patriarcat religieux arabo-musulman, à savoir l’autorité “absolue” des hommes sur les femmes et la subordination de ces dernières à cette autorité au sein des deux sphères politique et familiale. Autorité supposée être de droit divin et donc indiscutable », décrypte Asma Lamrabet.
Alors qu’elle travaillait depuis une dizaine d’années « à sortir d’une lecture traditionaliste rigide et profondément discriminatoire du Coran » et à faire bouger les lignes de l’intérieur de la Rabita Mohammedia des oulémas de Rabat, « citadelle de résistances religieuses », assiégée par les tenants conservateurs du patriarcat, elle a été contrainte à la démission au printemps dernier pour ses prises de positions en faveur de l’égalité dans l’héritage. C’est la médiatisation de ses propos après une conférence universitaire autour d’un nouvel ouvrage collectif sur le sujet au Maroc – L’Héritage des femmes, sous la direction de la psychologue Siham Benchekroun après Les hommes défendent l’héritage, porté en 2017 par la psychanalyste Karima Lebbar – qui a eu raison de son poste de directrice du Centre des études sur les femmes en islam de la Rabita.
Fin mars, aux côtés d’une centaine de personnalités marocaines, Asma Lamrabet a signé la pétition lancée par les auteurs de L’héritage des femmes appelant à mettre fin à l’une des plus terribles lois successorales inscrites dans le code marocain, celle du ta’sib. Souvent confondue avec celle de la demi-part, elle intime notamment aux héritières n’ayant pas de frère de partager la moitié de leurs biens avec les parents masculins du défunt, même très éloignés (oncles, cousins, etc.).
Abrogée en Tunisie en 1959 par Bourguiba, la loi du ta’sib provoque des drames humains considérables au Maroc. « Elle est à l’origine de beaucoup de problèmes sociaux. Des femmes sont chassées de leur maison, des oncles qui n’ont jamais rendu visite à leur frère débarquent le jour de sa mort pour prendre leur part d’héritage, décrit la militante des droits humains Khadija Ryadi. Aujourd’hui, les familles essaient de contourner la loi. Des couples, même très pieux, qui n’ont pas eu de garçon essaient de mettre tous leurs biens au nom de leurs filles. »
En Algérie, où le courant conservateur est aussi puissant et où la même injustice que le ta’sib sévit sous un autre nom, on rêve d’un président qui prendrait la même initiative que son homologue tunisien. D’autant, comme le rappelle le journaliste d’El Watan et romancier Adlène Meddi, « dans ce pays, les avancées concernant les droits des femmes se font en binôme avec le pouvoir. Car les résistances sont très fortes au sein de la société. Si tu ne travailles pas avec les autorités, toute la société va être contre toi, hommes et femmes réunies ».
Nadia Ait Zaï y travaille depuis des décennies, avec un optimisme à toute épreuve. Conférencière en droit de la famille à l’université d’Alger, militante reconnue des droits des femmes au Maghreb, avocate, elle dirige le Centre d’information et de documentation sur les droits de l’enfant et de la femme (Ciddef), qui a fait du combat pour l’égalité dans l’héritage une de ses obsessions, depuis les années 1990. C’est le Ciddef qui a soumis au débat public et aux autorités en 2010 le premier Plaidoyer pour une égalité de statut successoral entre homme et femme en Algérie. Sans que cela ne déclenche comme au Maroc ou en Tunisie de grandes discussions sociétales. « Aujourd’hui, il n’y a pas la même volonté politique en Algérie qu’en Tunisie, mais l’idée fait son bonhomme de chemin », concède Nadia Ait Zaï.
« Pour le moment, les mentalités régressent, en l’absence d’un discours politique clair, franc, voulant aller vers l’égalité effective, regrette-t-elle. Au lieu de construire des relations égalitaires entre hommes et femmes dans la famille, on continue à réfléchir hiérarchisation des sexes, puissance maritale, alors que les codes de la famille du Maghreb ont connu des changements. Les notions de chef de famille et de devoir d’obéissance ont été abrogées, remplacées par l’égalité entre les époux dans la gestion de la famille. Si la loi a connu des changements, la société est encore empreinte de conservatisme et le politique ne s’y attaque pas. »
Comme beaucoup de femmes mais aussi d’hommes à travers le monde arabe, du Maghreb à l’Égypte, en passant par le Liban, la Jordanie, la Mauritanie, Nadia Ait Zaï a le regard tourné vers la Tunisie : « Comment cette égalité va-t-elle être consacrée dans la loi ? Si c’est un choix entre l’égalité ou la permanence de l’inégalité inspirée de la charia tel qu’annoncé par le président tunisien, c’est ce qui existe déjà de nos jours du vivant de la personne qui veut et peut partager à parts égales son patrimoine entre fille et garçon. Il faut dire que des révolutions culturelles et religieuses ont déjà lieu en silence dans des familles. »
Chaque année, le Ciddef, confronté dans ses permanences à des injustices criantes en matière d’héritage fracturant les familles, appauvrissant les veuves, les filles, remet le combat au centre, rappelle qu’il est urgent de légiférer, que les femmes contribuent à la construction du patrimoine autant que les hommes. Mais le Ciddef se sent bien démuni dans l’arène publique, soutenu par encore trop peu de parlementaires, d’associations et de partis politiques. Le RCD (Rassemblement pour la culture et la démocratie) est le seul parti à s’être vraiment positionné. En septembre, le plus laïc des partis algériens a, lors de son colloque Les femmes progressistes en lutte pour l’égalité, réaffirmé la nécessité de l’égalité dans l’héritage, ce qui lui a valu une levée de boucliers des conservateurs. Pour le chef du syndicat algérien des imams, Djeloul Hadjimi, ce droit des femmes serait une source de « fitna » (« division »)…
Source : Médiapart 14/10/2018