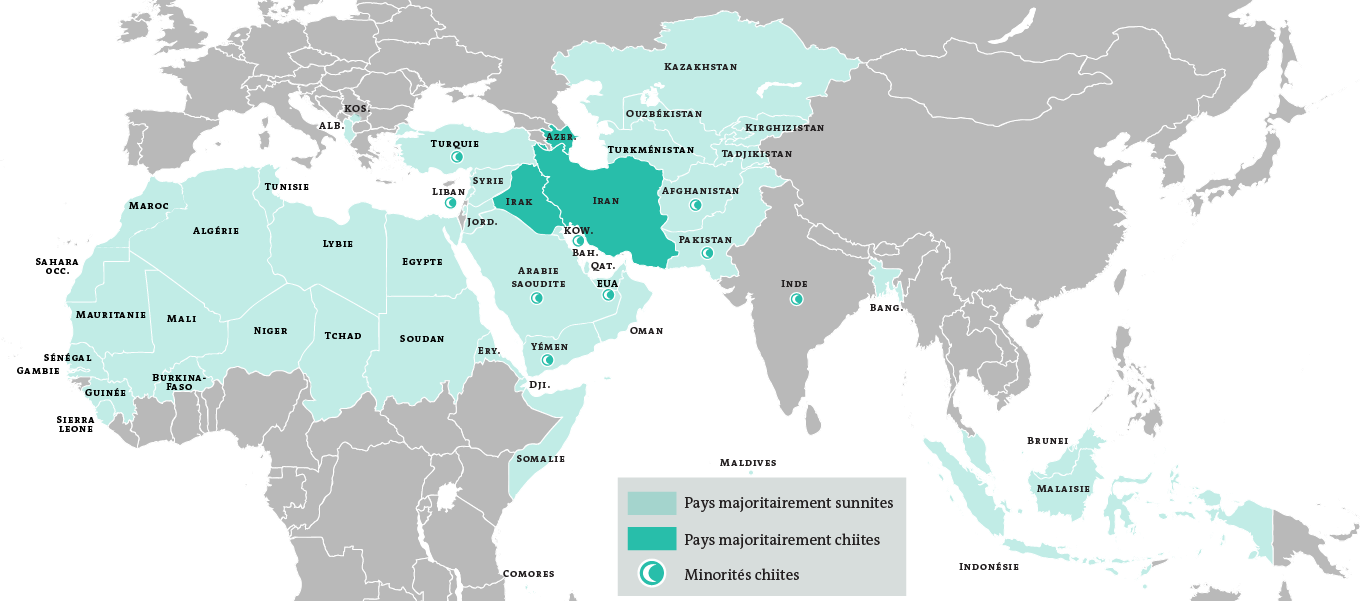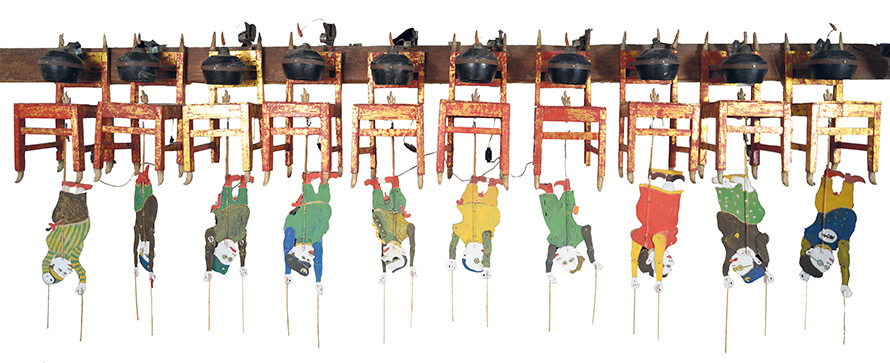
Heri Dono. – « Shock Therapy for Political Leader » (Thérapie de choc pour dirigeant politique), 2004.
Photo : Agung Sukindra – Mizuma Gallery, Singapour, Tokyo
Des sociétés tiraillées entre demande d’ordre et aspiration à l’ouverture
Quoi de commun entre l’icône birmane Aung San Suu Kyi et le sulfureux président philippin Rodrigo Duterte ? Leur présentation caricaturale dans les médias, notamment occidentaux, prompts à prendre parti au nom de considérations morales. Les peuples d’Asie du Sud-Est s’avèrent souvent moins sensibles aux accusations d’autoritarisme qu’aux résultats qu’ils escomptent de l’action de leurs élus.
En Asie du Sud-Est (1), c’est souvent la même histoire. Au départ, les médias bruissent de rumeurs enthousiasmantes à l’endroit des candidats libéraux. Colportées par les élites nationales cultivées et connectées, elles sont relayées par l’Occident, qui s’enflamme volontiers. Il en est allé ainsi en Indonésie en 2014, quand M. Joko Widodo, surnommé Jokowi, a fait souffler un vent nouveau sur la vie politique du pays, sclérosée par de vieux clans. La campagne de ce néophyte de la politique nationale, au mode de gouvernement si innovateur, fut portée par la haute classe sociale de Djakarta — dont il était le gouverneur — et par des universitaires de tous bords, jusqu’en Australie.
De la même manière, la victoire de la Ligue nationale pour la démocratie (LND) en Birmanie en novembre 2015 a semblé sonner la fin d’une époque dominée par les militaires. Certes, bloquée par la Constitution, Mme Aung San Suu Kyi n’était pas en mesure de prendre la présidence ; mais l’un de ses proches, M. Htin Kyaw, a été élu à ce poste le 15 mars dernier. Quant à la « dame de Rangoun », en tant que ministre des affaires étrangères, elle peut siéger au Conseil national de défense et de sécurité. Elle est aussi devenue conseillère d’État — une fonction créée pour elle.
Selon un principe symétrique, il arrive que les représentants non élus des élites tombent à bras raccourcis sur les pouvoirs en place — et que l’Occident soit tenté de suivre le mouvement. C’est ainsi qu’à Singapour, lors de l’été 2015, à la veille du scrutin du 11 septembre, les réseaux sociaux espéraient transformer l’essai des élections de 2011 qui avaient envoyé au Parlement six députés d’opposition sur quatre-vingt-sept — un record. Le père fondateur de la cité-État, Lee Kuan Yew, était décédé quelques mois plus tôt ; le temps semblait venu de tourner la page.
À la même époque, le premier ministre malaisien Najib Razak était accusé d’avoir détourné 700 millions de dollars du fonds d’investissement public 1MDB (1 Malaysia Development Berhad) vers ses comptes personnels — ce qu’il a toujours nié. Aussitôt, le mouvement Bersih (« propre »), devenu célèbre après son premier rassemblement de protestation en 2007, reprenait la rue. Il recevait le soutien inédit de l’ancien premier ministre Mahathir Mohamad, hier mentor de M. Najib et aujourd’hui son opposant. Les jours du chef du gouvernement semblaient comptés.
Dernier cas, celui du président philippin Rodrigo Duterte, dont les propos comme candidat ont régulièrement heurté l’intelligentsia occidentale. Il a rapidement été comparé au républicain américain Donald Trump du fait de ses déclarations macho-populo-polémiques. Non content d’avoir averti, en campagne, qu’il n’hésiterait pas à abattre des dizaines de milliers de criminels, il a, une fois élu, encouragé ses concitoyens à éliminer physiquement des trafiquants de drogue. À écouter le président investi le 30 juin 2016, les journalistes ne seraient pas à l’abri d’un tel traitement s’ils se révélaient être « des fils de p… », selon ses propres mots. Ces menaces à peine voilées ont aussitôt suscité une mise en garde de l’Organisation des Nations unies (ONU) (2). M. Duterte a de nouveau utilisé la vulgaire expression dont il est coutumier pour qualifier M. Barack Obama début septembre ; ce dernier a aussitôt annulé la rencontre bilatérale prévue, malgré les excuses de son homologue philippin, avant de lui serrer la main dans un couloir en marge du sommet de l’Association des nations de l’Asie du Sud-Est. Puis M. Duterte a annoncé qu’il voulait chasser les forces spéciales américaines du sud du pays…
En résumé, on accordait peu de crédit et guère de perspectives aux dirigeants singapourien, malaisien et philippin, ce qui contrastait avec l’enthousiasme généré par les candidats d’Indonésie et de Birmanie.
Cependant, la vérité des urnes n’est pas celle de la médiasphère. Si les villes disposent de grosses caisses de résonance, les campagnes restent prépondérantes au moment du décompte — le taux d’urbanisation en Asie du Sud-Est n’atteignait que 47 % en 2015. Et leurs priorités ne sont pas forcément celles des élites urbaines : c’est plutôt le paternalisme qui domine le système socio-politique, et caractérise la région.
En Indonésie, même si Jokowi a été élu président en juillet 2014, il n’a finalement pas largement dominé la campagne comme escompté, et les élections législatives du 9 avril 2014 l’ont privé d’une majorité au Parlement (lire les « Repères »). Il a même durci son discours pour s’appuyer sur les forces conservatrices et séduire la frange de l’électorat qui avait soutenu son rival nationaliste Prabowo Subianto. Il a autorisé les exécutions, au terme de procès légaux, de trafiquants de drogue (la dernière en juillet), ainsi qu’une traque des pêcheurs illégaux (quelque 210 navires ont été coulés depuis fin 2014) ; il s’est refusé à reconnaître clairement les massacres de masse de 1965-1966 contre les communistes (3). Et on le dit intéressé par la sanglante campagne antidrogue menée par M. Duterte.
Les Malais derrière leur gouvernement
De même, bien qu’ayant remporté les élections, la LND en Birmanie s’est fait attendre sur la question des minorités ethniques, à commencer par les Rohingyas musulmans (4), dont le sort est toujours loin d’être réglé — M. Kofi Annan, l’ancien secrétaire général de l’ONU, a atterri dans l’ouest du pays début septembre en espérant aider à régler la crise. Comme l’expliquent des chercheurs du Peace Research Institute of Oslo (PRIO), les élections n’ont pas seulement évincé les militaires, elles ont aussi marginalisé les partis ethniques : bien que représentant 40 % de la population, ils n’ont obtenu que 6 % des sièges, la LND profitant d’un mode de scrutin largement à son avantage. Fin 2015, certains de ces groupes ethniques, comme les Kachins, n’ont pas manqué de faire part de leur pessimisme ; ils ont admis avoir cherché l’efficacité en accordant leur voix à la Ligue, non pour la soutenir mais pour s’opposer au parti de l’ancienne junte.
Dans le cas de Singapour, point de monde rural, mais une « majorité silencieuse » composée de fonctionnaires et d’une population âgée, toujours plus confiante dans le Parti d’action populaire (PAP), au pouvoir depuis 1959. Les électeurs ont voté en 2015 à 70 % pour les candidats du gouvernement, en leur accordant 83 sièges sur 89, à l’opposé de ce que laissait supposer l’intense activité sur les réseaux sociaux. La tendance a été confirmée lors d’une élection partielle au printemps 2016 (5).
En Malaisie, alors qu’on les imaginait au plus bas à cause des scandales de corruption en chaîne, le premier ministre Najib et son parti ont remporté en mai et juin 2016 plusieurs scrutins : un à la tête d’un des États de la fédération et deux législatives partielles. M. Najib « se tient plus haut que jamais, reconnaissait même l’Agence France-Presse (AFP). Son destin électoral n’a jamais paru si favorable (6) ». Sur sa lancée, il s’est permis d’adopter de nouvelles lois liberticides, renforçant notamment le contrôle d’Internet, tandis que l’ancien chef de file de l’opposition, M. Anwar Ibrahim, est en prison depuis février 2015 à cause d’accusations de sodomie, interdite en Malaisie.
Enfin, aux Philippines, malgré le portrait peu élogieux de M. Duterte dressé par la presse internationale, ce dernier a remporté l’élection présidentielle à un tour en mai dernier avec 39 % des voix, soit cinq millions de bulletins de plus que son dauphin (7). Une fois dépassé le choc — heureux ou pas — des résultats, voire des premières mesures, l’art du compromis et le souci du consensus ont bien semblé reprendre le dessus.
Comme souvent sur la scène internationale du Sud-Est asiatique, où les chancelleries oscillent entre Chine et États-Unis, les gouvernements reviennent à un équilibre prudent. C’est ainsi qu’après avoir cherché ses marques, le président indonésien a décidé de tourner peu à peu le dos à quelques bourgeois-bohèmes du Parti démocratique indonésien de lutte (PDI-P), de jeunes intellectuels souvent aisés, parfois formés à Singapour ou en Occident, qui l’avaient soutenu lors de la campagne. L’emprise de Mme Megawati Sukarnoputri, fille du premier président Sukarno, sur ce parti nationaliste et de centre gauche ne lui laisse en effet guère de marges de manœuvre, notamment dans les nominations. Le président profite par ailleurs de l’implosion de la coalition d’opposition au Parlement. Beaucoup de partis anciennement proches de M. Prabowo ont finalement préféré rejoindre le camp présidentiel. À présent, Jokowi aurait trouvé son cap en privilégiant une entente avec le Golkar, l’un des principaux partis, assez modéré et fervent défenseur du pancasila — cette philosophie de l’État indonésien résumée en cinq principes, dont la démocratie, la « justice sociale » ou encore l’obligation de croire en un dieu, sans autre précision.
Après avoir accumulé les postures — défenseur de l’ordre face aux trafiquants de drogue, protecteur du pays en réponse aux incursions chinoises en juin dernier, pionnier de la nation en relançant la politique maritime de l’archipel —, le président Jokowi veut lutter contre le déficit budgétaire. Pour s’y attaquer, il a rappelé de la Banque mondiale Mme Sri Mulyani Indrawati, très appréciée de la communauté des affaires, lors du remaniement de cet été. L’ex-général Luhut Binsar Pandjaitan, ancien du Golkar et proche conseiller du président, confirme son statut d’homme fort du gouvernement comme ministre coordinateur des affaires maritimes ; il garde la main sur les sujets sensibles : mer de Chine méridionale, infrastructures, énergie et tourisme. La question papoue illustre les louvoiements de Jokowi. Il a certes apporté des aides, amélioré les routes. Mais, parallèlement, la militarisation se poursuit, et la nomination du général Wiranto au poste de ministre coordinateur des affaires politiques, légales et sécuritaires inquiète à cause de son passif, notamment au Timor-Leste (8).
Tous les généraux n’ont pas désarmé
De son côté, l’équipe victorieuse en Birmanie a su reprendre le cap initialement fixé en travaillant sur un projet fédéral afin de régler la question des minorités ethniques. M. Romain Caillaud, analyste et consultant à Singapour, précise que « beaucoup d’électeurs issus des minorités ont voté pour le parti [de Mme Aung San Suu Kyi] dans un objectif d’union nationale et d’efficacité des réformes ». En octobre 2015, un cessez-le-feu avait été signé entre le gouvernement et seulement huit partis représentant les minorités. Un an plus tard, début septembre, la conférence de Panglong du XXIe siècle — en référence à celle de 1947, réunie par le père de Mme Aung San Suu Kyi et alors présentée comme la première étape vers une République birmane unifiée — a réuni tous les groupes à l’exception d’un interlocuteur de poids, l’Armée unie de l’État wa (UWSA) : un « premier pas » dans la réconciliation nationale, selon le Myanmar Times. Une autre conférence devrait suivre dans six mois.
En ce qui concerne les partis forts, historiques ou nationalistes (re)conduits au pouvoir, leur politique apparaît plus nuancée que ne le laissaient penser les inquiétudes initiales. À Singapour, par exemple, le gouvernement a tenté de renouveler ses élites et de se concentrer sur des politiques sociales. Il a donc multiplié aussi bien les instances de dialogue que les efforts de redistribution à travers des hausses de salaires (infirmières, policiers) et l’augmentation des aides à la génération des « pionniers » (les seniors). En septembre 2014, une commission constitutionnelle avait également rendu ses conclusions pour veiller à la représentation des minorités ethniques (malaise, indienne ou eurasienne) face à la majorité chinoise à l’occasion de l’élection présidentielle.
En Malaisie, le premier ministre a remanié son gouvernement fin juin. Objectifs ? Témoigner sa reconnaissance à ses alliés potentiels, par le biais de nominations et promotions, mais aussi, selon ses termes, affirmer les « priorités du gouvernement : la santé économique, le bien-être social et la sécurité de tous les Malaisiens ». C’est ici un point capital et une erreur de jugement classique au sein des mouvements d’opposition, de Singapour à Kuala Lumpur (et ailleurs) : sauf régime dictatorial, les discours droits-de-l’hommistes trouvent souvent peu d’écho dans l’électorat, à la différence des considérations plus terre à terre, telles que le pouvoir d’achat. La coalition d’opposition se montrera-t-elle capable de se rassembler ? Pourra-t-elle mobiliser l’opinion autour de son combat contre le projet de loi sur l’état d’urgence, qui donnerait davantage de pouvoir au premier ministre ? Pour l’heure, les forces partisanes semblent dispersées, tandis que la récente rencontre entre Mahathir Mohamad et son vieil ennemi Anwar Ibrahim, exceptionnellement autorisé à sortir de prison pour contester une loi à la Cour suprême, a de quoi déstabiliser les observateurs.
Reste le cas de l’avocat Duterte. Sa lutte contre les trafics et les cartels de la drogue version philippine est éminemment condamnable : depuis son arrivée au pouvoir jusqu’à mi-septembre, 3 426 personnes ont été tuées, 1 491 par la police et les autres par des civils. Mais, pour l’heure, on ne peut parler de dictature, et il existe quelques garde-fous constitutionnels, telles l’impossibilité de se présenter pour un second mandat au-delà de quatre années passées au pouvoir ou encore la procédure de destitution, plus facile à mettre en place qu’aux États-Unis (9). Surtout, le programme de M. Duterte peut séduire le plus grand nombre : il cherche à se détacher des clans familiaux qui sont à la manœuvre essentiellement depuis Manille, où il n’est allé qu’une seule fois entre sa victoire et son investiture. Il a même snobé la proclamation solennelle des résultats au Congrès. Dans cette lignée, il prône un fédéralisme susceptible d’apporter la paix dans les îles du Sud en proie au sécessionnisme, même si le pari est risqué. Fort de sa trentaine d’années d’expérience en tant que maire de Davao, dans le Sud longtemps instable, il pourrait être le mieux placé pour enfin y régler le conflit entre séparatistes musulmans et pouvoir central — sans oublier les rebelles communistes également actifs dans les zones rurales.
À en croire Richard Javad Heydarian, professeur à l’université De La Salle à Manille, M. Duterte n’a rien d’un « Trump de l’Est ». Le chercheur le qualifie au contraire d’acteur « sophistiqué et nuancé », comme l’illustre sa « géopolitique de la mer de Chine méridionale », à savoir sa vision du conflit territorial, sa diplomatie régionale et sa porte ouverte à Pékin sur ce dossier sensible. Et M. Caillaud de préciser qu’il serait également « bien entouré » pour les dossiers économiques.
En revanche, des acteurs risquent de troubler les jeux en cours dans la région. En premier lieu, le facteur islamiste ne peut être négligé alors qu’un bataillon de Malais a été constitué au sein de l’Organisation de l’État islamique (OEI) au Proche-Orient. La Malaisie a été frappée par un attentat le 28 juin 2016, après celui de Djakarta en janvier où l’on a déploré sept morts, dont cinq assaillants. Une province du « califat » se mettrait en place aux Philippines, d’après des analystes jamais avares en éléments de dramatisation propices au bon financement de leurs instituts. Car, tout comme il avait été question de « second front de la terreur » dans les années 2000, marquées par l’âge d’or d’Al-Qaida — une allégation jamais confirmée —, l’OEI est aujourd’hui servie à toutes les sauces sud-est-asiatiques.
C’est le cas aux Philippines, alors qu’avec la Syrie les liens y sont bien moins évidents qu’avec le grand banditisme. C’est également le cas en Indonésie, où les autorités auraient déjoué début août, sur l’île de Batam, une attaque au lance-roquettes planifiée contre Singapour. L’affaire est prise très au sérieux dans la cité-État, toujours à la recherche d’ennemis pour cimenter son pacte social. Mais elle suscite le scepticisme en Indonésie, où l’affaire est qualifiée d’opaque… De même, le profil des quelques personnes arrêtées pour radicalisation et djihadisme à Singapour ne semble pas correspondre à celui des auteurs d’attentats en Europe, souvent moins amateurs, plus radicalisés et davantage connectés à la Syrie. Enfin, les travaux du Pr Duncan McCargo, politiste spécialiste de la région, avaient déjà permis de mettre en relief le poids de la politique locale — et non des nébuleuses islamistes transnationales — dans le conflit du sud de la Thaïlande entre Malais musulmans et Thaïs bouddhistes (10). Là encore, des attaques en août dernier dans les provinces du Sud n’ont pas complètement livré leurs secrets : sont montrés du doigt tantôt les insurgés malais du Sud, tantôt les opposants politiques à la junte.
Faut-il alors davantage s’inquiéter des armées ? En Thaïlande justement, sous prétexte de stabilisation du pays, les généraux ont, en 2014, confisqué le pouvoir autour duquel s’écharpaient libéraux et nationalistes, élites et peuple, urbains et ruraux, « chemises jaunes » et « chemises rouges ». La junte a organisé un référendum le 7 août dernier sur un projet de Constitution guère démocratique. Le général Prayuth Chan-o-cha, premier ministre, s’est félicité de la victoire du « oui » (autour de 61 %), l’objectif étant certes la tenue d’élections générales en 2017 mais aussi de contrôler un Sénat qui ne serait plus élu mais nommé par le pouvoir militaire. La population se serait-elle fait une raison, à moins qu’elle ne courbe le dos jusqu’au prochain scrutin ?
La transition sera-t-elle plus douce en Birmanie ? Mme Suu Kyi doit encore composer avec ce qu’elle appelle « l’armée de son père ». Celle-ci dispose de 25 % des sièges au Parlement, sachant que 75 % des voix sont requises pour modifier la Constitution. À charge pour la LND de trouver les dosages subtils afin de concéder le minimum à un acteur encore incontournable à court terme. Ce fut particulièrement notable lors de la conférence de Panglong : les officiers des forces armées (Tatmadaw) ont clairement marqué leur territoire en rejetant vigoureusement les demandes d’autonomie administrative des Was et des Shans, tout en interdisant à d’autres groupes combattants de participer à la rencontre historique.
Quant à l’armée indonésienne, elle ne reste pas non plus inactive. Son Livre blanc de la défense publié au printemps dernier relance très vaguement l’idée d’infiltrations étrangères et de « défense totale » impliquant toutes les composantes de la société. En sus, le fait terroriste donne lieu à une concurrence entre la police et l’armée, qui y voit une occasion de s’affirmer davantage sur le territoire sous prétexte de protection. Mais le ministre de la défense manque trop de charisme pour rivaliser avec MM. Jokowi et Luhut. Ces derniers semblent encore tenir les rênes. Toutefois, ici — dans une moindre mesure — comme en Thaïlande, en Birmanie et de façon discrète à Singapour, où bien des ministres sont généraux ou amiraux, les officiers veillent, un pied dans la porte du jeu démocratique.
Éric Frécon