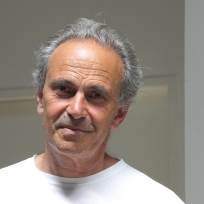
Michel Feher, philosophe, est fondateur de Cette France-là ainsi que de la maison d’édition new-yorkaise Zone Books.
Pour le philosophe Michel Feher, auteur d’un essai récent publié aux éditions La découverte « Le temps des investis. Essai sur la nouvelle question sociale » (automne 2017), la financiarisation de l’économie a modifié en profondeur le fonctionnement des acteurs sociaux – entreprises, Etats, particuliers – et déplacé les enjeux de la question sociale. Elle oblige la gauche à se réinventer si elle veut véritablement résister à l’hégémonie des institutions financières. Des pistes de nouveaux modes d’organisations du travail, fruit d’un nouvel imaginaire, sont déjà en train d’émerger.
Vous écrivez que la gauche, lassée du ressassement de ses défaites, serait bien inspirée de s’emparer de la question sociale, dont les protagonistes ne sont plus le patron et le salarié mais l’investisseur et ‘l’investi’. Nous dirigeons-nous vraiment vers la fin de la société salariale ?
Au vu des évolutions récentes de la législation du travail, de l’économie numérique et des exigences du capitalisme financier, l’hypothèse est au moins plausible. Mais je crois que pour comprendre comment cette crise du salariat est advenue, il faut repartir un peu en arrière.
Tout le monde s’accorde à reconnaître la financiarisation qui affecte le capitalisme depuis les années 1980. Mais peut-être doit-on s’interroger davantage sur ce qu’implique l’avènement de ce nouveau régime d’accumulation du capital, y compris pour celles et ceux qui le contestent.
D’abord, constater– comme François Hollande naguère – que la finance gouverne revient à affirmer que ce sont les investisseurs, davantage que les employeurs, qui sont aujourd’hui aux manettes. Or les premiers n’exercent pas la même fonction que les seconds.
Jusqu’à la fin des Trente Glorieuses, le régime communément appelé fordiste gravitait autour des grandes entreprises multinationales verticalement intégrées décrites jadis par Alfred Chandler. Dans cette phase ultime de la domination du capitalisme industriel, les agents économiques étaient encore appréhendés comme des commerçants : employé, employeur ou indépendant, chacun était perçu comme offreur et demandeur de marchandises, tâchant de vendre au meilleur prix et d’acheter au moindre coût.
Qu’est-ce, en effet, que le « travailleur libre » décrit par Marx, sinon un sujet libre de vendre la seule marchandise qu’il possède, à savoir sa force de travail ? Tel est d’ailleurs aussi le mode de légitimation du capitalisme industriel, dont les défenseurs soulignent qu’il est un régime qui rend les hommes également libres de poursuivre leur intérêt en échangeant ce qu’ils possèdent– même s’il est vrai que certains possèdent des capitaux, alors que d’autres ne possèdent que leur force de travail.
De son côté, la critique marxiste dénonce évidemment le subterfuge que constitue cette « égalité formelle », puisque la rémunération des travailleurs libres ne correspond pas à la richesse qu’ils produisent mais seulement au prix que le marché de l’emploi confère à leur force de travail – la différence entre les deux étant, comme on sait, la définition même de l’exploitation.
Or, à la différence du capitalisme industriel, le capitalisme financier n’institue pas un univers de commerçants. Tandis que les employeurs traitent leurs employés en marchands de force de travail, pour leur part, les investisseurs ne voient que des projets en quête de financements. Autrement dit, les sujets du capitalisme financiarisé ne cherchent plus tant à tirer profit de ce qu’ils vendent qu’à trouver crédit auprès des bailleurs de fonds. Le rapport social essentiel ne se noue donc plus autour de l’emploi de la force de travail mais plutôt de l’évaluation des projets : il met en scène un investisseur et un investi – ou en tout cas un postulant à l’investissement – plutôt qu’un employeur et un employé.
On serait donc sortis d’un rapport entre employeurs et employés ?
La relation d’emploi n’a évidemment pas disparu et l’exploitation des employés n’a pas diminué, bien au contraire : les ravages du chômage et de la précarisation sont indéniables. Reste que la détérioration des conditions d’emploi renvoie à l’ascendant du pouvoir des investisseurs.
Or, celui-ci se distingue du pouvoir qu’exerce l’employeur. L’employeur accapare une part de ce que le travailleur produit – la plus-value qu’il convertit en profit – alors que l’investisseur sélectionne ce qui mérite d’être produit. Et si les types de pouvoir qu’ils exercent se distinguent, il en va nécessairement de même des formes de résistance qui peuvent leur être opposées.
Comment les choses ont-elles basculé ?
La financiarisation du capitalisme dans les pays industrialisés s’opère très schématiquement en trois grands moments, correspondant chacun à l’assujettissement d’un type d’acteurs sociaux – les entreprises d’abord, puis les États et enfin les ménages, les particuliers.
Du côté des entreprises, la financiarisation procède de la crise du fordisme, dès le tournant des années 1970. Jusque là, le capitalisme managérial recherchait avant tout la croissance des capacités de production. Un tel objectif imposait aux managers de maintenir la paix sociale : il fallait s’assurer que les travailleurs s’estiment suffisamment bien payés pour ne pas se mettre en grève, que les actionnaires fassent suffisamment de profits pour ne pas retirer leur mise, et que les uns et les autres renoncent à se montrer trop gourmands pour assurer un taux de réinvestissement conforme aux objectifs de développement de l’entreprise.
Or, ce modèle commence à s’épuiser lorsqu’il n’est plus soutenu par une forte croissance économique – moment que Thomas Piketty associe à l’achèvement de la reconstruction des économies détruites par la Seconde Guerre Mondiale.
Aussitôt, le capitalisme managérial va faire l’objet de violentes critiques : les tenants de « l’analyse économique du droit » (Law and Economics), formés à l’École de Chicago, vont s’attaquer aux PDG salariés des grandes firmes fordistes, leur reprochant de sacrifier le profit de leurs employeurs – les actionnaires – à l’entretien de leur propre pouvoir.
La propension des managers à apaiser les syndicats et à chercher l’appui des pouvoirs publics, s’emportent leurs détracteurs, serait même une des causes principales de la baisse de productivité – et donc de la croissance déclinante – des économies développées. Pour relancer l’activité, concluent les réformateurs néolibéraux, il importe donc de discipliner les managers, de les contraindre à retrouver le sens de leur métier – qui est d’offrir aux propriétaires du capital les profits auxquels ils aspirent.
Pour recentrer les PDG sur leur mission, les partisans de l’analyse économique du droit militent pour l’organisation d’un marché du pouvoir managérial : il s’agit de mettre les managers en concurrence, de permettre aux investisseurs de les choisir et de les remplacer librement en fonction de leurs performances. Tel sera donc le motif initial de la dérégulation des marchés financiers. Pour donner aux actionnaires actuels ou potentiels le pouvoir de sélectionner les PDG, il faut lever les obstacles juridiques et réglementaires aux offres publiques d’achat (OPA), acquisitions d’entreprises par endettement (LBO) et autres raids destinés à se débarrasser des équipes managériales insuffisamment performantes.
Outre le bâton des prises de participation hostiles, la « rééducation » des managers va aussi passer par la carotte des stocks options, bonus et autres formes de rémunérations indexées aux performances financières des entreprises. Une fois personnellement intéressés au bonheur des actionnaires, les PDG ne tarderont pas à réviser leurs priorités.
Reste qu’en apprenant leur nouveau métier, les managers vont profondément modifier la personnalité de l’entreprise. Bientôt, en effet, le succès d’une firme ne se mesurera plus aux résultats de son activité commerciale mais plutôt à son attractivité aux yeux des investisseurs – laquelle s’exprime dans la valeur actionnariale. Plus que la croissance à long terme des revenus d’exploitation, c’est l’appréciation à brève échéance du capital, soit le cours de l’action, qui importe avant tout. Autrement dit, le crédit prend le pas sur le profit.
Rien n’illustre mieux ce changement que la pratique du buyback : que des entreprises cotées en bourse utilisent leurs ressources pour racheter leurs propres actions sur le marché secondaire est absurde d’un point de vue commercial mais parfaitement rationnel dès lors que le prix de l’action est la seule boussole qui guide leurs dirigeants.
Contrairement à ce qu’annonçaient les promoteurs de cette réorientation de la stratégie entrepreneuriale, la conversion des PDG à la poursuite de la valeur actionnariale n’a pas ramené la croissance des premières décennies d’après-guerre. En revanche, elle a ouvert la voie à une financiarisation de l’économie qui s’est rapidement étendue aux États.
Dès lors que les grandes entreprises se sont consacrées à l’entretien de leur attractivité auprès des investisseurs, les gouvernements n’ont eu de cesse de leur offrir les moyens de ce qu’elles appelaient compétitivité. Pour aider les firmes domiciliées sur leur territoire à attirer les pourvoyeurs de crédit, ils ont adapté leur législation aux goûts des investisseurs – à savoir une fiscalité réduite, un marché du travail flexible et des droits de propriété intellectuelle renforcés. S’est donc instituée une compétition entre les États dont l’enjeu était d’offrir l’environnement le plus attractif possible aux investisseurs internationaux.
Cependant, rivaliser de générosité envers les détenteurs de liquidités n’allait pas sans risques pour des gouvernements soumis aux suffrages de leurs mandants. Car si la baisse des rentrées fiscales et la précarisation des emplois affectaient trop lourdement l’aptitude des États à financer les services publics et à assumer leur rôle de protection sociale, elle risquait de compromettre la réélection des responsables de politiques favorables aux investisseurs. Les gouvernants ne pouvaient donc pas se permettre de sacrifier entièrement le bien-être de leurs électeurs à l’attractivité de leurs entreprises. Soucieux de trouver un compromis entre les besoins des uns et le souhait des autres, leur solution consistera à substituer l’emprunt aux impôts. Autrement dit, pour ne pas déroger à leurs obligations envers leurs concitoyens, ils vont emprunter sur le marché obligataire ce qu’ils ne parviennent plus à collecter par la voie fiscale.
Les prêteurs seront évidemment ravis de leur avancer les sommes requises mais non sans poser leurs conditions : pour éviter des taux d’intérêt prohibitifs, les gouvernements devront promettre encore plus de flexibilité sur le marché du travail, encore moins d’impôts sur le capital et toujours davantage de protections de la propriété intellectuelle. En recourant massivement à l’emprunt, les Etats se mettent donc sous la coupe des marchés financiers. Or, une fois appendus à la confiance que leur accordent les détenteurs d’obligations et de bons du Trésor, les gouvernants vont à leur tour connaître un changement de personnalité analogue à celui des entreprises converties à la poursuite de la valeur actionnariale. En effet, plutôt que la croissance économique – qui les obsédait plus que tout pendant les Trente Glorieuses – c’est leur crédit auprès des marchés obligataires qui va devenir leur principale préoccupation. Dépendants du renouvellement des prêts qui leur sont consentis, ils vont faire de la notation de leur dette publique la boussole de leurs politiques publiques.
La financiarisation ne s’arrête pourtant pas là. Car une fois tenus d’offrir des gages aux créanciers, les États se retrouvent bientôt face au même dilemme qui les avaient précédemment poussé sur la voie de l’emprunt : pour éviter que le taux d’intérêt de leur dette publique ne s’envole, il leur faut consentir aux mesures d’austérité budgétaire que le recours au marché obligataire leur avait d’abord permis d’éviter.
Et du coté des Etats ?
Les Etats vont alors faire pour leurs concitoyens ce qu’ils ont fait pour eux-mêmes : puisque, d’un côté, le souci de garder la confiance des marchés interdit d’augmenter les impôts et de revaloriser les salaires, mais que, de l’autre, il demeure électoralement dangereux de trop faire le malheur du peuple, les gouvernants vont décider d’inciter leurs concitoyens à emprunter à leur tour et pour leur compte – en particulier dans certains pays tels les Etats-Unis, le Royaume Uni et l’Espagne. Le développement du crédit commercial va donc s’ajouter à l’endettement public. Pour maintenir leur train de vie – ou simplement survivre – les ménages ne peuvent certes plus compter sur la progression de leurs revenus salariaux, mais il leur sera désormais plus facile d’accéder aux prêteurs.
Au terme de cette troisième phase de financiarisation, les individus vont se retrouver dans une situation similaire à celle des entreprises et des États : plus que de la progression de leurs revenus salariaux ou indirects, leur sécurité économique dépendra de leur crédit, soit de la confiance qu’ils inspirent aux prêteurs et de la valeur que le marché attribue à ce qu’ils souhaitent acquérir en empruntant (logement, diplôme universitaire, etc.). Autrement dit, on mise moins sur ce qu’on gagne que sur l’appréciation de ses ressources – « portefeuille » où figurent le capital immobilier, l’épargne, mais aussi les compétences, le carnet d’adresses, voire la bonne mine.
Et il ne s’agit pas seulement d’apparaître solvable pour pouvoir emprunter. Car lorsque les entreprises ne s’occupent plus que de valeur actionnariale et les États de conserver la confiance des détenteurs d’obligations, les premières ne sont plus en mesure d’offrir des emplois stables et les seconds d’assurer des transferts sociaux décents. Dès lors, pour pouvoir travailler, il faut accepter d’enchaîner ou de cumuler les boulots précaires, voire d’offrir ses talents à la tâche en endossant le statut d’auto-entrepreneur, ce qui nécessite de se constituer un capital « réputationnel » suffisant auprès des recruteurs. Là encore, le crédit est bien là clé, puisqu’il s’agit de faire valoir ses compétences, les avis favorables des clients antérieurs, etc.. Et à défaut d’autre atout à arborer, une infinie disponibilité et une absolue flexibilité font figures d’« actifs » : travailler sans protection, à n’importe quelle heure, est une manière de se faire valoir.
Bref, pour répondre enfin à votre question initiale, le déclin de la société salariale n’est pas tant affaire de robotisation que de financiarisation de l’économie, et de son impact sur les conditions de vie d’une fraction croissante de la population.
La gauche se trompe t-elle de combat ?
La gauche qui reste de gauche, ainsi que les syndicats, restent aujourd’hui essentiellement mobilisés sinon pour restaurer le salariat protégé des Trente Glorieuses, du moins pour en conserver des lambeaux. Une pareille résistance est parfaitement compréhensible, au regard des « réformes » que les gouvernants comme la voie, sans alternative, de la modernisation, mais je ne suis pas sûr qu’elle soit efficace ni de nature à sortir la gauche de son marasme mélancolique – d’autant qu’elle conforte l’accusation de conservatisme que les modernisateurs autoproclamés se plaisent à lui lancer.
En outre, je ne crois pas que la restauration du « keynésianisme dans un seul pays » d’après-guerre soit désirable. Mû par un productivisme insoutenable, il était en outre tressé de normes discriminatoires. Le compromis social fordiste consistait en effet à offrir des emplois stables et une protection sociale décente aux chefs de famille mâles, blancs et de souche en échange de leur soumission à la technostructure managériale et au paternalisme d’État. Il n’est pas étonnant que les extrêmes droites se montrent plus aptes que la gauche à capter la nostalgie d’un tel « bon vieux temps ».
Davantage que les appels à la restauration du salariat, c’est le renouveau du coopérativisme qui m’apparaît comme une réplique prometteuse à la précarisation du travail. Les récentes actions militantes des coursiers sont très intéressantes à cet égard. D’une part, ils mènent des actions en justice pour faire requalifier leur travail en emploi salarié – alors que les enseignes qui les recrutent ne leur offrent que des contrats commerciaux. Mais d’autre part, ils savent que s’ils obtiennent gain de cause, le modèle économique des plateformes est tel que, si elles sont contraintes de salarier les coursiers, la faillite est assurée. Autrement dit, un avis favorable du tribunal constitue une victoire à la Pyrrhus, puisqu’à peine devenue employeuse, l’entreprise condamnée pour emploi déguisé doit mettre la clé sous la porte.
Toutefois, cette éventualité n’effraie pas les coursiers en lutte, car en réalité leur objectif n’est pas de se faire salarier par les plates-formes prédatrices mais bien de les remplacer par des coopératives dont les livreurs eux-mêmes seraient les propriétaires associés.
Il s’agit en quelque sorte d’un retour de l’autogestion mais avec une différence essentielle : à l’époque de Lip, dans les années 70, le projet autogestionnaire était plombé par l’importance des investissements requis pour reprendre une entreprise industrielle. En revanche, comme cherche à le montrer l’association Coopcycle, à l’âge des plates-formes numériques et des applications, la mise de départ nécessaire pour faire fonctionner une coopérative est bien moindre.
En outre, il ne s’agit pas seulement de créer de telles coopératives mais aussi de les inscrire dans un écosystème où les acteurs coopératifs de divers secteurs coopéreraient entre eux, notamment pour accroître le capital « réputationnel » de chacune, et s’associeraient, avec l’appui de leurs usagers, pour inciter les pouvoirs publics à instituer une réglementation faite pour permettre aux coopératives de concurrencer valablement les plateformes capitalistes qui dominent leurs marchés.
En résumé, il s’agit de constituer l’économie sociale et solidaire en acteur économique et social « compétitif » plutôt qu’en supplément d’âme auxiliaire de l’économie marchande.
Cela annonce t-il un autre projet de société ?
Une esquisse en tout cas et, à mon avis, porteuse d’une leçon philosophique importante. Car il me semble qu’un imaginaire social est toujours fécondé par ce contre quoi il se bat. En l’occurrence, il n’est pas étonnant que le projet de société qui émerge dans les luttes des travailleurs « ubérisés » ne ressemble pas à celui que portaient les luttes syndicales des travailleurs salariés. L’idée de socialisme est née d’une résistance au capitalisme libéral. On peut faire le pari qu’un autre modèle social naîtra de la résistance au capitalisme financier.
Le renouveau du coopérativisme n’est pas le seul élément de cet imaginaire en gésine. S’y ajoutent – et s’y articulent – au moins deux autres mouvements tant intellectuels que sociaux.
Le premier concerne le revenu universel, qui a pour intérêt principal de proposer que l’allocation de ressources soit détachée de la condition salariale – et par conséquent de donner au gens la possibilité de choisir un peu plus librement leur voie. Le second est le mouvement qui s’efforce de réinventer la notion de communs, non pas tant pour en faire un régime de propriété distinct des propriétés privée et publique mais pour faire du commun un principe de dérogation au plein exercice du droit de propriété.
Les communs, en effet, se rapportent avant tout à l’accès, à l’accessibilité. Il ne s’agit pas de retirer leurs titres aux propriétaires mais de leur imposer de ménager un droit d’accès commun à leur propriété. De même qu’avec le revenu universel, l’objectif est de ne plus subordonner l’usage des ressources à l’affiliation au salariat ou à la détention d’un droit de propriété. On voit aussitôt les résonances entre ces deux revendications et l’essor du coopérativisme.




