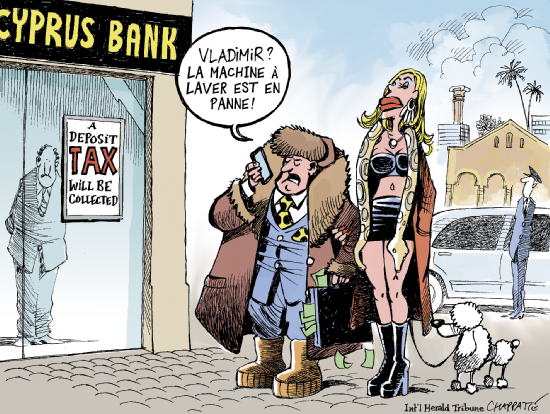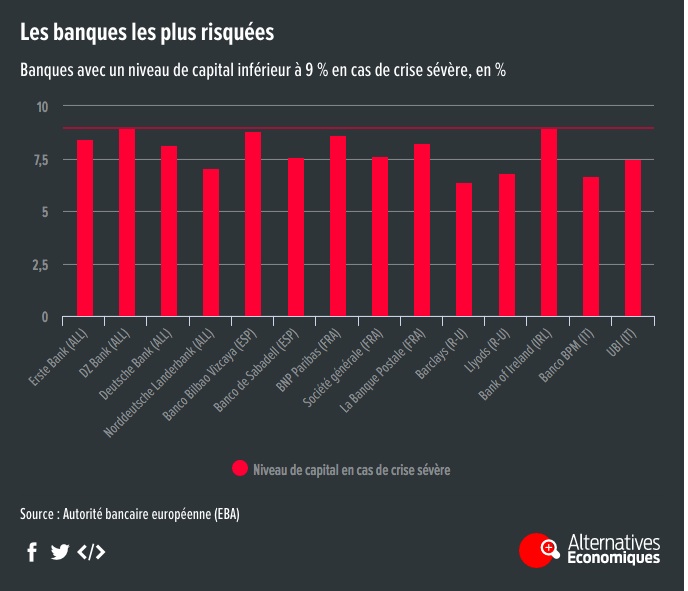Le récent mouvement des « gilets jaunes » est une véritable révolte populaire, assez peu organisée et dont les revendications sont hétérogènes. Toutefois, parmi ces revendications, l’une est de nature politique et s’est progressivement imposée : le référendum d’initiative citoyenne (RIC). Plébiscitée sur les réseaux sociaux, cette idée a été présentée comme nouvelle lors même qu’elle a, au contraire, une longue histoire – plutôt marquée politiquement à l’extrême droite – et qu’elle figurait dans les propositions de la plupart des candidats à l’élection présidentielle de 2017, à l’exception notable d’Emmanuel Macron.
On ne reviendra pas ici sur cette histoire. Notre propos est bien plutôt de prendre appui sur une recherche récente pour réfléchir au fait que le RIC est sans doute une fausse bonne idée et qu’il serait préférable de favoriser la démocratie participative plutôt que la démocratie directe. Encore faudrait-il toutefois que cette démocratie participative parvienne à exister davantage – ce qui pose la question beaucoup trop occultée du fonctionnement politique au niveau local et non pas simplement national.
Un exemple : installer ou pas de la vidéosurveillance
À l’occasion d’une enquête récente sur la vidéosurveillance, nous avons notamment examiné les mécanismes de la prise de décision qui conduisent les élus nationaux comme locaux à investir l’argent public dans cette nouvelle technologie. Et nous avons pu faire une série de constats qui peuvent contribuer à la réflexion sur le fonctionnement de la démocratie et sur les moyens de l’améliorer.
- Les élus nationaux comme locaux ne décident pas fondamentalement d’investir l’argent public dans ce type de technologies en fonction de leur efficacité déjà éprouvée, et donc à nouveau espérée (il est au contraire démontré dans l’enquête que cela ne sert presque pas à améliorer la sécurité quotidienne des habitants). Ce sont d’autres raisons qui les motivent.
- Sauf exceptions, les citoyens ne sont jamais consultés avant ces prises de décision. Au niveau national, les élus se contentent de profiter de sondages simplistes (« êtes-vous pour ou contre ceci ou cela ? ») pour prétendre que « les Français le souhaitent ». Et au niveau local, les élus préfèrent se fier aux courriers de plainte qu’ils reçoivent en mairie et aux discussions qu’ils ont au fil de leurs déplacements et réunions quotidiens. Ils ont ainsi le sentiment de « prendre le pouls » de leur commune dont ils ne côtoient pourtant en réalité qu’une toute petite partie de la population.
- Les recherches scientifiques ont montré de longue date que ces sondages nationaux expriment des opinions simplistes (puisque binaires), généralement désincarnées, plutôt conformistes et souvent politisées (les gens qui se sentent plutôt de droite répondent plutôt ça, ceux qui se sentent plutôt de gauche répondent ça, etc.).
- Lorsque l’on réalise des enquêtes avec la technique des sondages mais au niveau local, en incarnant les problèmes et en impliquant les personnes, en proposant des questions réflexives et en offrant la possibilité de réponses multiples, les résultats peuvent être très différents de ceux des sondages, voire contradictoires. Nous l’avons montré dans cette enquête sur la vidéosurveillance et, plus globalement, dans une série d’enquêtes locales sur les politiques de sécurité et de prévention menées ces dernières années dans le département des Bouches-du-Rhône.
- Dans au moins deux communes françaises – Nérac (Lot-et-Garonne) en 2011 et Aigues-Vives (Gard) en 2018 –, avant de prendre une décision, les élus (pour des raisons diverses) ont organisé un débat citoyen, en donnant à la population des éléments d’information techniques et budgétaires, en tenant des réunions publiques et finalement en organisant un référendum local sans valeur juridique. Et, dans les deux cas, une large majorité des votants s’est prononcée contre, non pas par principe mais au terme d’un arbitrage (estimant notamment qu’il y avait des dépenses plus importantes à faire dans la commune). Le résultat d’un forum local peut donc être contraire aux déductions trop rapidement faites à partir des sondages nationaux.
Le référendum et le risque d’une caricature de démocratie
Chacun s’accorde aujourd’hui pour constater que la démocratie représentative est en crise dans les démocraties occidentales. Mais ce n’est pas une raison pour en conclure que la bonne alternative est le modèle opposé de la démocratie directe, dans lequel les citoyens décident potentiellement tous par vote, le font sur tous les sujets et peuvent – en fin de compte – se passer de représentants élus. Il existe en quelque sorte une voie du milieu : c’est la démocratie participative.
Cette dernière est préférable car, au niveau national, le fonctionnement par référendum a toutes les chances de renforcer ce que l’étude des sondages d’opinion a déjà montré : le poids des arguments idéologiques, la constitution d’opinions binaires, voire manichéennes, interdisant de penser la diversité et la complexité des choses, l’exacerbation des imaginaires, des peurs et des émotions, le manque d’informations (voire la sensibilité à la désinformation)… Toutes choses qui risqueraient fort d’écraser tout véritable débat sur leur passage.
Ce serait alors une caricature de démocratie, le règne des émotions et de la politique par slogans, et finalement un boulevard pour les populismes en tous genres. Ce serait, de surcroît, un type de fonctionnement ne suscitant aucun débat réel entre les gens qui vivent ensemble. En tiendrait lieu une sorte de forum sur Internet, sur les réseaux sociaux et autres sites dits « participatifs » où pullulent déjà les propagandistes et les « trolls » en tous genres.
Nous avons désormais une bonne douzaine d’années de recul sur tout ceci et l’expérience montre que ce pseudo-débat sur Internet et les réseaux sociaux participe trop souvent à une dégradation de la qualité des discussions et, finalement, à une brutalisation des relations sociales.
Instaurer une véritable démocratie participative à l’échelon municipal
En revanche, au niveau local, le référendum apparaît comme l’issue logique d’un débat au cours duquel des personnes qui vivent ensemble dans un espace donné (la commune) ont réellement discuté, confronté leurs avis et recherché ensemble une solution à des problèmes qui touchent leur vie quotidienne. Il constitue ainsi un des leviers d’une démocratie participative qui présenterait les énormes avantages d’incarner les problèmes et d’impliquer réellement les citoyens, en les amenant à davantage se parler entre eux, donc également à admettre plus facilement la diversité des points de vue et à rechercher plus naturellement des compromis.
Autrement dit, si le référendum risque de bi-polariser encore plus les opinions et de conflictualiser encore plus les relations sociales, son organisation au niveau local peut s’articuler avec une mise en discussion collective incarnée (on ne s’adresse pas à un personnage inconnu voire anonyme sur Internet, on parle avec son voisin dans la « vraie vie »), qui tend au contraire à les pacifier.
Si la démocratie n’est pas que le choix d’une forme de gouvernement non autoritaire, mais aussi un projet de « faire société », alors il est clair que, dans un pays de 67 millions d’habitants comme la France, en ce début de XXIe siècle, le référendum local peut y correspondre. En pratique, il se heurte toutefois à tout un système de gouvernement qui brille par son immobilisme, malgré une façade de constante « modernisation ».
Sortir de la culture du chef et de la verticalité du pouvoir également au niveau local
Une demande de démocratie s’exprime de plus en plus dans un vieux pays dont le système politique apparaît non seulement usé mais aussi figé et comme incapable de se réformer. Domine toujours l’antique conception du pouvoir de type guerrier (il se conquiert dans et par « la guerre électorale ») et de type autocratique (une fois qu’on l’a, on le partage le moins possible). Le chef décide puis l’intendance suit.
Le pouvoir est vertical et les messages vont dans un seul sens : du haut vers le bas (le système top-down disent les anglo-saxons). Le fait est bien connu au niveau national et les constitutionnalistes savent, depuis le célèbre livre de Maurice Duverger en 1970, que le régime politique organisé par la Ve République ne doit pas être qualifié de parlementaire mais de « semi-présidentiel ». La critique d’une dérive autoritaire voire monarchique est ainsi consubstantielle à ce régime, de De Gaulle à Macron en passant par Mitterrand et Sarkozy. Et nombre de personnalités politiques de tous bords ont déjà appelé par le passé à la fondation d’une VIe République.
Ces débats ont, toutefois, le plus souvent un point aveugle. En se concentrant sur le seul échelon national de la vie politique, ils occultent les questions locales, où les blocages sont tout aussi puissants – si ce n’est davantage – et expliquent largement l’incapacité française à organiser davantage de démocratie participative.
Des outils en place mais détournés
C’est, en théorie, l’un des enjeux de la décentralisation : renforcer la démocratie en donnant davantage de prérogatives aux collectivités locales. Le gouvernement socialiste issu des élections de 1981 avait enclenché ce mouvement, la loi Deferre du 2 mars 1982 supprimant la tutelle des préfets sur les départements et créant les régions administratives également dirigées par leurs propres élus.
Vingt ans plus tard, le gouvernement de Jean?Pierre Raffarin prolongeait ce mouvement par la loi constitutionnelle du 28 mars 2003 consacrant l’autonomie financière des collectivités locales, transférant de nouvelles compétences aux Régions et créant deux nouveaux outils censés favoriser la démocratie participative : le référendum d’initiative locale et un certain droit de pétition (les électeurs peuvent, par pétition, demander l’inscription à l’ordre du jour du conseil municipal d’une question relevant de sa compétence).
À sa suite, la loi organique du 1?? août 2003 relative au référendum local, dans un souhait de « participation des électeurs aux décisions locales », a précisé la possibilité pour le maire ou le conseil municipal d’organiser à tout moment un référendum local pour trancher des questions relevant de la compétence de la mairie.
En théorie, la France dispose donc déjà des outils pour faire vivre la démocratie participative au niveau local. Mais il y a souvent loin de la théorie à la pratique ! Dans la réalité, la tentation est grande pour les élus locaux (comme l’avait bien montré Marion Paoletti) d’instrumentaliser ces référendums locaux, d’en faire une sorte d’instrument de légitimation de décisions déjà prises ou de les transformer en des sortes de plébiscites.
Et puis, malgré la loi de 2003, les maires ayant utilisé la possibilité de faire des référendums locaux se comptent sur les doigts des mains en quinze ans. La méfiance envers les citoyens prédomine chez les élus. La démocratie locale est figée, comme l’a montré Michel Koebel. Pire encore : les gouvernements successifs récents ont multiplié les échelons intermédiaires de décision en créant des communautés d’agglomération (loi du 12 juillet 1999), des établissements publics de coopération intercommunale (EPCI, loi du 16 décembre 2010) et enfin des métropoles (loi du 27 janvier 2014).
Résultat : loin de renforcer la lisibilité des prises de décisions et la démocratie participative, ces réformes ont au contraire conduit à un renforcement de la confiscation du pouvoir de décider par les élus et les techniciens locaux, le tout de façon encore plus discrétionnaire (loin de tout débat citoyen local). C’est ce que Fabien Desage et David Guéranger ont appelé « la politique confisquée ».
Budget participatif et droit de pétition : des innovations intéressantes mais peu opératoires
Certes, dans ce tableau particulièrement sombre émerge l’initiative très intéressante des budgets participatifs, initiée à Porto Alegre (Brésil) en 1989, reprise en France dans les années 2000 par des municipalités de gauche et qui s’étend désormais à d’autres courants politiques. L’expérience est intéressante à beaucoup d’égards (voir par exemple la vidéo de ce débat). Toutefois, il semble très exagéré de parler de « révolution citoyenne ». Deux limites de cette expérience sont en effet plus qu’évidentes.
Premièrement, l’expérience ne concerne que quelques dizaines de communes en France (sur près de 36 000…). Et, deuxièmement, la part des budgets alloués et donc des projets concernés est plus que limitée. À Brest, par exemple, le montant alloué par la ville à cette forme de participation est de 3 % de l’investissement – ce qui correspond à 0,3 % du budget annuel de la ville.
Enfin, quant au droit de pétition, au niveau national cette fois-ci, organisé par la loi organique du 28 juin 2010, il prévoit une procédure particulière puisque les pétitionnaires (au moins 500 000 personnes majeures, de nationalité française ou résidant régulièrement en France) doivent saisir le Conseil économique, social et environnemental (CESE) sur « toute question à caractère économique, social ou environnemental ». Ce dernier doit ensuite la discuter en interne et éventuellement décider de la valider par un vote en séance plénière, avant de la transmettre au premier ministre ainsi qu’aux présidents de l’Assemblée nationale et du Sénat.
De nombreuses pétitions ont ainsi été réalisées ces dernières années, mais à notre connaissance aucune n’a débouché sur une quelconque action législative. L’activité du CESE est, hélas, largement invisible politiquement et médiatiquement, y compris lorsqu’il tente de s’emparer de l’actualité des problèmes sociaux comme il l’a fait avec les « gilets jaunes », ne dénombrant que 25 000 participations entre la mi-décembre et début janvier (quand, par exemple, des vidéos postées sur Internet et les réseaux sociaux sur ces mêmes sujets font des centaines de milliers voire des millions de vues).
L’échec récurrent de la participation en France
À tout cela, il faut ajouter le constat classique fait par les chercheurs (voir par exemple ici, ici et encore là) ayant évalué les politiques de la ville au fil des ans et des réformes (la dernière en date étant la création de « conseils citoyens » dans les quartiers prioritaires par la loi du 21 février 2014). De tous les aspects de ces politiques menées depuis les années 1970, celui qui conduit à un constat d’échec récurent est précisément « le volet participatif ».
On est loin en France de pratiquer ce que les Nord-Américains appellent de longue date l’empowerment. Le constat dressé par exemple par le sociologue Thomas Kirszbaum est limpide :
« La France se singularise dans le paysage international par une politique de la ville dont le caractère bureaucratique et descendant n’a fait que se renforcer au fil des ans. S’il existe naturellement des variations, d’une ville à l’autre, dans le mode de gestion des quartiers, la monopolisation du pouvoir par les institutions publiques – et par les municipalités au premier chef – est une donnée structurelle du “modèle français”. Ici se marque la principale différence avec d’autres modèles que l’on qualifiera de pluralistes, au sens où ils reconnaissent les collectifs d’habitants comme des acteurs légitimes du processus décisionnel ».
La participation à la française reste ainsi un processus étroitement contrôlé par le pouvoir politique, tant au niveau national qu’au plan local. Les élus redoutent l’émergence d’un véritable contre-pouvoir citoyen délibératif et ne conçoivent fondamentalement ni que l’initiative puisse partir du bas, ni que les citoyens puissent savoir mieux que les élus et les technocrates ce qui est bon pour eux, pour résumer les choses.
Et Thomas Kirszbaum ajoute :
« Toute la dynamique institutionnelle à l’œuvre de la politique de la ville française concourt à inhiber l’émergence d’une capacité d’action autonome des habitants. Toutes ses orientations de fond confortent leur atomisation, aux antipodes du développement communautaire qui vise à restaurer des dynamiques collectives, bien au-delà de ce que l’on entend par “lien social” dans l’animation socio-culturelle ».
Aveuglés par la peur du communautarisme, précise enfin Kirszbaum :
« La plupart des élus ne comprennent pas que la “communauté”, c’est ce que les habitants partagent en commun, c’est la prise de conscience de leurs intérêts communs. De même que l’on a parlé d’une “conscience de classe” à propos du mouvement ouvrier, il s’agit de faire advenir une « conscience du quartier », de transformer une force latente en force active pour échapper à la résignation et au fatalisme individuels ».
Répondre enfin à la demande de démocratie
Le mouvement des « gilets jaunes » pose avec acuité une demande de démocratie repérée de longue date par les chercheurs. On doit même parler d’une urgence démocratique à l’heure où les populismes, les nationalismes et les extrémismes gagnent du terrain un peu partout en Europe et dans le monde, conduisant à un recul des libertés et des droits fondant la démocratie. La France résiste encore à la conquête du pouvoir par l’extrême droite nationaliste, mais pour combien de temps ?
L’étude des aspirations des manifestants en gilets montre que les thèmes nationalistes traditionnels comme la xénophobie n’y sont pas prédominants. Mais qui récupérera le plus les fruits de leur colère aux prochaines élections sinon l’extrême droite ? Pour les élus de tous niveaux qui gouvernent aujourd’hui notre pays, il y a donc urgence absolue à admettre que l’expression de la démocratie par le seul vote a vécu et qu’il faut véritablement instaurer davantage de participation et de délibération dans la vie politique.
Beaucoup réclament pour cela une procédure référendaire nationale, restant ainsi figés sur le principe du vote binaire et des oppositions bloc-contre-bloc. Il nous semble, quant à nous, que c’est bien plutôt en commençant par en bas, par les échelons locaux, que l’on aurait une chance de faire vivre une véritable démocratie, participative et délibérative, qui contribue du même coup à renforcer le vivre-ensemble et à pacifier la société. On espère, sans trop y croire, que le dit « grand débat national » ouvert par le gouvernement jusqu’en avril 2019 pourra au moins soulever quelques-uns de ces enjeux.
Laurent Mucchielli
Directeur de recherche au CNRS (Laboratoire méditerranéen de sociologie), Aix-Marseille Université
Source The Conversation 9 janvier 2019
 Opération Macron
Opération Macron