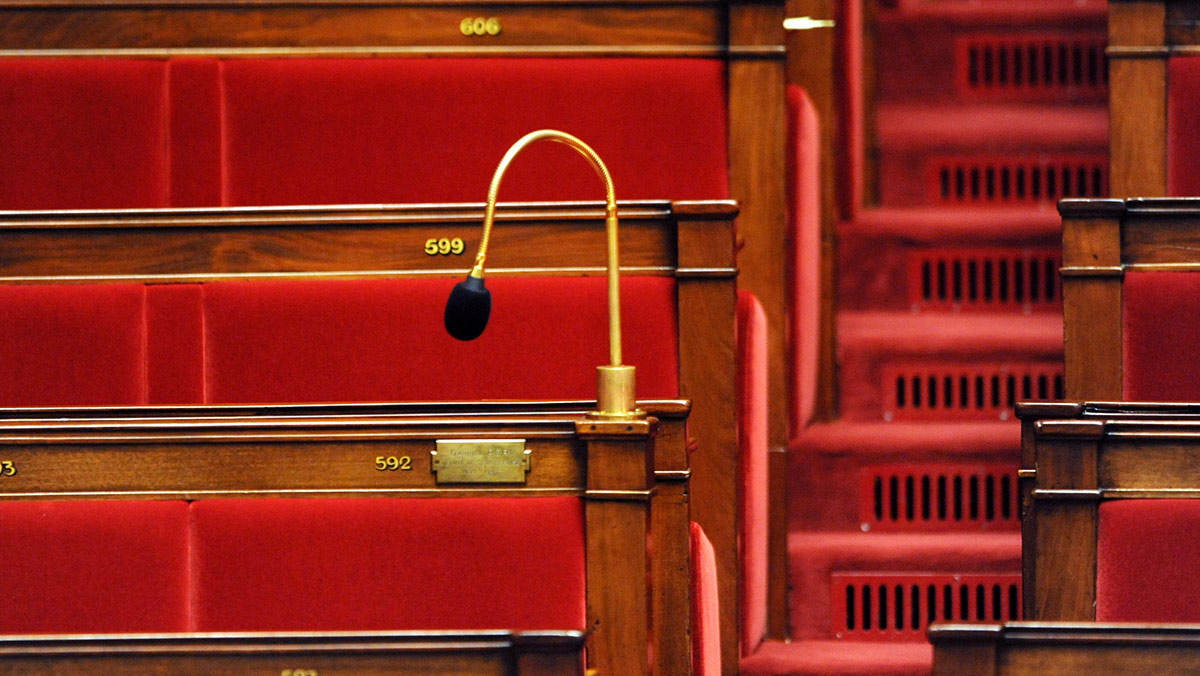Acteurs de l’économie – La Tribune. Permettre à tout individu d’être ou de redevenir sujet selon le processus d’« individuation », reconnaître le caractère inaliénable et singulier de la personne humaine, et ainsi établir le principe d’« irremplaçabilité » de l’Homme grâce auquel prennent forme le sens et l’utilité de l’existence. Votre essai Les irremplaçables (Gallimard) traite de cette nécessité, qui conditionne une multitude d’enjeux : l’éducation, la considération de l’essentiel, le rapport au pouvoir, la relation au temps, la salubrité de la démocratie, le modèle capitaliste… Irremplaçable : l’individu l’est-il aujourd’hui moins qu’hier ?
Cynthia Fleury. Le phénomène de « chosification » de l’individu n’est pas nouveau mais depuis une vingtaine d’années, nous assistons à son retour, et à son accroissement, via des dynamiques et des procédures d’interchangeabilité, qui donnent à l’individu un sentiment de désingularisation, et donc de déshumanisation. Ce mouvement a pour socle principal la révolution managériale et le renouveau de la rationalisation scientifique.
Des travaux de Jeremy Bentham (1748-1832) à ceux de Winslow Taylor (1856-1915), l’organisation scientifique du travail a toujours fait l’objet de doctrines convergeant vers cette rationalisation déshumanisante, mais le tournant des années 1960 et le besoin de s’extraire de cette chape font apparaître un souci inédit sinon d’irremplaçabilité au moins de resingularisation. Cette « respiration » ne se révèlera toutefois que temporaire ; le cadre ultraconcurrentiel et ultramarchand symptomatique du monde libéral au XXIe siècle asservit la civilisation à un diktat hégémonique : la raison économique s’impose à tout, comme l’alpha et l’omega de la vie et du sens. Tout est monétarisé.
La règle marchande et consumériste impose aux biens matériels celle du renouvellement effréné, de la substitution presque instantanée ; le principe de remplaçabilité contamine-t-il donc l’Homme ?
Absolument. « Je ne vaux rien, je me sens ou me sais totalement remplaçable et interchangeable », me confient des patients. Mais cette réalité n’est pas nouvelle, elle est seulement exacerbée. En quelle année le penseur autrichien Günther Anders rédigea-t-il L’obsolescence de l’homme ? En 1956.
Le modèle architectural « panoptique » inventé par Jeremy Bentham et son frère – édifier une tour centrale permettant aux surveillants de contrôler sans être vus les prisonniers incarcérés dans des bâtiments disposés en arc de cercle – fut déployé à d’autres fins que les geôles, notamment dans les écoles, les hôpitaux et les manufactures industrielles. Partout où se concentraient la hiérarchie des individus, la présence de fortes vulnérabilités et l’exercice des dominations. Michel Foucault, dans Surveiller et punir (Gallimard, 1975), décela d’ailleurs dans cette « visibilité organisée entièrement autour d’un regard dominateur et surveillant » l’essence même du modèle disciplinaire moderne.
Le cercle de la rationalisation scientifique s’est donc extraordinairement ouvert à un nombre inédit de strates de la société. Des territoires qui en étaient autrefois davantage préservés sont désormais assujettis à la logique marchande – éducation, santé, relations affectives – et succombent à l’ultime avatar de la rationalisation : celle de la financiarisation spéculative, qui semble fasciner comme jamais. Or c’est un leurre, car la rationalisation du profit charrie son propre lot de perversion, d’échecs, d’inégalités criantes, de désillusions.
Famille, école, enseignement supérieur, association, entreprise : les espaces d’accomplissement de la dynamique d’« individuation » – processus de création et de distinction de l’individu – s’étagent tout au long de l’existence. Quelles sont les entraves communes et singulières à ces différentes étapes ?
La dynamique d’individuation fait s’exprimer « une intelligence dans un certain contexte » ; cela signifie que ce qui est entrave à un moment particulier peut, à un autre, susciter un dépassement ou révéler une vertu. Bref, toute contrainte n’est pas entrave. Les obstacles à l’individuation peuvent toutefois être réunis sous un même vocable : la maltraitance. Une maltraitance dont les manifestations couvrent un spectre immense : manque d’attention, indifférence, refus de considérer l’interlocuteur comme un « sujet » avec lequel on établit une relation qualitative intersubjective, etc… jusqu’à l’expression la plus ultime, lorsqu’elle attente à l’intégrité morale, psychique et bien sûr physique. La maltraitance est un mode d’instrumentalisation de l’autre, qu’elle relève du cercle familial, institutionnel ou professionnel.
L’école également est un lieu de maltraitance, et notamment de récidives. Récidives des mécanismes d’inhibitions, dans le meilleur des cas sociales, et, au pire, cognitives ; à l’école en effet, on apprend trop souvent à ne penser que selon un cadre comprimant, réducteur, uniformisé. La méthode, la discipline sont totalement nécessaires au processus d’individuation, mais elles ne se confondent pas avec la désingularisation.
Quant à l’entreprise, elle a cultivé sans retenue l’instrumentalisation de l’individu. Sous couvert d’encourager l’autonomisation, l’émancipation, l’authenticité, le talent, la réalité de chaque salarié, les systèmes d’organisation du travail et de management ont exacerbé son individualisme et son isolement, ils l’ont mis délibérément en danger notamment en faisant voler en éclats les stratégies collectives de défense et en enfermant ce « sujet » dans une perspective exclusivement utilitariste et subordonnée. En d’autres termes, « comment vais-je m’employer à faire de cette singularité un client ou un travailleur encore plus assujettis ? », s’interrogent la plupart des directions d’entreprise.

« L’école est un lieu de maltraitance, mais aussi de récidives des mécanismes d’inhibitions, au mieux sociales au pire cognitives. »
L’éducation constitue la condition peut-être la plus déterminante à la réussite d’un parcours d’individuation. Quels sont les principaux fondements d’une éducation à l’individuation ? Et dans un monde inédit voire totalitariste d’ultra-compétition, est-il possible d’éduquer à ne pas être réduit à un simple agent de compétition, à un agent en survie plutôt qu’à un agent bâtisseur ?
Chaque parent est en prise à des conflits de loyauté et de légitimité forts. En effet, nous sommes pleinement conscients des insuffisances (morales, culturelles…) et des dangers (compétition mortifère, inégalités aggravées, technologisation tentaculaire, déshumanisation économique) dont nous voulons préserver nos enfants. Mais pour cela, il faudrait quasiment les extraire dudit milieu, compétitif et parfois sclérosant, de la société. Or c’est délicat, et lourd de conséquences quasi irréversibles.
En fait, le système éducatif marie les antagonismes et les oxymores comme nul autre : il fournit des armes à la fois pour être acteur assumé et conquérant de cette compétition (ou sa victime), et pour imaginer la déconstruction de cette compétition et la naissance de nouveaux territoires d’épanouissement. Démultiplier les modèles d’apprentissage scolaire, les diversifier, aiderait à déscléroser nos mécanismes éducationnels. La famille a aussi un enjeu-clé : offrir la capacité à l’enfant de résister aux injonctions de ce contexte ultracompétitif hégémonique, ne pas être l’objet de sa disqualification, et surtout l’éveiller à remettre en cause et à dépasser cedit contexte que l’on sait intrinsèquement destructeur.
Entrer dans un processus d’individuation exige de voyager très loin au fond de soi. Et ainsi d’accepter de se mettre en risque voire en danger en allant creuser là où sont nichées les vulnérabilités qui « font » trésor. Connaître et se connaître impliquent, le démontrez-vous d’ailleurs, « d’être en risque », ce risque qui fonde la valeur et la densité du souci de soi. La hâte, la superficialité, la technologie numérique, le matérialisme mais aussi l’obligation de performance et de solidité qui caractérisent la civilisation occidentale en constituent-ils un obstacle « dépassable » ou rédhibitoire ?
Rien n’est jamais rédhibitoire, mais tout a un prix. Et celui de l’affranchissement est considérable. En effet, contester le réquisit de la performance et de la compétition et s’en extraire a pour conséquence d’être aussitôt placé en accusation. Refuser de se soumettre à une telle évaluation, c’est prendre la décision d’être non pas soupçonné d’avoir une valeur autre, mais catégorisé sans valeur. C’est prendre le risque d’une mort sociale. La marge de manœuvre est donc en réalité extrêmement étroite, et même quasiment inexploitable.
Que font, in fine, l’immense majorité des individus ? Soit par aveuglément soit par résignation consciente, ils se mettent au service de cet ordre suprême de la performance, seul à même de leur permettre d’être « reconnus ». Et la reconnaissance est ici bien plus que sociale : elle est ontologique, elle conditionne le regard que vous portez sur votre propre être, et le lien que vous fondez avec tout autre et donc avec l’ensemble de la société. Qui est prêt à payer ce prix de l’affranchissement, qui a pour noms isolement, non reconnaissance, solitude ? Les ermites ou certains marginaux ? Ceux qui ont renoncé à ce que nous faisons tous : négocier, c’est-à-dire faire les arbitrages et trouver les compromis grâce auxquels on conserve un peu d’intégrité dans un système qui s’emploie à la nier.
Quelle est votre estimation du « bon risque », mais aussi de la « bonne instabilité », de la « bonne précarité » qui déterminent notamment la faculté d’entreprendre ? Principe de précaution qui a outrepassé ses prérogatives initiales, sécurité de l’emploi dans un secteur public ultracorporatiste et dont certains privilèges sont devenus indicibles, garanties excessives exigées par les systèmes bancaire ou assurantiel, pressions morales de toutes sortes : est-on encore encouragé à « être en risque » ?
Jamais le monde occidental n’a dénombré autant de millionnaires, comptabilisé autant de richesses, accumulé autant de PIB – le fameux indice censé faire la démonstration de la bonne santé des nations -, fait naître et aggloméré autant d’intelligences et de qualifications… et pourtant la plupart des disparités demeurent considérables, et certaines mêmes s’aggravent. La « crise » a bon dos, c’est-à-dire que le vocable est opportun pour qui veut dissimuler ses réalités et ses manifestations dans leurs détails.
Or justement, l’examen de ces détails révèle qu’une partie du monde est performante dans la précarité – grâce à ses revenus, son niveau de qualification, son origine sociale, etc. -, et fait supporter aux autres, globalement démunis, les répercussions néfastes de cette précarité. Tout le monde n’est pas armé de la même manière pour tirer profit du risque. Et surtout le « risque » n’est pas reconnu dans sa pluralité. Ceux qui supportent le risque aujourd’hui, ce sont principalement les travailleurs précarisés.
Est-il acceptable que du bondissement du nombre de working poors résulte l’enrichissement supplémentaire de dirigeants et actionnaires d’entreprises ? Doit-on tolérer cette précarité structurelle qui développe des logiques et des outils « incapacitaires », enfermant ses « détenus » dans une course pour honorer les injonctions du court-termisme, telle une pyramide de Ponzi ?
La mondialisation n’est pas pour autant « que » dégâts, et parmi ses bienfaits il faut retenir la mobilité, c’est-à-dire l’opportunité et la faculté d’investiguer bien au-delà de son territoire, de sa culture, de son pays, de son économie d’origine. Mais là encore, attention : croire que nous sommes égaux face à cette belle perspective est un leurre. La mobilité ne repose pas sur un accès totalement démocratisé et équitable aux outils qui permettent de la vivre. Quiconque n’est pas bilingue, ne maîtrise pas le numérique, n’a pas accès aux bons circuits d’information, est disqualifié. Travailler à juguler ces écarts est un devoir pour l’Etat et tous les rouages – y compris bien sûr l’entreprise – de la nation.
S’individuer, c’est s’extirper de sa « minorité » – l’incapacité de se servir de son entendement sans la direction d’autrui -, c’est être en dynamique d’autonomisation pour s’accomplir. Et être libre. Cette minorité fut contestée avec bonheur au Siècle des Lumières ; trois cents ans plus tard et au-delà des apparences, ne s’est-elle pas réimposée, sous d’autres formes ?
Dans le sillage des villes, des métiers, des structures du travail, des classes sociales, la société contemporaine est frappée de « déshomogénéisation ». Il ne s’agit pas là d’une régression, mais simplement d’un fait, aussi massif qu’incontestable, lié à la mondialisation. Ses effets sont accentués par l’exacerbation des identités culturelles, des communautés et des blessures narcissiques de toutes sortes, par l’égalitarisation des conditions d’existence, la crise des autorités, le sentiment croissant de défiance à l’égard de la science, le retour des idéologies et des religions, etc. Tout cela compose un volcan.
Justement, si l’on considère que le processus d’individuation et donc de singularisation permet de juguler la loi du déterminisme social et culturel, faut-il juger, à l’aune des inégalités sociales à la naissance toujours aussi élevées, que ce processus s’exprime très faiblement ou que certains obstacles à son accomplissement sont insurmontables ?
Nous continuons à assimiler l‘individualisme et l’individuation. Or le premier sert très vite les idéaux pervertis des mécanismes néolibéraux, alors que la seconde les décrypte et les déconstruit. L’individuation est une « capacité critique » qui ne conteste nullement le sentiment d’affiliation, sauf qu’elle privilégie l’appartenance symbolique, celle qu’elle réinvente plutôt que celle dont elle « s’origine. » Ce qu’il faut comprendre, c’est ce lien intrinsèque entre les sujets et l’Etat de droit ; ce dernier se nourrit de leur individuation, sans elle, il ne peut se revitaliser. Les obstacles à l’individuation ne sont pas insurmontables, ils sont simplement culturellement, sociologiquement, très ancrés. La valeur de l’individuation est à légitimer, dans sa dimension psychique et politique.
Le travail forme un terreau fertile, mais l’organisation du travail et les injonctions qui l’encadrent – productivité, performance, compétitivité, rentabilité, mobilité, docilité, etc. – souvent assèchent le potentiel de réalisation et d’émancipation. Le sens d’un métier peut être effacé par le déficit de sens de l’organisation qui sert de support à l’exercice dudit métier. De nouvelles formes d’organisation du travail voient le jour, qui tentent de conférer à la singularité toute sa richesse. Font-elles espérer la réconciliation de l’Homme et de l’entreprise ?
Absolument, même s’il faut raison garder ; ce qu’elles représentent est encore trop faible et ne pèse guère face aux entreprises ligotées aux règles déshumanisantes. Toutefois, par conviction véritable, pour répondre aux pressions des consommateurs ou aux injonctions de la RSE (responsabilité sociale et sociétale), les collectifs de travail sensibles à des organisations managériales reconnaissant les vertus de l’individu singulier semblent de plus en plus nombreux. Même des multinationales commencent à admettre que cette reconnaissance sert l’efficacité d’ensemble de l’entreprise.
« Devenir un collaborateur, c’est devenir remplaçable, c’est entrer dans la chaîne et vivre sans avenir, c’est vivre comme si l’avenir disparaissait. » Ce propos de Günther Anders dans L’obsolescence de l’Homme doit-il signifier que le principe de collaboration, axe cardinal de l’organisation, du management, de la culture même des entreprises est un non sens, ou plutôt n’a pas de sens éthique – cette éthique que vous qualifiez être « le Réel auquel l’Homme n’a pas accès lorsqu’il renonce à son irremplaçabilité » ?
Günther Anders comme Hannah Arendt ont exploré les ressorts de la banalité du mal et mis en lumière le processus de désubjectivation : dans quelles circonstances et pour quelles raisons décide-t-on de ne pas ou de ne plus être sujet, c’est-à-dire de se soustraire à l’exercice et à l’« assumation » de ses responsabilités ? Les « cas » d’Eichmann et d’Eatherly sont emblématiques : le premier, fonctionnaire zélé, a dirigé la logistique et l’administration de la « Solution finale » et le second pilota l’un des avions d’assistance de celui qui largua la bombe atomique sur Hiroshima. Leurs arguments face à leurs responsabilités de l’indicible ? Totalement opposés : Eichmann, c’est le déni, le fait d’avoir exécuté les ordres, d’avoir été un « rouage » – sous-entendu : un autre aurait fait la même chose. Earthely, c’est l’impossibilité à accepter l’horreur de son geste, et sa folie grandissante devant une société qui ne veut pas reconnaître sa propre horreur.
Tous deux, face à des injonctions étatiques humainement inconcevables, justifièrent l’abdication de leur sujet en employant des trajectoires très différentes. L’Américain voulut faire acter la défaillance profonde de l’Etat de droit – il en deviendra fou -, l’Allemand quant à lui tergiversa sans cesse lors de son procès (à Jérusalem en 1961) et en réponse aux appels des magistrats à resubjectiver les actes de son passé nazi : incapable d’assumer son « sujet » dans certaines circonstances – celles qui l’interrogent sur l’Histoire avec un H majuscule -, totalement « sujet » dans d’autres – celles qui sollicitent sa petite histoire personnelle. Cette capacité à cliver, à être sujet et non sujet au gré des contextes et de son intérêt, est la preuve qu’il n’était pas fou et était en pleine conscience.
Cet exemple incarne la problématique de la responsabilité. « S’individuer, c’est prendre conscience que l’on doit au monde », rappelez-vous d’ailleurs. Le monde, c’est la planète et c’est aussi sa famille, c’est le paysan d’Afrique et c’est aussi son voisin, c’est une ethnie entière et c’est aussi son collègue de travail… S’individuer modifie notre conception des droits et des devoirs dans le sens d’une plus grande responsabilité…
Indéniablement. Et c’est pourquoi l’évocation du double cas d’Eichmann et d’Eatherly n’est pas une digression ; elle illustre la question, fondamentale, de l’engagement dans le récit collectif. Et il ne faut pas croire qu’elle n’est pas riche d’enseignement, même appliquée à un contexte en apparence plus anodin, comme l’entreprise. Chaque jour, dans le monde du travail, il est proposé au sujet soit d’assumer sa responsabilité, soit de s’en défausser. Certes nous ne sommes que les maillons d’une chaîne – sur la planète, dans sa ville ou sa communauté, sur son lieu de travail, etc. -, mais utiliser cette réalité pour se décréter ou être considéré interchangeable et ainsi fuir ses responsabilités, est fallacieux.
« Dans quelles circonstances décide-t-on de ne pas ou de ne plus être sujet, de se soustraire à l' »assumation » de ses responsabilités? Eichmann, maître d’oeuvre de la Solution finale, est un cas d’école. » Ici, lors de son procès. (Crédits : Flick’r / The Huntington Theatre Company)
« Etre irremplaçable, ce n’est pas refuser d’être remplacé, c’est simplement avoir conscience de son caractère irremplaçable », rappelez-vous. Personne n’est irremplaçable, chacun est indispensable. Notamment dans la tête des créateurs d’entreprises, le principe d’irremplaçabilité se confond parfois avec la notion de toute-puissance, et surtout devient un obstacle au cheminement des salariés vers leur propre individuation. Dans un environnement dominé par l’image, le marketing, les médias, et qui sacralise performance, narcissisme, vanité, cette confusion des genres prend-elle une dimension inédite ?
Ce monde contemporain est en effet frappé de folie narcissique immense, nourrie par un mythe de la personnalisation extrême. Il est celui du spectacle – ce n’est bien sûr pas nouveau, comme pouvait l’illustrer toute cour des rois qui était un théâtre permanent -, mais sous le joug d’un système panoptique qui superpose les écrans dans le prisme desquels chacun est sous l’œil de chacun, le phénomène s’est amplifié de manière inédite.
Tout désormais est « accélération », notamment des existences, tout est « marchandisation » de la célébrité ou de la notoriété par la faute desquelles chacun devient son propre outil de « chimérisation » et donc cherche lui-même à devenir marque, à être repéré comme produit à forte valeur ajoutée. Les réseaux sociaux et les followers – qui non seulement établissent notre notoriété mais conditionnent la reconnaissance de ce que nous faisons – forme une impressionnante mise en scène de l’ego, et cela même malgré soi : difficile de s’extraire, là encore, du diktat de la visibilité et de la traçabilité pour faire connaître et valider auprès du plus grand nombre ce que l’on entreprend ou expérimente, sans en payer le prix fort.
Se retirer du jeu de l’hypervisibilité est compliqué, subir l’hypervisibilité est invivable. C’est cette double contrainte qui produit une hybridation psychique, nullement nouvelle, mais exacerbée entre les complexes de toute-puissance et ceux d’infériorité.
Il n’y a pas de possibilité d’individuation si le temps que l’on donne à cheminer vers soi est furtif ou trop rare. Le rapport au temps est pluriel et contrasté, l’impression est que nous dominons un temps qui en réalité ne nous a sans doute jamais autant asservis, et le temps semble avoir pour vocation première justement celle de nous écarter de cette rencontre avec nous-mêmes. Hannah Arendt n’avait de cesse de dénoncer la quasi disparition de la scholè, le « temps pour soi ». S’il existe un domaine qui semble avoir irrémédiablement échappé à notre souveraineté, c’est bien celui-là…
Le temps est capturé, et d’ailleurs cette confiscation est particulièrement préoccupante et pénalisante, puisque le temps forme le premier espace vital de l’homme, il est sa véritable « maison ». Dépossédé d’un toit ou d’un lieu physique, l’individu peut en trouver un ailleurs ; c’est loin d’être aisé, mais je crois que la création d’un « temps propre » est encore plus menacée et porteuse de conséquences fâcheuses. Le premier responsable de cette confiscation est l’obligation de productivité, et la principale conséquence est l’abandon du souci de soi et de la capacité critique à contester cet outil de production. La lutte pour récupérer ou reconquérir du temps pour soi est un acte politique majeur.
« Google, Apple, Facebook, Starbucks, n’auraient pas pu élaborer leurs montages d‘optimisation fiscale sans la complicité du ministère du Budget. »
Dans quelles proportions le processus d’individuation conditionne-t-il la faculté créatrice ? Comment, notamment dans l’entreprise, peut-on donner une concrétisation collective et tirer la quintessence commune aux processus personnels d’individuation ?
Etre individué ne signifie pas forcément être davantage « équipé » pour créer. Le processus créatif résulte de racines, de ressorts, de moteurs extrêmement variés. Ensuite, il y a plusieurs façons de « créer », de faire œuvre : la fraternité, comme l’art, est une œuvre fondamentale. Certains seront des « accoucheurs » de la créativité d’autrui, des Pygmalions, d’autres encore seront des muses, etc.
Quel est l’enjeu de la création si ce n’est de s’extraire de la rivalité mimétique et de faire émerger un désir propre ? Cet inattendu, cette insubordination, cette culture de l’expérimentation – économique, managériale, mais surtout existentielle – qui bouscule la stratégie planifiée, l’entreprise doit avoir pour dessein de les favoriser plutôt que continuer à les décourager. Pour cela, elle doit accepter que le profit ne soit pas la finalité de sa stratégie mais simplement un moyen au service d’une invention sociale plus déterminante.
Le débat sur la nécessité ou l’utilité du travail dominical a basculé. Il y a encore une dizaine d’années, les vertus du repos dominical – du temps commun à tous (ou presque) pour penser à soi et avec l’autre, et pour prendre ses distances, un jour par semaine, avec le rouleau-compresseur consumériste et productiviste – l’emportaient ; au nom d’injonctions économiques mais aussi de la liberté pour l’individu de faire le choix de travailler le dimanche, elles se sont effacées. Est-ce symptomatique d’un bouleversement profond de la société en faveur du plaisir strictement personnel, strictement immédiat, strictement matérialiste ?
Ne nous leurrons pas : personne ou presque n’aspire à vouloir coûte que coûte travailler le dimanche, et ce volontariat a pour seule motivation, compréhensible, la gratification pécuniaire – pour beaucoup, soumis à des salaires ou à des temps partiels peu rémunérateurs. Ceci étant, la généralisation et donc la banalisation du travail dominical ne sont pas sans conséquence sur la manière dont nous partageons notre temps libre.
Le dimanche n’était pas trop « monétarisé », pas trop « marchand » ; aujourd’hui, il devient un jour où l’on consomme encore plus. Le repos, ce n’est pas seulement l’absence d’activité, c’est aussi un certain type de partage avec autrui. Il faut veiller à maintenir une société dans laquelle partager, hors d’un système marchand, socialement et humainement des respirations hebdomadaires, en famille ou entre amis, n’est pas aléatoire.
L’atomisation des règles infecte nécessairement l’affectio societatis, et est donc propice à enflammer certains maux dans la société : abandon, solitude, violences, dépressions, etc. Assurer à chacun sa liberté de travailler est essentiel, mais il faut aussi admettre qu’il n’existe aucune vie sans limites, sans construction d’espaces et préservation de temps communs. Ces espaces et ces temps évoluent bien sûr au gré de l’histoire, ils doivent être pensés indépendamment des institutions, et notre époque propice aux « co », et notamment à la co-élaboration, peut d’ailleurs se révéler créative en la matière. Mais la sanctuarisation de cet affectio societatis (même s’il est profondément plastique) est capitale et incontournable.
Le verbe et le substantif pouvoir ne portent pas le même sens. Pouvoir utilement pour soi et les autres exige d’être en rapport à un pouvoir adéquat. De quel substrat éthique et moral, politique et législatif, faut-il encadrer le triple exercice du pouvoir, de l’autorité, de la discipline pour qu’ils soient utilité personnelle et collective, pour qu’ils fassent éclore ou grandir l’être sujet plutôt qu’ils ne le vassalisent et l’instrumentalisent, pour qu’ils fassent lien social plutôt que domination ?
Désubstantialiser « le pouvoir » est une condition essentielle pour s’affranchir d’un rapport idolâtre, fallacieux, duplice audit pouvoir. Le pouvoir est une réalité complexe et ambivalente. Il est circulaire, il n’est pas l’apanage d’un seul, mais d’un réseau dans lequel les membres s’adoubent réciproquement. Il est renforcé par nos croyances dans son inéluctabilité alors qu’il est un artefact, fabriqué de toutes parts par les dominations symboliques et socio-économiques. Ses mécanismes relèvent d’une religion continuée, soit d’un même type de croyances, de fascinations, et de soumissions volontaires.
Á l’inverse, le verbe « pouvoir » signifie la dynamique de transformation, à laquelle il est essentiel que le plus grand nombre souscrive et participe. Essentiel, afin qu’une action concrète en résulte, et cela nécessite au préalable que ces producteurs du verbe pouvoir soient organisés. L’autodiscipline est le meilleur allié du faire, au sens où c’est une vertu opératoire, qui permet de rendre possible et efficace ce faire.
Quant à l’autorité, elle forme un pilier de la démocratie. Elle est ce surcroît conféré à des individus ou des institutions que l’on juge « légitimes » pour nous représenter, ou nous accompagner dans notre propre cheminement d’apprentissage, ou encore auxquels on se réfère pour organiser la cité, et plus généralement nos vies. L’autorité nous permet de devenir « auteurs », à notre tour. C’est le contraire de l’autoritarisme.
Le processus d’individuation interroge d’ailleurs en profondeur les manifestations de la domination, il met en lumière le rapport dominant-dominé. Ce rapport, quels en sont les fondements, les ressorts, les langages, les manifestations en 2016 ? Sont-ils fortement distincts de ceux du XXe siècle ? Et à partir de quels outils les dominants contemporains agissent-ils pour inféoder, réussir « l’entreprise de démolition » qui consiste à « cesser de croire en sa propre irremplaçabilité pour devenir un irremplaçable chaînon », bref pour imposer une nouvelle forme de totalitarisme ?
Les outils et les méthodes de la domination ont bien sûr fortement changé. Ils sont plus diffus et pernicieux, moins visibles ou « saisissables », et prennent essentiellement la forme de vexations symboliques, d’humiliations répétitives et ordinaires, de dévalorisation de soi, de paupérisation orchestrée. C’est ce mélange incessant qui produit une grande usure, voire une érosion de soi.
Prenons le cas, en apparence anodin, des avantages ou privilèges suivants : taille du bureau, place de parking, invitation à déjeuner ou « qualité » de la considération publique par un supérieur, manière de saluer, usage arbitraire du « tu » ou du « vous », possibilité d’accéder à l’enceinte dans laquelle on travaille facilement, bref quantité de signaux inutiles qui concomitamment bonifient ceux qui en bénéficient et relèguent ou discréditent les autres. Ces vexations narcissiques passent par l’attitude, le langage ou le geste, elles constituent des humiliations impalpables, bien sûr impossibles à dénoncer ou à poursuivre juridiquement. Or elles peuvent être d’une grande douleur pour ceux qui les éprouvent, surtout injustement et depuis longtemps – elles peuvent démarrer dès la petite école, notamment lorsqu’elles sont un reflet et donc la reproduction des inégalités sociales.
De telles stratégies insidieuses de disqualification exhortent ou convainquent la victime, à qui « on » fait prendre conscience qu’elle est niée ou dégradée, de s’enfermer dans l’acceptation de sa condition, de s’auto-censurer. Commence alors un travail, patient et long, pour déconstruire ces vexations sans produire d’amertume ou de colère, et trouver l’accès à sa propre individuation, et à un possible engagement, régénérant, dans la cité.
Parfois, ces vexations révélatrices de dominations trouvent un support, une caisse amplificatrice voire même une légitimité là où on ne les attend pas. Par exemple au sommet de l’Etat (de droit)…
Effectivement. Google, Apple, Facebook, Starbucks en sont l’illustration. Voilà des entreprises qui, par le truchement de sociétés intermédiaires basées qui en Irlande qui aux Pays-Bas, se soustraient à leur devoir d’impôts sur les bénéfices dans les autres pays d’Europe, dont bien sûr la France. Or ces montages d’optimisation fiscale ne peuvent être élaborés sans la complicité, délibérée ou subie, des ministères du Budget. Imagine-t-on les dégâts que ce tel cautionnement public d’un acte immoral voire délictueux provoque dans l’opinion ? Comment dans ces conditions l’autorité – et même la légitimité – de l’Etat de droit peut-elle se maintenir ? N’est-on pas dans une configuration extrême des vexations, humiliations et autres dominations inacceptables en démocratie ? « L’arbitraire légalisé » est l’un des pires fléaux de la démocratie.
« La Gauche française est victime de la trahison de ses élites, qu’elles soient corrompues ou trop rentières. »
Si Dieu existe, est-il un dominant, un maître qui libèrent l’individu de sa minorité ou au contraire qui l’y enferment ? Son pouvoir est-il immaculé ou corruption ?
Dieu est un concept – polymorphe qui plus est – inventé par les hommes. Il est l’alibi des pires manquements humains, de leur volonté farouche à ne pas devenir sujets. Ensuite, s’il s’agit de faire du nom de « Dieu » la foi dans l’humanité, pourquoi pas, mais un tel viatique n’est pas obligatoire.
L’expérience de Mère Teresa, sur sa longue nuit de la foi, est exemplaire du doute qui étreint l’homme et le protège de ses certitudes d’ignorant. Si la foi s’identifie à une tutelle dogmatique – qui peut être idéologique ou religieuse -, elle devient délétère et même mortifère pour l’esprit humain, puisque qu’elle dispense (au mieux) et interdit (au pire) de penser librement et par soi-même. Si la foi équivaut à l’« Ouvert » du poète Rilke, à un sentiment mystérieux face au Réel, à l’accueil et à l’exploration de perspectives inconnues, alors à ce titre, elle est totalement conciliable avec la liberté de penser et de pratiquer la recherche scientifique.
Etre sujet constitue le ciment du fonctionnement d’une démocratie, séculairement considérée comme le levier d’émancipation, d’accomplissement des êtres libres. La régénération de cette démocratie, l’accès à une vitalité en perdition, n’exigent-ils pas désormais d’inverser les rôles, c’est-à-dire de réfléchir aux voies que l’individu doit emprunter pour en être acteur et non plus seulement bénéficiaire ?
L’Etat de droit et la démocratie composent un système vitaliste, qui, tel un organe de notre corps, « vit » de respiration, de sang, de muscles, de régénérations exogènes et endogènes. Et cela depuis 1789 – même si ses fondements sont plus anciens.
Cette démocratie ne vit qu’à la condition d’être sans cesse remise en question, mesurée à son passé éloigné ou récent, réévaluée, et donc revivifiée à partir de leviers nouveaux, adaptés aux spécificités (technologiques, spatiales, culturelles, économiques, etc.) de chaque époque. La démocratie du suffrage censitaire et celle du suffrage universel, celle de la France isolée et celle de la France combinant avec les systèmes de 27 autres états membres de l’Union européenne, connaissent de profondes différences. Et c’est justement parce que la complexité de l’Etat de droit est grandissante que la singularité des citoyens est encore plus essentielle pour y faire face et assurer un fonctionnement démocratique à la hauteur des circonstances et des enjeux.
Mais alors ne prend-on pas le risque du chaos ? En effet, s’individuer exhorte à (se) révéler toutes les poches de singularité, mais aussi les aspirations ou exigences propres à l’émancipation et à la réalisation de soi qui lui sont associées. Or « faire société » impose des renoncements, des retraits. A force de célébrer les singularités de chacun, ne rend-on pas de plus en plus improbable le être ensemble et le faire ensemble ? Si chacun est autorisé à revendiquer son irremplaçabilité et la sanctuarisation de ses singularités, comment peut-on faire société ?
De nouveau, l’individuation est la conscience d’être « manquant ». Autrement dit, plus on s’individue, plus on fait société. Cette équation est inéluctable, puisque pour construire sa subjectivité, l’individu a fondamentalement besoin d’intersubjectivité. Le fameux affectio societatis nous rappelle que créer avec les et grâce aux autres est la condition même de notre existence et donc de notre survie. Le retrait, le renoncement, ne sont pas uniquement des notions arbitraires, subies. Le renoncement fait partie intégrante de l’individuation.
En revanche, il existe des « renoncements » qui ne sont que des rémanences de domination sociale. Il ne s’agit donc pas d’évacuer la problématique du deuil ou du renoncement – grandir, s’individuer, c’est faire différents deuils -, mais de veiller à ce qu’elle ne soit pas instrumentée par la domination, socio-économique et politique. Ensuite, il y a un deuxième âge de l’Etat-Providence à fonder, illustré notamment par l’avènement d’un revenu universel affranchissant l’homme de l’obligation d’un travail pour survivre.
Le double enjeu de l’irremplaçabilité et de l’individuation inspire une lecture, une interprétation politiques, sociologiques, idéologiques et même partisanes. N’est-ce pas de l’antagonisme, insoluble, « être sujet – faire collectif » dont souffre le plus et dont est prisonnière la Gauche ?
Une partie des partisans de Gauche se sont faits rattraper par le cénacle des « dominants », ceux qui au nom de la défense des plus vulnérables en réalité ne représentaient que leurs propres intérêts. La Gauche française est victime de la trahison de ses élites, qu’elles soient corrompues ou trop rentières. Ces dernières se sont engagées dans une libéralisation effrénée de l’économie, elles souscrivent depuis plusieurs décennies à une dérégulation incontrôlée qui affecte en premier lieu ceux qui lui accordaient leur confiance. Et la gauche, plus radicale au sens premier du terme, peine à rendre lisible sa capacité de gouverner, et donc de réformer durablement.
Se mettre en chemin vers l’individuation à la fois constitue un rempart à la vacuité de la civilisation matérialiste et individualiste, et est durement malmené par cette même inanité. Parce qu’il entretient individualisme, cupidité, égoïsme et utilitarisme, le capitalisme est-il bien davantage obstacle que ressort aux principes d’individuation et d’irremplaçabilité ? Un autre modèle doit-il être inventé ?
Le capitalisme contemporain, à ce point financiarisé et dérégulé, « réifie » les humains. Il est donc totalement incompatible avec le processus d’accomplissement et de singularisation de la personne. En revanche, un capitalisme « encadré » par des règles et donc assurant une concurrence relativement non faussée, ne serait pas ennemi de l’individuation. Mais est-ce possible ?
Aujourd’hui, nous avons érigé de tels principes de compétition et de rivalité qu’ils portent en eux leurs propres débordements, dans la mesure où ce qui importe plus que tout, c’est la rentabilité à outrance, le profit sans limites. Nous sommes entrés dans un monde de capitalisme entropique, sans cesse excédant les limites de la bienfaisance, toujours prompt à l’exploitation inégalitaire des ressources et des hommes. Résultat, nous avons là un système qui promeut le vice, structurellement, qui donne de la valeur aux actes les plus amoraux. N’est-il pas hallucinant et profondément symptomatique que les normes comptables européennes intègrent désormais dans la comptabilité publique les revenus de la prostitution et de la drogue ?
Un passage de votre essai décortique les ressorts psychanalytiques de l’humour. « L’humour est révolution », il échappe au pouvoir dont « il refuse la normalisation » et qu’il « décrédibilise », le rire préfigure une pensée, une échappée, une liberté, il est à la fois solitude et solidarité, autonomie et communion. Et donc participe au cheminement vers l’individuation. Ce qui est rire et fait rire permet de lire l’état de santé psychique d’une société. Cet examen est-il source d’espérance ou d’inquiétude ?
Le rire et l’humour n’échappent pas à la marchandisation. Aujourd’hui, c’est le bouche-trou cathodique ou radiophonique par excellence. Ce rire, qui relève théoriquement de l’inattendu, de la subversion, nous avons fini par le planifier. Il est devenu omniprésent, grossièrement imposé partout où il peut combler la vacuité ou, pire, obstruer délibérément le « fond », le « vrai », « l’utile ». Le rire devrait participer à faire émerger et à nourrir le débat, finalement on l’emploie pour le museler.
Il n’y a plus de plateau télévisé sans « bouffon » pour détourner l’attention, court-circuiter les discussions et y mettre fin. Or le rire n’a pas vocation à « débrancher » nos esprits, mais bien au contraire à les « brancher ». Enfin, l’instrumentation du rire célèbre le « rire majoritaire », alors que l’essence même du rire est minoritaire. Le rire est devenu un exercice du pouvoir, tout autant qu’un enjeu de pouvoir. La manière dont nous rions dit bien sûr beaucoup des civilisations et des sociétés qui sont les nôtres.
» Le rire et l’humour sont notamment un antidote au politiquement correct ». Ici Gad Elmaleh dans une publicité bancaire.
(Crédits : Capture d’écran / Youtube)
La difficulté des humoristes d’être autorisés ou de s’autoriser à faire rire de tout, et notamment de ce qui caractérise l’identité ethnique ou religieuse, indique-t-elle une moralisation aigüe et une dégradation des libertés ?
L’espace qu’occupent le rire et l’humour participe à étendre celui des libertés. Le rire et l’humour sont notamment un antidote au politiquement correct, ils proposent une distanciation et une déconstruction face aux spectres moralisateurs et uniformisateurs, ils sont un rempart à l’aliénation. Mais tout cela, c’est essentiellement théorique. Car en pratique, ce dont la télévision et la radio nous abreuvent, c’est d’un usage politiquement correct de la polémique : chaque « contributeur d’humour » fait très attention à faire rire de certains sujets et à ignorer les plus sensibles, chaque sketch ou intervention répond à un calibrage millimétré. Même ce qui peut sembler outrancier est en vérité soumis à un conformisme extrême. Le spectacle de l’outrancier est très cadré.
La télévision est devenue la « table familiale », elle est une « caverne reconstituée » qui montre non pas le monde mais les images du monde, elle fait de l’individu un « tout-puissant servile ». Que manque-t-il pour que le progrès – technologique, médical, social, etc. – soit systématiquement amélioration de l’humanité – individuelle et collective ?
« Tout-puissant servile » : c’est incontestable. La « table familiale » ainsi décrite par Anders, dans les années cinquante, n’est plus, avec l’éclatement de la famille, des temporalités communes, et des modes de vie traditionnels. Les écrans se sont démultipliés, mettant en place des jeux d’acteurs nouveaux. Grâce aux chaînes d’information en continu, il y a comme un sentiment d’ubiquité, mais le flux continu des images, et des événements, nous « évince » de la réalité tant celle-ci, écrivait Anders, devient fantomatique, car toujours derrière un écran, prise par le flux des images, des commentaires, des nouveaux événements chassant les anciens, etc. Le sentiment d’impuissance et de servilité n’est pas antinomique de ce flot d’informations.
Heureusement, les nouveaux outils de régulation, notamment l’usage des réseaux sociaux, réinscrivent le « spectateur » dans un agir. Le digital n’est pas un « sous-monde », ou un « hors-monde ». Il sert souvent les objectifs du divertissement massifié, mais pas seulement. Il est également un nouvel outil au service de notre immersion dans le monde.
Finalement, à quelles conditions peut-on espérer être sujet empathique et altruiste, être individu non individualiste, c’est-à-dire échapper à cet individualisme contemporain « qui se vit comme le seul génie des lieux, convaincu d’être l’alpha et l’omega d’un monde qui n’a ni mystique (le sens de Dieu) ni République (le sens des autres) », cet individualisme contemporain qui donc non seulement « empêche l’individuation » mais « est une individuation pervertie » – au sens où l’individu est persuadé que la recherche de son autonomisation peut se passer de la production qualitative de liens sociaux ou qu’il est possible de l’instrumenter pour son seul profit ?
Cela relève d’une révolution culturelle majeure. Ces dernières décennies, l’idéologie néolibérale n’a eu de cesse de dévaloriser les comportements sociaux, coopératifs, non exclusivement tournés vers le profit. Soit ils étaient jugés défaillants en terme de performance économique, soit ils relevaient de l’utopie niaise altruiste. Nous nous réveillons enfin de ce lavage de cerveaux, et redécouvrons le caractère proprement rationnel de l’éthique. Celle-ci n’est pas un supplément d’âme mais une épistémologie, une manière plus juste intellectuellement et éthiquement de penser.
L’essentiel est de faire lien. D’être déterminé et disposé à aimer. Aimer est une décision, un libre-arbitre, mais aussi un travail. Aimer, c’est politique, car l’amour, l’attraction de l’autre et vers l’autre, le sens de l’autre, construisent l’être.
Vous êtes philosophe et psychanalyste, vous intervenez dans des lieux de vie très variés : dans de grands établissements d’enseignement supérieur (Ecole Polytechnique, Sciences Po Paris, HEC, American University of Paris) et au Muséum national d’histoire naturelle de Paris, au sein de la cellule d’urgence médico-psychologique du Samu ou à l’Hôtel-Dieu où vous venez de créer la première chaire de philosophie à l’hôpital. Vos « métiers » et les lieux où vous les exercez vous confèrent finalement une légitimité toute particulière pour comprendre l’Homme, l’Homme dans ses vulnérabilités et ses trésors, dans ses travers et ses aspirations, dans ses manques et ses ressources. Est-il à la hauteur des enjeux – humanité, progrès, environnement – de sa propre civilisation ?
Chaque jour est le théâtre d’un festival d’antinomies : impossible d’échapper à l’horreur de ce qui se passe internationalement, une simple lecture des rapports de la Cour pénale internationale pourrait nous faire perdre toute espérance en l’homme. Et puis, il y a ceux qui résistent, ils ne sont pas aussi nombreux, mais ils ont une telle force d’âme qu’elle nous régénère malgré les douleurs du monde. Ensuite, nous ne traversons pas tous les mêmes traumatismes. Certains ont la chance absolue d’être épargnés. Quand je dis « épargnés », je ne parle pas d’une vie douce économiquement parlant, je parle de traumatismes bien plus fondamentaux, qui relèvent de l’irrécupérable tant ils sont déshumanisants : torture, viol, exode, maltraitance infantile. Chez la plupart de ces êtres frappés par la barbarie des hommes, restaurer un sens, un espoir, une finalité dans leur existence relève de l’improbable, voire de l’impossible.
Pour ceux qui n’ont pas traversé ces expériences-limites, dépasser le découragement est plus simple. Il y a toujours quelqu’un avec lequel échanger, ou un livre que l’on peut saisir, ou une association à laquelle on peut se rattacher, ou un réseau social, en somme toujours des tiers résilients susceptibles d’accompagner la reconquête de nous-mêmes, et le désir de réinvestir le champ socio-politique.
Pour ma part, l’expérience humaine et professionnelle m’a enseigné les trésors de la philia, cette amitié politique, au sens aristotélicien du terme, qui nous permet de fraterniser et de bâtir la cité. Je n’ai pas eu de maître à penser, je n’appartiens pas à cette génération qui s’est construite dans le sillage d’un grand autre. En revanche, j’ai rencontré des collègues précieux, dont l’intelligence et la générosité ont été capitaux dans mon parcours, grâce auxquels je pense mieux, et qui chaque jour me redonnent courage simplement par le fait de réfléchir et de rire avec eux.
Ces personnalités résilientes honorent la préoccupation de « générativité » – préoccupation consciente d’avoir un impact positif et durable sur les générations ultérieures, contribution au bien-être de la communauté, responsabilité envers autrui et développement d’activités créatrices qui peuvent être remémorées par les autres dans le futur. Cette générativité fait écho au questionnement de Goethe : « Naissons-nous en dette d’être nés ? », c’est-à-dire n’avons-nous pas pour devoir de faire et de donner pour assurer à l’héritage que nous laissons des propriétés au moins aussi vertueuses que celles de l’héritage que nous avons reçu ? Le niveau de générativité observé dans vos fonctions consolide-t-il votre espérance en l’humanité ? Que les campagnes, toutes deux perdues, aux primaires françaises de 2012 pour Martine Aubry et américaines de 2008 pour Hilary Clinton aient eu pour socle le « soin d’autrui » – Care -, doit-il être interprété comme la grande difficulté, voire l’impossibilité de transformer politiquement et de faire reconnaître populairement l’exigence d’humanité ?
Le « soin », de soi et de l’autre, constitue le fondement premier de cette générativité. Or la formidable puissance destructrice de la machine capitaliste et libérale est parvenue à la reléguer loin, très loin dans l’ordre des priorités. Pire, elle est parvenue à imposer une fallacieuse croyance : le chiffre s’est substitué au sujet pour faire protection du sujet.
Dans ces conditions, faire valoir politiquement une approche holistique du soin, ou encore convaincre que la justice est le modèle de croissance, plutôt que l’inverse, est difficile. L’irremplaçabilité tente cette aventure-là. Pour ma part, si je parviens à mettre en place une ou deux poignées d’outils concrets, de mon vivant – création d’un revenu universel et de temps citoyens dans les entreprises, généralisation du bi ou trilinguisme national qui conditionne la citoyenneté européenne… -, alors je pourrai être satisfaite de ma « contribution générative. »
Voir aussi : Rubrique Philosophie, rubrique Débat, Politique, De l’Etat de droit à l’Etat de sécurité , Frénésie sécuritaire française à côté de la plaque, Politique de l’immigration, rubrique Société, Vertus et vices de la comédie sécuritaire, Citoyenneté , Rubrique Education, Rubrique Justice, La France déroge à la convention européenne des Droits de l’Homme,