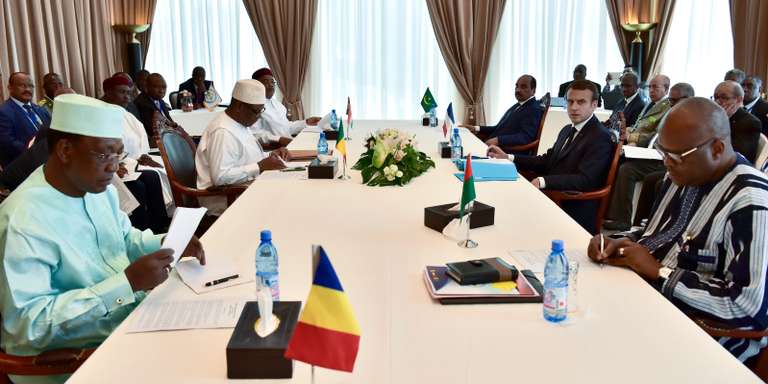Par Christian Thibon
«Les élections kenyanes font l’objet de séquences imprévues, ou du moins singulières, au regard des élections en Afrique», explique Christian Thibon, professeur d’histoire contemporaine à l’Université de Pau et des pays de l’Adour.
On note, de mai à juillet 2017, un enregistrement volontariste du corps électoral, une première campagne électorale concurrentielle sinon démocratique, un déroulement pacifique d’une journée électorale particulièrement chargée (soit six scrutins) le 6 août dans un climat sensible qui témoignerait d’une « civilisation électorale » en marche. Et, enfin, la décision de la Cour Suprême du 1er septembre 2017 d’invalider les élections présidentielles au regard des irrégularités et illégalités de la Commission indépendante électorale (IEBC).
Pourtant, cette vision optimiste autorisée par l’arrêt de la Cour suprême, d’une « institution forte » qui dévoile un Kenya innovant dans le domaine politique se heurte à un scénario pessimiste. Ainsi, le cours des événements témoigne de travers courants en Afrique : les carences des institutions indépendantes en charge des élections et une épreuve de force bipolarisée entre tenants et outsiders, entre les deux principaux candidats et leurs alliances politiques ; un bipartisme de facto déjà présent lors des précédentes élections de 2013, avec un ticket « sortant » U. Kenyatta et W. Ruto de l’alliance dirigée par le parti Jubilee d’une part, le ticket R. Odinga et M. Kalonzo de l’alliance NASA d’autre part.
Une radicalisation politico-sociale
Au lendemain du 1er septembre et loin des espérances mises dans le ressort moral de la Cour suprême, la campagne électorale ne suit pas un nouveau mode « moralisé », un nouveau cycle un peu à l’image du repentir religieux ritualisé de la campagne électorale de 2013 (l’alliance de U.Kenyatta et W. Ruto, et de leurs ethnies respectives, Kikuyus et Kalenjins, qui s’étaient opposées en 2007-2008 avait pris des formes religieuses). Bien au contraire, les « hommes forts » ont repris l’initiative, en recourant à la violence et aux ressentiments ethniques, aux manipulations et aux pressions institutionnelles, aussi bien de l’administration nationale que régionales à leur service.
Cette radicalisation politico-sociale, cette politisation fortement médiatisée sont moins tempérées, comme lors des précédentes élections, par des moments télévisés consensuels à l’exemple des débats présidentiels désertés par les candidats, ou par la médiation, l’ombre apaisante d’une société civile, des Églises, moins présentes que par le passé. Cette deuxième campagne électorale voit alors se multiplier, des deux côtés, les coups d’éclat, les renversements d’alliances et les ralliements, et les calculs politiciens visant à pousser leurs concurrents à la faute, à les déstabiliser, à les discréditer : la volonté de Jubilee, de mener, coûte que coûte, la réforme de la loi électorale, puis la décision de R. Odinga de ne pas participer aux élections prévues le 26 octobre, sans une réforme de l’IEBC, puis de se retirer s’inscrivent dans ces nouvelles règles politiques et calculs politiciens à risques pour eux-mêmes et plus encore pour la société, l’économie kenyane.
Le sentiment dangereux du « perdant sans honneur »
Aussi tous les scénarios avancés deviennent problématiques d’autant qu’ils rappellent ceux déjà vécus dans le passé (en 1992, en 1997 et plus encore en 2007-2008), craints et intériorisés dans les mémoires et imaginaires : en particulier, la peur de voir la nouvelle séquence électorale s’enliser dans une épreuve de force qui, en se radicalisant, ouvrirait un cycle de violence, de manifestations et de répression policière, d’affrontements interethniques.
Avec, au final, deux échéances probables. D’abord une crise constitutionnelle, l’infaisabilité des élections en raison d’un boycott d’une partie de l’électorat dans certains bastions. Ensuite, au soir des élections du 26 octobre prochain, et quel que soit le « vainqueur sans gloire », le sentiment du « perdant sans honneur » d’avoir été volé d’une victoire dans un pays divisé en deux selon des lignes géographiques politico-ethniques.
De plus, le contexte social et géopolitique guère favorable peut se prêter à une montée aux extrêmes : les pénuries alimentaires, les protestations professionnelles, les difficultés financières de l’État, les frustrations sociales composent un cocktail explosif. Sans compter les perturbations régionales des Chebabs.
Des partis politiques dédouanés
Pour comprendre les dynamiques d’un tel piège en cours, il faut prendre la mesure de l’événement, la nature de la décision de la Cour suprême et son contexte, ensuite intégrer une moyenne durée, les crises (et leur gestion) pré-, post-électorales du passé présent (de la démocratisation des années 1990 à celle de 2007-8) qui restent la matrice de la culture politique en œuvre.
L’arrêt de la Cour suprême a éclipsé deux aspects importants, souvent occultés, qui pèsent sur la séquence politique en cours. D’une part, bien qu’assurément symbolique, en remettant à zéro le chronomètre électoral, la décision est restée politiquement mesurée, volontairement ou involontairement. À défaut d’avoir eu accès au serveur central de l’IEBC, une demande formulée deux fois sans succès, la Cour a mesuré toute l’étendue des fraudes, des manipulations, des intrusions, des défauts dans les formulaires et PV, mais elle n’a pas donné une définition systémique et intentionnelle de la fraude, ni mesuré ses dimensions pouvant affecter le résultat final. C’est donc l’IEBC, sa direction et ses relais technologiques qui, eux seuls, sont visés.
Dans ces conditions, les partis ont été dédouanés de toute responsabilité dans ce raté électoral. Ne restent alors que des suspicions, la dénonciation médiatique et politicienne soit d’un complot systémique, soit d’un « coup civil » une sorte de « coup d’État de la société civile », des thèses avancées par les deux camps. Certes, le parti vaincu, NASA, « victime » de la fraude a bénéficié sur le moment de cette nouvelle donne : une majorité de l’opinion publique est alors favorable à un retour aux urnes mais semble se détourner des mobilisations de force. Quant au parti gagnant, Jubilee « bénéficiaire » de la fraude, bien que suspect, il n’est pas délégitimé d’autant qu’il bénéficie d’un leadership national acquis dans les autres scrutins.
D’autre part, la décision de la Cour suprême n’a pas remis en cause les autres scrutins, les élections des gouverneurs, des députés, des sénateurs, des représentants des femmes et des conseils de comtés : ces élus déjà installés offrent une forte majorité pour le parti Jubilee d’U. Kenyatta, les totaux des votes en faveur de ses candidats sont bien supérieurs à son score national. Certes, les recours et pétitions suivent une voie normale : 288 pétitions (187 en 2013), portant sur près de la moitié des comtés (gouverneur) sur un tiers des circonscriptions parlementaires, mais ces contentieux concernent des territoires plutôt acquis à l’opposition NASA. Au demeurant le scrutin le moins contesté est celui des Conseils de Comté (9 %) pour lequel les critères de leadership et de notoriété locale semblent s’imposer.
Un alignement ethnique renforcé
Aussi la décision de la Cour, qui sans conteste participe à la construction de la démocratie sur la longue durée, a des effets complexes, sinon contreproductifs, et de nature conflictuelle dans le présent. Ainsi le deuxième tour électoral-juridique a certes invalidé les élections, mais il n’a pas disqualifié les candidats. Les supporters des deux partis-alliances ont, tour à tour, fêté leur victoire et expérimenté un sentiment d’humiliation, ce qui ne fait que renforcer l’alignement ethnique préexistant, les identifications politiques et ethniques-tribales confondues.
De plus, la campagne politique qui a repris pour le parti Jubilee dès l’annonce de l’invalidation et qui ne s’est jamais arrêtée pour le parti NASA, n’a guère changé les consciences, elle les a plutôt figées.
Les stratégies politiques en miroir passent toujours par la consolidation des bastions électoraux et la mobilisation ethnique, par la conquête d’un électorat indécis dans des comtés en balance ou villes cosmopolites, par l’affaiblissement de l’adversaire au moyen de cooptations, de renversements de fidélités, par une présence médiatique enfin par le marché de la mobilisation qui suppose des moyens financiers, apparemment inégaux à la faveur de Jubilee.
La généralisation des discours de haine
Sur le fond, les lignes idéologiques et les pratiques n’ont guère changé, plutôt inspirées par les années 1990. D’un côté, U. Kenyatta et W. Ruto poursuivent une campagne de présidentiable jouant sur leur capacité de redistribution, assurée cette fois-ci du relais de leurs élus, selon un registre inspiré des campagnes des Présidents sortants ; d’un autre côté, R. Odinga continue sa campagne de pression, relancé au lendemain de l’annonce des résultats selon un registre inspiré par les mobilisations des droits de l’homme des années 1990.
Cette bipolarisation laisse libre cours à une radicalisation, à des dérapages des leaders, à des discours incendiaires de la part d’électrons libres mais proches des partis, à une montée en puissance des jeunes militants. D’une façon insidieuse, les discours de haine se généralisent sur les réseaux sociaux, même s’ils sont bridés officiellement ou dénoncés par les médias, la société civile, les églises… Cette violence réelle, bien qu’isolée mais médiatisée et théâtralisée, pose la question de la sécurité publique alors que les cadres de sécurité publique semblent défaillants, et que circulent les rumeurs de retour des milices. Celles-ci ont pris part aux violences de 2007-2008, en situation de crise, et leur retour en politique ou leur instrumentalisation sont régulièrement annoncés, en particulier pour les Mungikis.
Quelle sortie de crise ?
Au-delà de ses dynamiques piégeuses, se joue et se rejoue donc au Kenya un épisode entre la survie-affirmation d’institutions fortes et la reproduction des hommes forts, d’une certaine culture politique. Le discours de B. Obama – « l’Afrique a besoin d’institutions fortes » – et ses critiques sur les dérives du pouvoir personnel trouvent en cette occasion une nouvelle illustration. Pourtant, dans une période qui reste de facto une transition politique, le Kenya a tout à gagner à marier, à ménager une telle rigueur constitutionnelle sinon morale et l’engagement politique voire personnel de ses leaders et partis politiques. Cet équilibre instable, et par nature souvent conflictuel dans toute démocratie, repose sur des acteurs, tant sur les autorités morales judiciaires que sur les leaders et la classe politique dont les choix peuvent peser sur la situation et qui sont aussi responsables des dérives craintes.
L’interprétation de cet horizon incertain, des violences inquiétantes bien que d’intensité basse mais à forte tension émotionnelle, une bipolarisation radicalisée avec à terme une crise constitutionnelle, reste ouverte. Cette instabilité résulte-t-elle d’un concours de tendances non contrôlées, dans la suite logique de la campagne et du raté électoral ou/et découle-t-elle d’une stratégie de tensions contrôlée visant à perturber les résultats des élections, la participation électorale, à bloquer les élections… ? Ou précède-t-elle une « négociation démocratique », un pacte entre leaders ? L’histoire des années 1990 et 2007-2008 révèle que de tels scénarios ont été vécus mais aussi pratiqués sinon pensés.
Quel est le poids des garde-fous ?
Ces inconnues dans les dynamiques actuelles soulèvent la question des garde-fous, qui depuis la Constitution de 2010 ont été mis en place et jouent ou pourraient jouer l’apaisement. Les acteurs élus et bénéficiaires d’un renouvellement politique à l’échelle locale, régionale n’ont pas intérêt d’un approfondissement d’une crise, il en est de même des intérêts économiques ou des classes moyennes qui s’inquiètent de l’impact de la crise, alors que la société civile et certains acteurs politiques transversaux (voir l’Appel des Vétérans politiques à l’initiative de F. Atwoli (Cosetu) du 12 octobre) commencent à dénoncer les violences des deux camps et que la population garde en mémoire les violences de masse de 2007-2008.
![]() De tels facteurs modérateurs qui agissent en profondeur, sont-ils opérants quand les acteurs du moment, les passions, la peur et les crispations identitaires s’imposent, quand l’événement prend le dessus ? Assurément et en ces circonstances, le pays a besoin autant « d’hommes forts », « d’hommes d’État » que « d’institutions fortes ». Mais, en la matière, les définitions comme les attentes diffèrent.
De tels facteurs modérateurs qui agissent en profondeur, sont-ils opérants quand les acteurs du moment, les passions, la peur et les crispations identitaires s’imposent, quand l’événement prend le dessus ? Assurément et en ces circonstances, le pays a besoin autant « d’hommes forts », « d’hommes d’État » que « d’institutions fortes ». Mais, en la matière, les définitions comme les attentes diffèrent.
Source Géopolis 18/10/2017
Voir aussi : Actualité Internationale, Rubrique Afrique, Kenya,