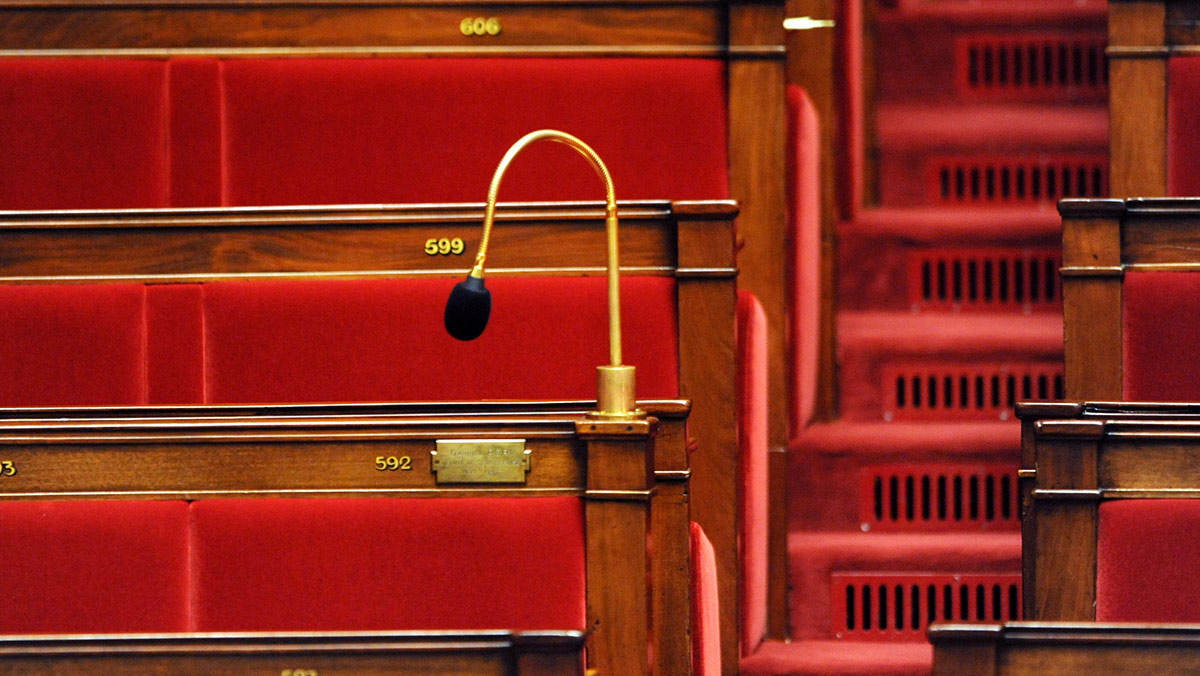Ce lundi, le journal Libération publie une tribune d’Eric Hazan et Julien Coupat intitulé : Pour un processus destituant:invitation au voyage. L’initiative est ouverte mais déterminée.
À l’inverse du processus constituant que propose l’appel publié par Libération – car c’est bien de cela qu’il s’agit –, nous entendons amorcer une destitution pan par pan de tous les aspects de l’existence présente. Ces dernières années nous ont assez prouvé qu’il se trouve, pour cela, des alliés en tout lieu. Il y a à ramener sur terre et reprendre en main tout ce à quoi nos vies sont suspendues, et qui tend sans cesse à nous échapper. Ce que nous préparons, ce n’est pas une prise d’assaut, mais un mouvement de soustraction continu, la destruction attentive, douce et méthodique de toute politique qui plane au-dessus du monde sensible.
« Mais les vrais voyageurs sont ceux-là seuls qui partent
Pour partir ; cœurs légers, semblables aux ballons,
De leur fatalité jamais ils ne s’écartent,
Et sans savoir pourquoi, disent toujours : Allons ! »
Rapide comme l’éclair, lundimatin a décidé de prolonger cette invitation en offrant quelques pièces au débat. À n’en pas douter, la déréliction générale de la gauche amènera tout un chacun à adhérer à cette nouvelle théorie de la destitution, cependant, reconnaissons que le concept est encore bien flou et que certains éclaircissements sont de rigueur. À cette fin, nous avons décidé de publier cette intervention inédite de Giorgio Agamben. À l’été 2013, sur la plateau de Millevaches, était organisé un « séminaire » intitulé : Défaire l’Occident. Environ 500 participants avaient discuté une semaine durant du cours du monde et souvent même de son effondrement. Il s’agissait de clarifier théoriquement un certain nombre de points problématiques pour la jeunesse d’aujourd’hui : l’amour, la démocratie, l’économie, la magie, la cybernétique, etc.
Un certain nombre d’intellectuels de renom y prirent part comme Eva Illouz, Xavier Papaïs, Jacques Fradin, Franco Piperno et bien d’autres.
Le titre des réflexions que je vais partager avec vous serait « pour ou vers une théorie de la puissance destituante ».
Avant d’en venir à ce problème, je crois qu’il me faut un peu revenir en arrière, pour interroger l’itinéraire qui m’avait amené à poser ce problème.
Si je devais me poser à moi-même la question : qu’est-ce que j’ai voulu faire quand j’ai entrepris cette espèce de longue archéologie du politique qui se met sous le titre Homo sacer ?
Je crois qu’il ne s’agissait pas pour moi de corriger ou de réviser, de critiquer des concepts ou des institutions de la politique occidentale ; ça peut être important, mais mon but était plutôt celui de déplacer les lieux même du politique, et pour cela, avant tout, d’en dévoiler les lieux et l’enjeu véritable.
Je vais aller très vite pour résumer ces points.
Il m’est apparu que le lieu originaire du politique, dans la politique occidentale, c’est quelque chose comme une opération sur la vie, ou une opération qui consiste à diviser et capturer la vie par son exclusion même, c’est-à-dire à inclure la vie dans le système par son exclusion. Et là, le concept d’exception était utile.
« Exception » signifie étymologiquement prendre quelque chose au-dehors, c’est-à-dire exclure quelque chose et l’inclure par son exclusion même. Il me semble que l’opération originaire du politique est de cet ordre-là et la vie est quelque chose de non politique, d’impolitique qui doit être exclu de la cité, du politique et par cette exclusion elle va être inclue et politisée.
C’est une impression complexe et étrange, c’est-à-dire que la vie n’est pas politique en elle-même mais elle va être politisée. Il faut qu’elle soit politisée et de cette façon elle va devenir le fondement même du système.
Vous voyez là qu’on peut dire que, dès le début, la politique occidentale est une biopolitique parce qu’elle se fonde sur cette étrange opération d’exclure la vie comme impolitique et en même temps de l’inclure par ce geste même. Voilà, ça veut dire que le lieu du politique est quand même la vie mais à travers une opération de division, d’exclusion, d’articulation, d’inclusion etc.
Donc le politique c’est quand même la vie capturée sous une certaine modalité. Je vais essayer de définir cette structure d’exception.
Ce qui m’était apparu, c’est que par cette opération, la vie est divisée d’elle-même et elle se présente sous la forme de la vie nue, c’est à dire d’une vie qui est séparée de sa forme. Mais la stratégie il me semble, est toujours la même, on retrouve cette stratégie partout : par exemple, j’avais essayé de l’éclaircir chez Aristote.
Aristote ne va jamais définir la vie et depuis toujours c’est comme ça et même aujourd’hui. La vie n’est jamais définie mais par contre ce qui n’est pas défini est divisé et articulé, vous savez bien : vie végétative, vie sensible, vie des relations. On ne sait pas ce qu’est la vie mais on sait très bien la diviser, et comme vous savez, par la technique aujourd’hui même, produire cette division, réaliser cette division.
C’est dans ce sens que dans le premier volume du livre, je disais que l’opération fondamentale et souterraine du pouvoir est justement cette articulation de la vie, cette production de la vie nue en tant qu’élément politique originaire. Parce que ce qui résulte de cette opération finalement, c’est la production de cette étrange chose qu’il ne faut pas du tout confondre avec la vie naturelle.
La vie nue n’est pas du tout la vie naturelle, c’est la vie en tant qu’elle a été divisée et incluse de cette façon dans le système.
Là, on peut essayer de montrer aussi d’autres aspects de cette opération plus étroitement liés à l’histoire de la politique. Par exemple, les travaux sur le rôle de la guerre civile dans cette perspective dans la Grèce ancienne, dans l’Athènes classique. Christian Meier et d’autres historiens ont montré qu’au Ve siècle en Grèce, il se passe une chose très singulière : on assiste à une tout autre façon de définir l’appartenance sociale des individus.
Jusqu’à ce moment-là, cet historien montre que l’inclusion dans la cité, dans la polis, se faisait par des états et des conditions sociales. Il y avait des nobles, des membres de communautés cultuelles, des marchands, des paysans, des riches. Et donc l’inclusion était définie par cette pluralité des conditions.
Ce qui se passe au Ve siècle, c’est l’apparition du concept de citoyenneté comme le concept qui va définir l’appartenance sociale des individus à la ville. Il appelle ça une politisation, c’est à dire que par ce concept de citoyenneté que nous avons (malheureusement) hérité de la Grèce classique, la vie politique va se définir par la condition et le statut pas seulement formel ou juridique mais qui définit l’action même du citoyen. C’est à dire que le critère du politique va être la citoyenneté et la polis, la cité va se définir par la condition, l’action, le statut des citoyens.
C’est une chose qui nous apparaît tout à fait claire, même triviale, mais c’est à ce moment-là que ce concept est apparu en tant que seuil de politisation de la vie. C’est-à-dire que la vie des citoyens va s’inscrire dans la cité par ce concept qui est donc un seuil, qui définit un seuil de politisation.
La polis, la cité devient donc un domaine qui définit la condition des citoyens en tant que clairement opposé et distingué de la maison. Polis et oïkos : la maison (qui définit la condition de la vie du règne de la nécessité, de la vie reproductive etc.) est clairement, par le concept de citoyenneté, séparée de la cité. Et là, c’est un point important, on retrouve cette même division dont j’avais parlé avant entre la vie naturelle, la zôè et le bios, la vie politique. Là on le retrouve par l’opposition de la maison, la famille, l’oïkos, l’économie et la polis, le politique.
Mais vous voyez que si je parle d’un seuil de politisation, c’est que vraiment le politique apparaît dans cette dimension comme un champ de tension défini par des pôles opposés, la zôè (la vie naturelle) et le bios (la vie politique) ; la maison (l’oïkos) et la polis (la cité). Ce n’est pas quelque chose de substantiel, c’est un champ de tension entre ces deux pôles.
Et là, on voit bien le rôle que la guerre civile va jouer dans ce champ de tension. Là j’étais parti des recherches de Nicole Loraux sur la guerre civile, stasis, à Athènes. Loraux dit que la guerre civile est une guerre dans la famille, c’est une guerre dont le lieu originaire est justement la maison, la famille, une guerre entre frères ou entre fils et pères, etc. Mais ce qui m’est apparu en prolongeant ces recherches, c’est que la guerre civile fonctionne en Grèce, et notamment à Athènes, comme un seuil qui va définir ce champ de force dont les deux pôles extrêmes sont la famille, la maison et la cité.
Et en traversant cette espèce de seuil, ce qui n’est pas politique se politise et ce qui est politique se dépolitise. C’est seulement si on voit la guerre civile dans cette perspective qu’on comprend des choses qui nous apparaîtraient étranges. Comme la loi de Solon qui dit que si, quand il y a une guerre civile, un citoyen ne prend pas les armes pour un des deux partis, il est infâme, il est exclu des droits politiques. Cette chose nous apparaît bizarre et chez Platon, on trouve des tas de discours du même ordre.
La guerre civile c’est le moment où les frères deviennent ennemis et l’ennemi devient frère donc de la confusion entre ces deux champs (la maison et la cité, la zôè et la polis). On a un seuil entre les deux et en le traversant il y a une politisation de la vie ou une dépolitisation de la cité.
Ça ne veut pas dire que les grecs considéraient que la stasis, la guerre civile, était quelque chose de bien, mais ils voyaient en elle justement une espèce de seuil de politisation : un cas extrême où ce qui n’est pas politique va devenir politique et ce qui est politique va s’indéterminer dans la maison.
Voilà, à la base de ma recherche, il y avait cette espèce d’hypothèse que le politique était un champ de tension entre ces deux pôles et qu’entre les deux, il y a des seuils qu’il faut traverser. Donc ça c’était le premier déplacement quand je disais un déplacement du lieu du politique, c’était une sorte de première étape dans ce déplacement.
Il y avait aussi après d’autres aspects qui s’étaient révélés tout à fait importants pour moi : la politique dans notre tradition de la philosophie politique a toujours été définie au fond sur des concepts qui sont la production et la praxis, la production et l’action. On a toujours pensé : il y a du politique là où il y a poiesis, production et praxis, action. Et encore chez Hannah Arendt c’est comme ça, les concepts fondamentaux restent ces deux-là.
Là aussi, il me semblait nécessaire d’opérer un déplacement et les deux concepts qui me sont apparus à la place comme tout à fait importants pour définir une nouvelle idée du politique ce sont au contraire (des concepts que je vais nommer rapidement) : d’une part l’usage et de l’autre quelque chose qu’en français on pourrait traduire par désœuvrement à condition de l’entendre au sens actif, c’est à dire une action qui désœuvre, qui rend inopérant quelque chose.
Je vais très vite vous dire quelque chose sur ces deux concepts qui me paraissent importants.
D’abord le concept d’usage. J’avais rencontré ce concept depuis longtemps dans beaucoup de domaines mais tout à coup, c’était en lisant la Politique d’Aristote. Vous savez qu’au début de la Politique d’Aristote, il y a cette chose quand même assez étrange : le traité sur la politique commence par un petit traité sur l’esclavage, les 30 premières pages de la politique d’Aristote sont un traité sur l’esclavage, sur la relation maître/esclave.
Mais ce qui avait attiré mon attention c’est que dans ce contexte, donc avant de définir l’objet du politique, Aristote définit l’esclave comme un Homme, un être humain (il ne fait pas de doute pour Aristote que l’esclave est un être humain) dont l’œuvre propre (ergon en grec) est l’usage du corps. Il n’explique pas cela et en effet les historiens ne s’y sont pas arrêtés mais ça me semblait très intéressant.
Qu’est que ça veut dire « usage du corps » ? J’ai donc un peu travaillé, d’abord pour comprendre d’un point de vue sémantique, immédiat et je suis tombé sur ce fait linguistique que les verbes grecs et latins que nous traduisons par user, utiliser, faire usage (kresteï en grec et uti en latin) n’ont pas de signification propre. Ce sont des verbes qui tirent leur signification du mot qui les suit, qui n’est pas à l’accusatif mais au datif ou au génitif. J’ai pris des exemples très simples parce que c’est important.
Par exemple : le grec kresteï theon, littéralement faire usage du dieu mais la signification exacte c’est consulter un oracle, kresteï nostou, faire usage du retour qui signifie éprouver de la nostalgie, kresteï symphora, faire usage du malheur qui veut dire être malheureux, kresteï polei, faire usage de la cité veut dire participer à la vie politique, agir politiquement, kresteï gynaïki, faire usage d’une femme qui veut dire faire l’amour avec une femme et kresteï keïri, faire usage de la main qui est donner un coup de poing.
Et en latin c’est la même chose, on voit qu’il n’a pas de signification propre mais la reçoit par son complément (qui n’est pas à l’accusatif mais au datif). On se donne à cette chose, si on se donne à cette chose, on en fait usage.
On voit bien une chose qu’il ne faut jamais oublier : les analyses grammaticales sont des analyses philosophiques et métaphysiques même. On ne peut pas comprendre une chose si on ne comprend pas que la grammaire contient en elle-même toute une métaphysique qui s’est cristallisée dans le langage.
Il y a des analyses de ce très grand linguiste qu’est Benveniste qui montrent que les verbes de ce genre sont des verbes qu’on a classifié dans la grammaire comme des moyens, c’est-à-dire qu’ils ne sont ni actifs ni passifs. Et donc là, Benveniste essaye d’éclaircir la signification de ces verbes qui ne sont ni actifs ni passifs. Il dit que, tandis que normalement (par exemple dans l’actif), le procès, l’action, sont extérieurs au sujet et qu’il y a un sujet actif qui agit au-dehors de lui-même, dans ces verbes-là, les moyens, le verbe, indiquent un processus qui a lieu dans le sujet.
C’est-à-dire que le sujet est intérieur au processus. Le grec gignomaï ou le latin nascor (naître) ou bien morior (mourir), ou bien patior (souffrir), etc. Ce sont des verbes où le sujet est intérieur à l’action et l’action est intérieure au sujet, indétermination absolue non seulement entre actif et passif mais aussi entre sujet et objet.
Benveniste essaye de définir encore mieux et à un moment il donne cette définition qui était pour moi très éclairante. Il s’agit, dit-il, chaque fois de situer le sujet par rapport au processus selon qu’il est extérieur, comme dans l’actif, ou intérieur, et de qualifier l’agent selon que dans l’actif il effectue une action et que dans les moyens il effectue en s’affectant. C’est-à-dire en agissant, en effectuant une action, il va en être affecté lui-même.
Cette formule de « il effectue en s’affectant » est très importante pour moi. On voit bien qu’avec ces moyens donc ce n’est ni actif/passif, ni sujet, ni objet, on pourrait dire que par exemple le verbe kresteï, faire usage, exprime la relation qu’on a avec soi, l’affection qu’on reçoit en tant qu’on est en relation avec autre. Faire usage du retour (éprouver de la nostalgie) : c’est l’affection qu’on reçoit en tant qu’on est en relation avec le retour.
Le sujet est créé par l’affection qu’il reçoit par sa relation à autre chose. Ça change complètement la notion de sujet, il n’y a plus de sujet ni d’objet ni actif ni passif, c’est vraiment tout une autre ontologie, l’ontologie au moyen.
Et donc si on revient à cette idée de l’usage du corps qui est devenue pour moi très importante pour définir le politique, on pourrait imaginer cette expression kresteï somatos, faire usage du corps, et cela voudrait dire l’affection que l’on reçoit en tant qu’on a un rapport avec des corps. A mon avis, c’est la vie en tant que lieu véritable du politique. S’il y avait un sujet du politique, ce serait celui qui est affecté par sa relation avec des corps.
C’est pour ça que ce concept d’usage m’apparaissait très important et si on l’emploie comme ça, il devient vraiment la catégorie centrale qui va substituer le concept d’action, de praxis. Un concept dont je ne vais pas du tout faire la critique, qui est très important et qui a eu une histoire fondamentale dans la politique occidentale, dans l’éthique, etc. Mais c’est un concept à l’actif ou au passif et donc il reste emprisonné dans cette dialectique tandis que là, dans cette ontologie, cette politique aux moyens, on a un tiers qui n’est ni actif ni passif, c’est encore une action mais qui en même temps est un être affecté par son action ou par sa passion.
Le deuxième concept était celui du désœuvrement : il faut l’entendre comme s’il existait un verbe actif œuvrer ou ouvrer (qui existait en ancien français). Désœuvrer serait donc rendre inopérant, désactiver une œuvre. Ce n’est pas du tout une inertie, ne rien faire (ce qui est aussi important) mais par contre une forme encore d’action, de praxis ou d’œuvre, une opération qui consiste à désœuvrer les œuvres.
Ce que je voulais faire entendre par cela, c’est que d’abord, il y a un passage dans l’Ethique d’Aristote qui m’a toujours semblé important, où Aristote essaye de définir la Science politique (episteme politike) en tant qu’elle a son but dans le bonheur etc. Et à ce moment-là, il pose une question qui lui apparait quand même absurde mais qu’il pose très sérieusement.
Il dit au sujet du concept d’œuvre (ergon, qui définit l’activité propre, le but propre, l’énergie propre de chaque être) : on parle d’œuvre pour les menuisiers. Pour les joueurs de flûte, il y a bien sûr une œuvre (jouer de la flûte), pour les sculpteurs aussi (faire des statues) mais est ce qu’il y a une œuvre pour l’homme en tant que tel comme on le définit pour les menuisiers, sculpteurs, chanteurs, architectes etc ?
Et à ce moment, il dit : ou bien doit-on penser que l’homme en tant que tel est argos ? C’est-à-dire sans ergon : désoeuvré, sans œuvre. Est-ce que l’homme en tant que tel n’a pas un ergon propre, une œuvre propre, un but propre, une vocation propre, une définition possible, etc ? Bien sûr, Aristote pose cette question mais la laisse tomber, parce que lui par contre a une réponse. Il va dire que l’ergon de l’homme, c’est l’activité selon le logos, etc.
Mais moi par contre, j’avais été frappé par cette possibilité et je m’intéressais plutôt à cette chose qu’il avait posé comme une hypothèse un peu étrange, c’est-à-dire l’idée que par contre il faut le prendre au sérieux, que l’homme est un être qui manque d’un ergon propre.
L’homme en tant que tel n’a aucune vocation biologique, sociale, religieuse ou de n’importe quelle nature qui puisse le définir essentiellement. L’homme n’a pas d’œuvre, est un être désœuvré dans ce sens. On pourrait aussi dire, un être de puissances, qui n’a pas d’actes ou d’ergon propre, mais justement il me semblait que c’est cela qui peut permettre de définir pourquoi il y a de la politique.
Si l’homme avait un ergon propre prédéterminé par la nature, la biologie, le destin, il me semble qu’il n’y aurait ni éthique ni politique possible parce qu’on ne devrait qu’exécuter des tâches. L’action la plus misérable que l’homme puisse faire : exécuter des tâches.
Voilà, j’avais essayé de définir ce concept. Le désœuvrement d’abord n’est pas une suspension de l’activité mais une forme particulière d’activité et deuxièmement, j’avais immédiatement vu que dans l’histoire de la pensée occidentale, c’était justement un problème qu’on n’avait jamais posé.
L’idée de toute inactivité, l’idée, surtout dans le monde moderne à partir du christianisme par exemple, que Dieu puisse être un être oisif est quelque chose qui répugne les théologiens. Dieu non seulement a créé le monde mais ne cesse de le créer et ne cesse d’agir, ne cesse de le gouverner, la création est continue et l’idée qu’un dieu puisse être inactif ou désœuvré et une chose monstrueuse pour les théologiens et je crois que toute la tradition de la modernité se fonde sur le refoulement du désœuvrement.
Un des lieux où ce problème a été pensé, c’est le problème de la fête. C’est un des lieux où dans notre tradition, on essaye de donner une place au désœuvrement.
Et dans notre société moderne, c’est un peu calqué sur le concept du shabbat, c’est-à-dire la suspension de l’activité. La fête consisterait à suspendre l’activité, ce serait donc une suspension provisoire des activités productives. On voit que en même temps c’est un problème perçu mais en même temps qui est bien limité, dans des limites qui excluent, qui rendent impossibles de le penser véritablement.
Mais si on réfléchit à la fête même, on voit bien que ce n’est pas du tout la définition de la fête, la suspension du travail, parce que dans la fête, même si dans le shabbat toute activité productive est interdite, on fait des choses : on fait des repas et dans les fêtes on s’échange des dons.
On fait des choses mais toutes les choses qu’on fait sont soustraites à leur économie propre, sont destituées de leur économie propre. C’est-à-dire que si on mange ce n’est pas pour se nourrir mais être ensemble, faire l’expérience d’une festivité, si on s’habille ce n’est pas pour se protéger du froid, c’est là aussi pour autre chose, pour un autre usage et surtout si on s’échange des choses ou des dons, ce n’est pas par un échange économique.
La fête est définie non pas simplement par une action mais par un genre particulier d’opération. C’est-à-dire que les activités humaines sont soustraites à leur économie propre et par cela ouvertes à un autre usage possible.
Les folklores sont remplis de ces choses, la fête des morts dans le folklore sicilien, qu’on retrouve dans les pays anglo-saxons, dans Halloween. Dans Halloween, les enfants sont les morts qui réapparaissent et prennent ou volent même les choses qui sont dans une certaine économie et en les soustrayant à l’économie, on les ouvre à cette chose qu’on appelle l’étrenne, le cadeau, etc.
Donc c’était pour vous montrer tout simplement qu’on peut très bien penser une activité comme celle qu’on fait dans la fête, qui ne se limite pas à suspendre une économie, une action, une œuvre mais aussi en fait un autre usage.
Mais cet élément destitutif de la fête me paraît très important : c’est toujours soustraire une chose à son économie propre, pour la désœuvrer, pour en faire un autre usage.
Par exemple, les anciens disaient qu’il n’y a pas de fête sans danse. Mais qu’est-ce que la danse si ce n’est une libération des gestes et des mouvements du corps de leur économie propre ? Si ce n’est soustraire les gestes à une certaine utilité économique, une certaine direction et l’exhiber en tant que telle, en la désœuvrant.
Et les masques c’est la même chose. Que sont les masques si ce n’est une neutralisation du visage ? Le masque va rendre inopérant le visage, va désœuvrer le visage, mais en cela, il en montre ou en expose quelque chose même de plus vrai.
Un autre exemple qui me semble tout à fait clair, pour comprendre ce qu’est le désœuvrement : qu’est-ce qu’un poème ? C’est une opération linguistique qui a lieu dans le langage comme toute autre, il n’y a pas d’autre lieu pour le poème. Le poème est une opération langagière, dans le langage.
Alors qu’est-ce qu’il se passe ? Là encore, on voit que le langage est désactivé de sa fonction informationnelle, communicative etc. Et par ce désœuvrement, il est ouvert à un autre usage, ce que l’on appelle poésie. Ce n’est pas facile de dire ce que c’est, mais une définition très simple c’est soustraire le langage à son économie informationnelle, communicationnelle et cela va faire cet autre usage du langage qu’on appelle poésie.
Là c’est quelque chose qui fait partie presque anthropologiquement de la condition humaine.
Par exemple la bouche est une partie de l’appareil digestif de l’homme, c’est même le premier élément du système digestif. Que fait l’homme ? L’homme détourne la bouche de cette fonction pour en faire le lieu du langage. Et donc toutes les dents qui servent à mâcher vont servir à faire les dentales, etc.
Vous voyez, l’homme marche par désœuvrement même des fonctions biologiques. Même les fonctions biologiques du corps sont ouvertes à un autre usage. Le baiser c’est la même chose, il prend cet élément digestif et en fait un autre usage.
Donc le désœuvrement est une activité propre de l’homme qui consiste à désœuvrer les œuvres économique, biologique, religieuses, juridiques sans simplement les abolir. Le langage n’est pas aboli. Qu’est-ce que ça pourrait être un désœuvrement de la loi ? On va le voir, la loi n’est pas simplement abolie mais soustraite à son horrible économie et on peut en faire peut-être un autre usage.
Et là je peux enfin en venir à mon problème de la puissance destituante.
Parce que si on met au centre de la politique non plus la poiesis et la praxis, c’est-à-dire la production et l’action mais l’usage et le désœuvrement, alors tout change dans la stratégie politique.
Notre tradition a hérité ce concept de pouvoir constituant de la Révolution française. Mais ici, on doit penser quelque chose comme une puissance destituante. Parce que justement le pouvoir constituant est solidaire de ce mécanisme qui va faire que tout pouvoir constituant va fonder un nouveau pouvoir constitué.
C’est ce qu’on a toujours vu, les révolutions se passent comme ça : on a une violence qui va constituer les droits, un nouveau droit, et après on aura un nouveau pouvoir constitué qui va se mettre en place. Tandis que si on était capable de penser un pouvoir purement destituant, pas un pouvoir mais justement je dirais pour cela une puissance purement destituante, on arriverait peut-être à briser cette dialectique entre pouvoir constituant et pouvoir constitué qui a été, comme vous le savez, la tragédie de la Révolution.
C’est ça qui s’est passé et on le voit partout même maintenant, par exemple dans la révolution du Printemps arabe. Immédiatement, on a fait des assemblées constituantes et ça a été suivi par quelque chose de pire que ce qu’il y avait avant. Et le nouveau pouvoir constitué qui s’est mis en place par ce mécanisme diabolique du pouvoir constituant devient un pouvoir constitué.
Donc à mon avis ce sont des concepts qu’il faut avoir le courage d’abandonner : en finir avec le pouvoir constituant. Negri ne serait pas d’accord mais il faut penser un pouvoir ou plutôt une puissance qui ait la force de rester destituante.
Ça nous engage à élaborer une tout autre stratégie. Par exemple, si on pense une violence, cette violence doit être purement destituante. Il faut faire attention, si c’est une violence qui va constituer un nouveau droit, on a perdu.
Donc il faut penser les concepts de révolution, d’insurrection, d’une toute autre façon ce qui n’est pas facile.
Là je voulais donc uniquement quelques repères. C’est tout un travail à faire que vous devez faire aussi, que j’ai essayé de faire moi aussi. Mais pour l’instant, comme c’est un travail en cours, je voulais uniquement vous donner quelques éléments du moment où il me semble que dans notre tradition, on a essayé de penser cela.
La première chose qui me vient immédiatement à l’esprit, c’est l’essai de Walter Benjamin sur la critique de la violence. C’est un essai qui, si on le lit dans cette perspective, a vraiment cela au centre.
Dans cet essai, Benjamin essaye de penser ce qu’il appelle « une violence pure », c’est-à-dire une violence qui ne va jamais poser un nouveau droit. C’est-à-dire une violence qui serait capable de briser ce qu’il appelle « la dialectique entre la violence qui pose les droits et la violence qui les conserve ». Notre système politique, ce qu’on avait appelé avant le pouvoir constituant, le pouvoir constitué, c’est ça.
Notre système politique se fonde sur cette idée. Par exemple quand il y a des révolutions, des changements, on a une violence qui fonde un nouveau droit et immédiatement après, cela se traduit dans une violence qui va le conserver.
Et Benjamin dit que c’est ce mécanisme qu’il faut briser et donc il essaye dans ce texte de penser ce qu’il va appeler une « violence pure », une violence divine, peut-importe. Et il va le définir justement comme une violence qui va entsetzen (il emploie le verbe allemand) : qui va déposer le droit, sans fonder un nouveau droit.
C’est-à-dire une violence qui brise son rapport avec le droit. Il essaye de trouver des exemples dans la mythologie grecque et surtout dans l’idée de Sorel de grève générale prolétaire. Il y voit une forme de violence pure dans le sens où elle ne va pas constituer de droit, elle n’est pas dirigée à obtenir et constituer un nouveau droit. C’est une violence qui reste purement destitutive par rapport au droit existant.
C’est un exemple qui me semble important parce qu’il a bien vu justement que le problème c’est de briser ce rapport.
Un autre exemple qui me vient à l’esprit c’est ce que Paul (l’apôtre) essaye de faire dans ses lettres. C’est-à-dire qu’il va définir les rapports entre le Messie et la Torah (la loi juive) par le verbe grec katargeïn qui veut dire rendre argos, rendre inopérant, désactiver.
Ce qu’il dit en fait, c’est : nous sommes des juifs et bien sûr on ne va pas détruire la loi, on ne va pas détruire la Torah, mais on va la rendre inopérante, argos, la désœuvrer.
Et donc le Messie n’est pas quelqu’un qui simplement abolit la loi, c’est quelqu’un qui la désœuvre. Qu’est-ce que ça veut dire ? C’est vraiment son problème : penser un rapport à la loi qui, sans tout simplement la nier, l’éliminer, nie le fait qu’on doit exécuter des commandements, tout autre rapport à la loi.
C’est un trait du messianisme juif qui va jusqu’aux formes qu’il a pris au XVIIe siècle dans le sens que l’accomplissement de la loi est sa transgression, comme dit Sabbataï Tsevi. Donc dans le messianisme il y avait ce problème : penser un rapport à la loi qui ne soit pas son exécution, son application.
C’est très intéressant : est-il possible de penser un rapport à la loi qui la désactive, qui la rende inopérante en tant que commandement et en permet un autre usage ? C’est ce que c’était au début pour Paul et qui après est devenu le christianisme, qui a complètement trahi cette chose.
Mais il y a une chose par exemple qui peut être utile dans cette perspective. Paul a dit une chose à un certain moment pour comprendre ce que pourrait être ce rapport à la loi qui ne l’exécute pas sans l’abolir. Il dit, pour exprimer la condition messianique, que la condition maintenant c’est que ceux qui ont une femme comme s’ils n’en avaient pas, ceux qui pleurent comme s’ils ne pleuraient pas, ceux qui se réjouissent comme s’ils ne se réjouissaient pas, ceux qui achètent une maison comme s’ils ne la possédaient pas etc.
Par exemple, tu es né dans une certaine condition sociale, tu es esclave, fais-en usage. Et il emploie cette expression du verbe kresteï.
C’est-à-dire que le problème n’est pas tout simplement : je suis esclave et je vais devenir libre, d’abord fais-en usage. Apprendre à faire usage de sa condition, c’est-à-dire à la désactiver, à la rendre inopérante par rapport à soi-même et en cela ça devient une possibilité proprement désœuvrante qui va rendre possible un autre usage de ta condition.
Ce n’étaient que des exemples, je ne suis pas en train de dire que c’est ça qu’il faut faire, c’était juste pour vous montrer que dans certains moments de notre tradition de pensée on a quand même ce problème.
Et là, c’est une chose qui me semble aussi importante, il me semble que c’est cette puissance destituante que la pensée du XXe siècle a essayé de penser, sans y réussir vraiment.
Ce qu’Heidegger pense comme destruction de la tradition, ce que Schürmann pense comme déconstruction de l’arché, ce que Foucault pense comme archéologie philosophique, c’est-à-dire remonter à un certain arché, un certain a priori historique et essayer de le neutraliser.
Il me semble que ce sont des essais qui vont dans cette direction (et c’est ce que moi-même j’ai essayé de faire) sans peut-être vraiment y arriver. Mais c’est cela, c’est la destitution des œuvres du pouvoir, pas simplement l’abolition.
C’est quelque chose d’évidemment très difficile parce qu’aussi on ne peut pas la réaliser uniquement par une praxis. C’est-à-dire que le problème n’est pas quelle forme d’action va-t-on trouver pour destituer le pouvoir, parce-que ce qui va destituer le pouvoir n’est pas une forme d’action mais uniquement une forme-de-vie.
Ce n’est que par une forme-de-vie que le pouvoir destituant peut s’affirmer donc ne n’est par cette activité-là, cette praxis-là, c’est par la construction d’une forme-de-vie.
Vous voyez pourquoi c’est difficile puisqu’il ne s’agit pas de telle action, on va faire ci, on va faire ça. Ça ne suffit pas. Il faut d’abord constituer une forme-de-vie.
Et là on peut revenir à pourquoi il est si difficile de faire cela. Pourquoi par exemple est-il difficile de penser des choses comme l’anarchie (l’absence de commandement, de pouvoir), l’anomie (l’absence de loi) ? Pourquoi est-ce si difficile de penser ce concept qui pourtant semble contenir quelque chose ?
Benjamin dit une fois que la véritable anarchie est l’anarchie de l’ordre bourgeois et dans le film Salo de Pasolini, il y a un fasciste qui dit à un moment que la véritable anarchie est l’anarchie du pouvoir. C’est quelque chose qu’il faut prendre à la lettre.
Donc le pouvoir marche par capture de l’anarchie, le pouvoir qu’on a en face n’est fonction que parce qu’il a reçu, inclus (toujours ce processus de l’exclusion incluante) l’anarchie.
Même chose avec l’anomie, c’est évident avec l’état d’exception : notre pouvoir marche en étant capable d’inclure, de capturer l’anomie. L’état d’exception est une absence de loi tout simplement, mais une absence de loi qui va devenir intérieure au pouvoir, à la loi.
C’est cela qui est compliqué. On ne peut pas accéder à l’anarchie, on ne peut pas accéder à l’anomie. Et on pourrait continuer, notre pouvoir dit démocratique se fonde en fait sur l’absence du peuple, on pourrait dire « adémie » (dèmos, le peuple). La démocratie qu’on a en face c’est quelque chose qu’on a par le mécanisme ridicule de la représentation qui a capturé l’adémie, l’absence de peuple, en son centre.
Voilà, mais c’est justement cela qui rend si compliqué l’essai d’accéder à l’anarchie, d’accéder à l’anomie. On ne peut pas y accéder immédiatement parce que d’abord il faut désactiver, désœuvrer, destituer l’anarchie du pouvoir.
C’est-à-dire que la véritable anarchie n’est rien d’autre que la destitution de l’anarchie du pouvoir. Et c’est pour ça qu’on ne peut pas la penser parce que si on essaye de penser l’anarchie, on a en face ce que le pouvoir en a fait, c’est-à-dire la guerre de tous contre tous, le désordre…
Si on essaye de penser l’anomie, on a cette chose absurde : le manque de loi, le chaos où chacun fait ce qu’il veut. Mais c’est faux, ça c’est l’image que la capture de l‘anarchie, la capture de l’anomie, nous laissent en face. Si d’abord on arrive à désactiver l’anarchie et l’anomie capturées par le pouvoir, peut-être alors que la véritable anarchie peut réapparaître.
C’est pour ça que des travaux comme ceux des anthropologues Clastres et Sigrist sont importants. Ils montrent très clairement que ce n’est pas du tout vrai. Si on regarde les sociétés primitives, on voit l’anarchie mais ce n’est pas du tout ce que notre tradition politique nous présente. Par exemple, dans le livre de Sigrist, il emploie la formule « anarchie contrôlée ». C’est pour dire que c’est une absence de pouvoir mais pas du tout la guerre de tous contre tous, le chaos, ce sont des formes différentes. C’est aussi ce qu’Illich a essayé de penser par ce concept de « vernaculaire ». Ce n’est pas l’anarchie que l’on croit.
C’est cette chose-là qui me semblait importante : on ne pourra pas accéder à une véritable pensée de l’anarchie si on ne neutralise pas d’abord l’anarchie que le pouvoir contient en son centre.
Je vous avais dit que ce n’est pas une tâche théorique mais que cela ne sera possible, cette opération de destitution du pouvoir, que par une forme-de-vie. Donc ce n’est pas tout simplement trouver la bonne action mais constituer des formes-de-vie. Je dirais même qu’une forme-de-vie c’est justement là où on rejoint quelque chose qui d’elle-même va être destituante.
J’avais essayé de définir ce concept de forme-de-vie au début de ma recherche comme une vie qui ne peut pas être séparée de sa forme.
C’est-à-dire une vie pour laquelle, dans son mode de vie, est en jeu la vie même : une vie pour laquelle sa vie même est en jeu dans sa façon de vivre. Vous voyez là donc qu’il ne s’agit pas simplement d’un mode de vie différent. Ce sont des modes de vie qui ne sont pas simplement des choses factuelles mais des possibilités.
Tiqqun avait développé cette définition de façon très intéressante dans trois thèses que je vous lis et qui sont dans le n°2 de la revue : « 1- L’unité humaine n’est pas le corps ou l’individu, c’est la forme-de-vie. 2- Chaque corps est affecté par sa forme-de-vie comme par un clinamen, une attraction, un goût. 3- Ma forme-de-vie ne se rapporte pas à ce que je suis mais à comment je suis ce que je suis. »
Donc d’abord, la forme-de-vie est quelque chose comme un goût, une passion, un clinamen : c’est quelque chose d’ontologique qui affecte un corps. Mais aussi je voudrais m’arrêter sur le dernier point : le concept du comment.
Ce n’est pas ce que je suis mais comment je suis ce que je suis. Dans la tradition de l’ontologie occidentale, ce serait ce qu’on a essayé parfois de penser comme une ontologie modale.
Vous connaissez peut-être la thèse de Spinoza : il n’y a que l’être, la substance et ses modes, ses modifications. Il n’y a que Dieu et ses modifications qui sont les êtres, les êtres singuliers. Les êtres singuliers ne sont que des modes, des modifications de la substance unique.
Mais là, je crois qu’il faut encore poursuivre, éclaircir. La substance, l’être n’est pas quelque chose qui précède le mode et existe indépendamment de ces modifications. L’être n’est rien d’autre que ce mode d’être, la substance n’est que ses modifications, n’est que son comment.
Et là vous voyez que c’est toute une autre ontologie qu’il faudra penser dans le sens que l’ontologie a toujours été définie par ces deux concepts : identité et différence. Donc on a essayé par exemple de penser le problème un et multiple par le concept identité et différence (différences ontologique etc.).
Et il me semble que ce qu’il faudrait penser, c’est un tiers qui va neutraliser ce couple identité/différence. Je veux dire par là que si on prend par exemple la thèse spinoziste qu’on a toujours qualifiée de panthéiste, c’est-à-dire deus sive natura, Dieu ou bien la nature, il ne faut pas croire que cela veut dire Dieu = nature parce que là on retombe dans identité /différence. Non, sive veut dire ou bien et exprime justement la modalisation, la modification, c’est-à-dire la neutralisation et l’élimination aussi bien de l’identité que des différences.
Divin n’est pas l’être en soi mais son « ou bien », son sive, ses modifications. Je ne sais pas si on pourrait dire : le fait de se « naturer » dans ce mode, naître dans ce mode.
Donc vous voyez la différence, toutes les critiques qu’on a fait au panthéisme dans le sens que c’est absurde de penser que être = mode, Dieu = nature, c’est faux. Ce n’est pas ça : Dieu se modalise, c’est la modalisation, la modification qui est importante. Dieu, le divin n’est que ce processus de modification.
Et là aussi, pour cela, il faudrait penser différemment le rapport entre la puissance et l’acte. La modification n’est pas une opération par laquelle quelque chose qui était en puissance, l’être ou Dieu, s’actualise, se réalise, s’épuise en cela.
Ce qui aussi bien dans le panthéisme que dans le cas d’une forme-de-vie va désactiver les œuvres est surtout une expérience de la puissance en tant que telle mais de la puissance en tant qu’habitus, cet usage habituel, on pourrait dire de la puissance qui va se manifester dans ce désœuvrement qui est aussi la forme chez Aristote d’une puissance du ne pas, ne pas être, ne pas faire, mais qui est surtout un habitus, un usage habituel : une forme-de-vie. Et une forme-de-vie, c’est un usage habituel de la puissance. Il ne faut pas penser : une puissance, je dois la mettre en acte, la réaliser. Non, c’est un habitus, un usage habituel.
Donc dans ce sens, tous les êtres vivants sont dans une forme-de-vie mais cela n’est pas équivalent à dire que tous les êtres vivants sont une forme-de-vie. Parce que justement une forme-de-vie est quelque-chose qui va rejoindre cet usage habituel de la puissance qui va désœuvrer les œuvres.
Bon, et je crois que j’en ai même trop dit.
Une chose qu’on avait discutée l’autre soir : tout cela implique aussi qu’il y a un autre concept politique dans notre tradition qu’il faut repenser. C’est celui d’organisation. Parce que vous comprenez que si la définition d’une forme-de-vie que je donne est correcte, la forme-de-vie n’est pas quelque chose que quelqu’un peut prétendre organiser. Elle est déjà en elle-même pour ainsi dire complètement organisée. Qui va organiser des formes-de-vie puisque la forme-de-vie est le moment où on a rejoint l’usage habituel d’une puissance ?
Et donc à mon avis le problème de l’organisation politique est l’un des problèmes majeurs de notre tradition politique et il faut le repenser.
Voilà, c’est tout.
Giorgio Agamben
Source : Lundimatin Janvier 2016
Voir aussi : Rubrique Philosophie, rubrique Politique, G Agamben : De l’Etat de droit à l’Etat de sécurité rubrique Science, Science politique,