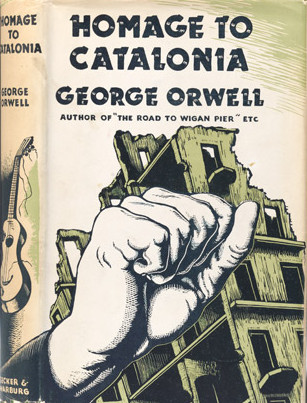L’opération russe en Crimée aux dépens de l’Ukraine ramène sur le devant de l’actualité la question des frontières. Si nous élargissons la réflexion à l’échelle de la planète, nous observons un processus de privatisation des frontières. Quels en sont les signes et les effets géopolitiques ?
Cette question sera traitée en deux temps : il faudra voir comment le discours officiel qui met en avant l’atout économique de cette privatisation peut être nuancé et quels autres intérêts se cachent derrière ce processus ; avant d’expliquer comment la collaboration public-privé concernant le contrôle des frontières conduit à un transfert de compétences problématique et à une dilution des responsabilités qui participe d’un brouillage du contrôle des frontières.
Ce texte est né d’un exposé réalisé dans le cours de géographie politique de Pierre Verluise dans le cadre du MRIAE de l’Université Panthéon-Sorbonne (Paris-I). Un sujet qui témoigne d’un certain flair puisque le 7e Festival de géopolitique – en mars 2015 – aura pour thème « Les frontières ». Les appels à contribution seront lancés en mai 2014.
FACE à la détérioration de la situation sécuritaire au Mali en avril 2012, l’Algérie décide de faire appel à une société spécialisée dans les prestations de sécurité aéroportuaire appelée Sécuricom. Celle-ci est chargée, entre autres, du contrôle des documents des voyageurs, de la surveillance de la zone d’entrée et de sortie des passagers et de la fouille du personnel intervenant dans la préparation de l’avion. Elle se voit donc investie d’une responsabilité concernant le contrôle des frontières algériennes (ici, une frontière réticulaire).
Cet exemple n’est pas un cas isolé : en effet, surtout depuis la fin de la Guerre froide et la baisse consécutive du budget consacré à la Défense dans beaucoup d’États, s’est mis en place un processus de privatisation, c’est-à-dire de transfert des compétences du public au privé concernant des tâches pour lesquelles l’État semblait pourtant avoir intérêt à garder un contrôle fort, comme par exemple la gestion de ses frontières. Ainsi, de grandes entreprises comme Boeing, G4S, EADS ou même Siemens sont en charge d’imaginer des systèmes de sécurité pour les frontières, de les construire, voire d’en assurer le contrôle.
Ce partenariat a pour but premier d’effectuer des économies dans le domaine sécuritaire, mais nous pouvons nous questionner sur l’existence d’autres motivations. Nous pouvons donc nous demander quels sont les enjeux qui sous-tendent ce processus de privatisation des frontières et quels en sont les effets géopolitiques ?
Cette question sera traitée en deux temps : il faudra voir comment le discours officiel qui met en avant l’atout économique de cette privatisation peut être nuancé et quels autres intérêts se cachent derrière ce processus ; avant d’expliquer comment la collaboration public-privé concernant le contrôle des frontières conduit à un transfert de compétences problématique et à une dilution des responsabilités qui participe d’un brouillage du contrôle des frontières.
Concernant la notion de privatisation, il pourra nous être objecté que la construction de murs et l’équipement des frontières en matériel de surveillance, sécurité et défense a presque toujours été concédée aux entreprises du secteur privé et qu’à ce titre il n’y a pas de privatisation au sens strict de passage du public au privé. Cependant, ces tâches sont bien confiées au secteur privé par l’État et bien que le transfert de compétences dans ce domaine ne soit pas nouveau, il est partie prenante d’un processus de privatisation plus large qui englobe de plus en plus la gestion des frontières et des flux migratoires et c’est à ce titre que nous parlons de privatisation privatisation (pour une histoire politique de la privatisation voir Havkin, 2011 [1]).
I. Le marché des frontières
A. Objectif affiché : diminuer le coût du contrôle des frontières pour l’État
Le contrôle des frontières occupe une place majeure dans le budget de l’État et, globalement, ce coût a tendance à augmenter. Par exemple, la frontière entre les États-Unis et le Mexique coûtait aux États-Unis 326,2 millions de dollars en 1992 contre 2,7 milliards de dollars en 2009 [2]. Un enjeu pour l’État est donc de diminuer ce coût tout en continuant d’améliorer le contrôle à ses frontières. Une des solutions proposées est la privatisation de ce contrôle, qui entre dans un processus global de privatisation du domaine de la sécurité. En ce sens, la Grande Bretagne est un exemple type. Elle est même la tête de file de ce mouvement global de privatisation : dès 1992, John Major met en place un Private-Public Partnership (PPP) dans presque tous les secteurs jusque-là gérés uniquement dans le domaine public. Le PPP est également adopté par la UK Border Agency, notamment concernant la gestion des frontières britanniques.
Ainsi, sur son site internet, la firme G4S expose les modalités de ce partenariat : « G4S est le principal fournisseur d’escortes sur le territoire national, des services de rapatriement à l’étranger et l’opérateur de quatre des huit centres privés de l’immigration au Royaume-Uni. Chaque mois G4S gère plus de 6.000 mouvements de et vers les onze centres de rétention de l’immigration au Royaume-Uni et d’autres établissements tels que des centres de détention à court terme. L’année dernière G4S a renvoyé plus de 4.000 détenus sur les vols à travers le monde […] Grâce à son expertise généralisée dans le système de justice depuis 20 ans, G4S aide la prestation de la UK Border Agency, qui est l’une des meilleures dans le monde » [3]. Officiellement, la privatisation a pour but la réduction des coûts, le transfert des risques de ces projets au secteur privé ainsi que l’encouragement des sociétés privées à innover. [4] Aux États-Unis, un Public-Private Partnership (PPP) est aussi prévu pour la frontière nord. L’organisation de la collaboration a été confiée par le Department of Homeland Security à la Border Infrastructure Task Force (BITF). Dans un rapport publié en 2012 par ce département, les objectifs économiques du PPP sont clairement indiqués : il a pour but « la création soutenue d’emplois et l’amélioration de la compétitivité économique globale aux États-Unis. L’amélioration de la capacité, de l’efficacité et de l’efficience des installations et des opérations de passage des frontières permettra d’améliorer le traitement des échanges commerciaux et des voyages légitimes, réduisant à la fois le coût pour les gouvernements et le coût du passage de la frontière pris en charge par l’usager » [5].
Il est vrai que grâce à la Correction Corporation of America (CCA) qui gère le centre d’accueil d’immigrés clandestins Eloy Detention Center en Arizona et qui embauche pour cela plus de 95% de la population de la petit ville d’Eloy, la région était classée en 2009 parmi les 25 qui enregistraient la plus haute croissance de l’emploi aux États-Unis [6].
Les économies faites par l’État seraient dues au fait qu’à long terme, les entreprises, profitant des gestions de stocks différentes, des recours aux aides informatiques, des flux tendus, etc., pourraient baisser leur coût de production ; mais force est de constater l’absence de résultats clairs et convaincants. Parfois, le coût estimé d’une opération est bien en deçà de son coût réel : par exemple le projet « Virtual Fence » prévoyant la mise en place de caméras et de radars le long de la frontière sud des États-Unis, estimé à 7 millions de dollars en 2005 pour les 2.000 miles concernés, s’élève en réalité à 1 milliard pour 43 miles (soit 2% de la longueur totale de la frontière) [7]. A ces coûts initiaux, il faut par ailleurs ajouter les coûts d’entretien. Ainsi, le Customs and Border Protection aux États-Unis estime qu’il lui faut 6,5 milliards de dollars pour s’assurer du fonctionnement de la barrière existante avec le Mexique pour les vingt prochaines années [8]. L’objectif affiché par l’État (faire des économies) n’est donc pas toujours voire rarement atteint et il existe en réalité bien d’autres motivations qui le poussent à engager une collaboration avec le secteur privé concernant le contrôle des frontières.
B. Le rôle du lobbying dans la sécurisation des frontières
Ainsi, la privatisation des frontières représente un marché profitable et en pleine croissance. Elle ne peut se développer que dans le contexte de ce que Michel Foucher appelle « l’obsession des frontières » [9], c’est-à-dire une sécurisation croissante des frontières liée à différentes craintes, dont deux prédominent : une « invasion » de migrants venus des pays du « Sud » et l’arrivée de terroristes sur le territoire national. Ces craintes sous-tendent ce que Florine Ballif et Stéphane Rosière appellent les « teichopolitiques », entendues comme les politiques « de cloisonnement de l’espace, en général liée[s] à un souci plus ou moins fondé de protection d’un territoire » et englobant « l’ensemble les systèmes visant à contrôler les mouvements » [10].
Cette sécurisation croissante des frontières prend essentiellement trois formes. La forme la plus visible est le renforcement physique de la frontière, construction de murs, prolongement de ces murs, barbelés, tours de surveillance, etc. Ensuite, cela peut se manifester par la multiplication du personnel chargé du contrôle de ces frontières, ce qui va souvent de pair avec leur renforcement physique (prolongement des murs par exemple). Enfin, et c’est certainement la manifestation la plus répandue de cette sécurisation des frontières, les investissements dans de nouvelles technologies de contrôle des frontières, investissements qui trouvent un paroxysme dans les dispositifs de « smart borders » (mise en place de circulations sécuritaires basées sur la traçabilité des flux) notamment sur la frontière États-Unis-Canada.
Derrière cette sécurisation se trouvent d’importants intérêts économiques, car les États font appel au secteur privé pour la mettre en œuvre. Comme le remarque Michel Foucher, outre l’argument économique que nous avons présenté, un des arguments avancés est que « le secteur privé, bien informé des défaillances des gardes-frontières et des douaniers, est à même, par sa capacité d’ensemblier, de combiner technologie, infrastructures et ressources humaines pour obtenir immédiatement les résultats recherchés par les autorités politiques » [11]. Les entreprises privées de secteurs divers mais ayant tous trait à la sécurité ont donc tout intérêt à ce que se mette en place un climat sécuritaire de fermeture des frontières et à pousser les politiciens, principalement par le lobbying, à amener ce thème au centre de leur campagne. Comme le soulignent Florine Ballif et Stéphane Rosière, « le sentiment d’insécurité paraît instrumentalisé et des processus plus larges que la sécurité au sens strict sont à examiner pour comprendre la nouvelle prégnance des barrières dans le paysage politique contemporain » [12]. Ainsi, par exemple, en 2006 la firme Boeing a remporté (à la tête d’un consortium d’entreprises) un appel d’offre d’environ 2,5 milliards de dollars pour équiper en quatre ans les deux frontières terrestres des États-Unis avec un réseau de 1.800 tours de surveillance dotées de capteurs et de caméras [13]. De nombreuses industries de défense ont trouvé dans le processus de sécurisation et de fortification des frontières un marché lucratif, autour duquel elles se sont réorganisées, « en recyclant, comme le remarque Elisabeth Vallet, l’expertise acquise au cours de la Guerre Froide et bénéficiant de la privatisation du marché de la frontière et de la sécurité » [14]. De même, la mise en place des « smart borders » par les États-Unis avec le Canada représente un marché important pour les entreprises qui ont eu à équiper les zones frontalières en nouvelles technologies et à former des agents capables de les maîtriser. Ce phénomène de smart borders est d’autant plus important qu’il a ensuite été développé par les États-Unis sur sa frontière avec le Mexique et que la Maison Blanche impose certaines normes de contrôle inspirées de ce dispositif à d’autres pays pour le commerce ou encore le tourisme, selon un processus « d’externalisation des normes » [15]. L’Union européenne s’est d’ailleurs récemment dotée d’un mécanisme de « frontières intelligentes » [16]. Notons également que ce marché des frontières ne se développe pas uniquement les pays occidentaux.
Ainsi, par exemple, le Saudi Guard Development Program confère à EADS la mise en place d’un dispositif de « sécurisation » sur 5.000 kilomètres le long de la frontière saoudienne, dispositif comprenant entre autres des systèmes électroniques et de détection, des postes frontières et des drones. Le Homeland Security Research considère d’ailleurs que le marché saoudien représente le plus gros marché frontalier, à hauteur de 20 milliards de dollars sur les dix prochaines années, montant qui pourrait doubler suite aux « printemps arabes » qui inquiètent les dirigeants saoudiens [17].
Comme nous l’avons vu, la privatisation concerne non seulement la « construction » de nouvelles frontières ou bien l’accès aux nouvelles technologies, mais également la gestion de ces frontières. Il y a dès lors un brouillage du contrôle des frontières, qui ne sont plus sous la maîtrise pleine et entière des États.
II. Le brouillage du contrôle des frontières
A. La perte de souveraineté de l’État
Comme le souligne à juste titre Wendy Brown [18], les murs frontaliers représentent une sorte de zone d’exception juridique. Ce raisonnement, valable notamment pour la frontière américano-mexicaine, ou encore israélo-palestinienne, peut être étendu à toutes les frontières qui se trouvent au centre d’un processus de sécurisation croissante et dont la gestion est de plus en plus privatisée. Ainsi, il est désormais de plus en plus difficile de déterminer où réside la souveraineté politique, car la privatisation des frontières relève d’une dissémination des pratiques souveraines. En exerçant le « décisionnisme » local dont elles sont désormais dotées, les entreprises contribuent en fait à affaiblir la solidité de la souveraineté étatique.
Nous avons précédemment évoqué le lobbying poussant à la sécurisation des frontières, il convient de remarquer également qu’il s’agit d’un cercle auto-entretenu. Ainsi, par exemple, en développant des partenariats avec des entreprises privées de la sécurité, Frontex (agence en charge des frontières extérieures de l’Union européenne) contribue à la sécurisation des politiques migratoires de l’Union européenne, en signalant ces technologies de sûreté et de surveillance comme adéquates pour traiter les questions migratoires [19]. Dès lors que ce ne sont plus des solutions politiques et sociales qui sont perçues comme légitimes mais bien une « course » à la sécurisation et aux nouvelles technologies, les États perdent leur souveraineté aux frontières en déléguant des compétences au secteur privé, perçu comme plus à même de « sécuriser » efficacement ces frontières.
Nous pouvons ainsi souligner l’intérêt politique que peuvent trouver les États à cette perte de souveraineté. Dès lors que ce ne sont plus des solutions politiques, économiques et sociales qui sont attendues face aux questions migratoires mais bien des solutions sécuritaires, cela permet à l’État de se désengager de cet épineux problème, tandis que dans le même temps la réponse sécuritaire satisfait certains intérêts électoralistes. Ainsi, les peurs et résistances liées au processus de mondialisation sont instrumentalisées par les acteurs politiques en synergie avec des acteurs économiques. Dès lors, comme le concluent Florine Ballif et Stéphane Rosière : « les acteurs politiques mènent des teichopolitiques qui renforcent leur légitimité politique vis-à-vis de leur électorat, et les acteurs économiques et financiers transforment ces politiques en plus-values. Ces derniers [sont] encore renforcés dans un contexte de retrait de l’État – qu’ils ont contribué à étayer » [20].
B- La dilution des responsabilités
Une autre question qui se pose lorsqu’on parle de privatisation du contrôle des frontières, et qui est liée à la perte de souveraineté des États que nous avons abordée, est celle de responsabilité face à d’éventuelles « bavures ».
En d’autres termes, il s’agit de savoir qui de l’État ou de l’entreprise privée qui contrôle la frontière est responsable légalement. En effet, les violations du droit ne sont pas rares. Par exemple, le 27 avril 2009, les agents de l’entreprise Securicom opérant dans l’aéroport de Bamako ont refusé de reconnaître la validité des visas de deux membres de l’Association Malienne des Expulsés qui devaient se rendre à Bruxelles pour le lancement de la campagne Frontexit, dont le but est justement de dénoncer les débordements et les abus de l’agence européenne de contrôle des frontières Frontex. Plus grave, le 12 octobre 2010 Jimmy Mubenga, un immigré angolais, meurt par asphyxie lors de son rapatriement encadré par la compagnie G4S, elle-même sous contrat avec la UK Border Agency. Cette mort est restée « inexpliquée » et les agents responsables du rapatriement ont été libérés après un rapide interrogatoire, puisque le Crowd Prosecution Service (CPS, un organe du gouvernement anglais en charge des poursuites judiciaires) avait décidé de ne retenir aucune charge. L’affaire se serait probablement arrêtée là si le journal The Guardian ne l’avait pas largement relayée en menant sa propre enquête sur les pratiques des agents de G4S. Finalement, plus de 21 mois après les faits, le jury du coroner en charge de cette affaire a conclu que la mort de Jimmy Mubenga était due à des comportements illégaux, forçant ainsi le CPS à reconsidérer sa décision de ne pas poursuivre la G4S en justice. Contre la seule G4S, 48 plaintes ont été déposées au cours de l’année 2010, pourtant peu de poursuites sont engagées. Lorsque toutefois une condamnation est prononcée (les cas sont très rares), la justice considère la plupart du temps que l’État ne peut être tenu pour responsable. Dans son essai Xénophobie Business, Claire Rodier ajoute que « les impératifs qui guident une société commerciale – faire du profit – interfèrent forcement de façon négative avec le respect des règles déontologiques et de sécurité qui devraient s’imposer dans les missions délicates comme les expulsions » [21]. Elle note toutefois que les gouvernements et les États ne sont pas pour rien dans l’intensification du nombre de violences faites aux migrants. D’une part elle n’est pas indépendante d’une politique de quotas et de chiffres qui exige que de plus en plus d’immigrés soient reconduits à la frontière. D’autre part, les États ne sont probablement pas sans savoir que les débordements sont courants lors des détentions ou lors des rapatriements (ils ne peuvent ignorer le nombre croissant de plaintes qui ont été déposées contre les firmes qu’ils emploient). En outre, si les gouvernements ferment les yeux sur ces pratiques, c’est peut-être aussi parce qu’elles leur permettent de se dédouaner lorsque ce type d’incidents survient, et que la dilution des responsabilités permet en général aussi bien à la firme qu’à l’État concerné d’échapper à toute condamnation. D’une part la privatisation du contrôle des frontières encourage donc la violation du droit en ce qui concerne le traitement des immigrés et d’autre part elle contribue à la dilution et l’opacité concernant les responsabilités, ce qui rend difficile toute condamnation.
Conclusion
Les problèmes de souveraineté étatique et de brouillage des responsabilités que nous avons pu soulever à travers cette étude risquent fort de se poser avec encore plus d’acuité au cours des décennies à venir. En effet, comme le souligne Rodrigo Nieto-Gomez : « l’infrastructure technologique frontalière se développe selon un processus qui s’est auto-alimenté : la construction d’une nouvelle partie du dispositif réoriente le flux migratoire vers une autre région qui ne connaissait pas, jusque-là, de problème d’immigration clandestine. Ceci attire l’attention vers cette région, et une nouvelle partie du dispositif y est à son tour construite, ce qui réoriente une nouvelle fois le flux vers une autre région » [22], et ainsi la sécurisation et la privatisation des frontières vont croissantes.
Source Diploweb.com le 19/03/14
Copyright Miallet-Philippe/Diploweb.com
. Voir aussi : Rubrique Actualité Internationale, rubrique Géopolitique, On Line, La frontière Mexique USA, Géopolitique de la musique pop , Magistère de relations internationales et action à l’étranger de l’Université Paris I,