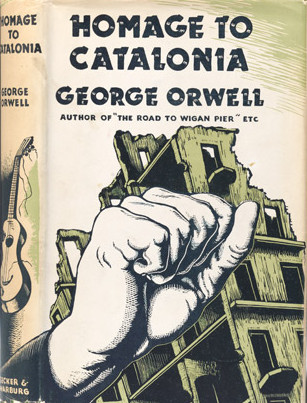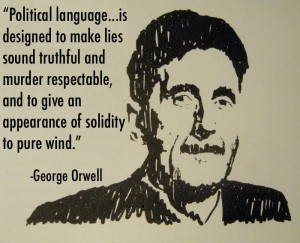Boualem Sansal. En lice pour le Goncourt, l’auteur algérien fait escale à Montpellier pour présenter son roman « 2084 La fin du monde » fenêtre sur le totalitarisme du big brother islamiste.
L’écrivain algérien francophone Boilem Sansal vit à Boumerdès, près d’Alger. Censuré dans son pays d’origine à cause de sa position très critique envers le pouvoir en place et l’obscurantisme islamiste. Il était l’invité de la librairie Sauramps à Montpellier où il a évoqué son dernier roman 2084* La fin du monde.
Dans 2084, vous reprenez la matrice de 1984 d’Orwell pour offrir un panorama de réflexions sur le totalitarisme islamique. Qu’est-ce qui a motivé ce choix ?
La réalité. L’islamisme se propage de manière préoccupante. Sur le plan théorique, il a démarré en 1928 avec la création de l’association des Frères Musulmans et d’une idéologie de reconquête des terres d’Islam puis à travers la volonté d’étendre la prédication à l’ensemble de la planète. Au départ la stratégie reposait sur l’armée et sur un rapprochement avec le peuple. Avec l’idée que la force c’est le peuple, celui qui rendra l’islam invincible. Ensuite ils ont évolué en choisissant de travailler de manière pacifique mais aussi plus insidieuse en empruntant toute une série de techniques au marketing et à la politique, pour conquérir des marchés et des territoires.
A partir de l’Afghanistan on a vu l’islamisme basculer. Cet islamisme radical, a été artificiellement créé par la CIA qui a joué le développement de l’islam comme rempart au communisme afin de préserver l’accès au pétrole. Les Etats-Unis ont trouvé dans cette démarche des alliés très intéressés comme l’Arabie Saoudite et le Qatar. Tout cela est arrivé dans mon pays dans les années 80. On a vu que la démarche commençait par la destruction de l’ordre et de notre manière de vivre.
C’est un roman d’anticipation essentiellement politique. Vous ne décrivez pas d’autres évolutions ?
Un système totalitaire fige la situation. Après la prise du pouvoir, il entre dans une logique nouvelle. Celle de conserver le pouvoir. Et pour cela, met en place une dictature qui efface la langue, la culture, l’histoire, et toutes perspectives d’avenir afin de mettre en place un système carcéral. La pensée des prisonniers s’éteint et finalement, ils ne souhaitent plus être libérés.
Pour l’adversaire à l’obscurantisme déterminé que vous êtes, est-ce que le choix de la fiction permet de mettre en place un appareil critique plus éclairant que l’essai ou l’engagement politique ?
Si vous militez, vous devenez partisan. Par exemple de la démocratie, mais cela reste une vision parcellaire, et du coup, vous ne pouvez pas globaliser votre démarche. Je cherchais à trouver l’élément le plus fédérateur. L’univers romanesque permet de s’adresser à tous. Il transcende les visions partisanes et permet de construire une alliance sacrée contre l’islamisme. L’avantage de la fiction permet peut être de concerner les musulmans tandis que les appels partisans les rebutent parce qu’on critique l’islam qui est une partie d’eux-mêmes.
Quel regard portez-vous sur la révolution de Jasmin et ses suites ?
Connaissant toutes les inhibitions, les freins et les contradictions, religieuses, ethniques, qui traversent ces sociétés, je n’ai jamais cru au Printemps arabe. La démocratie ne se réduit pas au vote. A la base cela suppose une révolution philosophique. Cette révolution ne s’est pas faite dans les pays arabes. On adopte les élections comme on l’a fait en Egypte où en Algérie où les gens ont voté pour Bouteflika. On pourrait dire que c’est une démocratie mais on sait que l’on peut faire voter des ânes et faire élire un âne.
Il semble qu’il se passe quelque chose en Tunisie mais je n’y crois pas à long terme. Les questions fondamentales, comme la religion ou le statut des femmes ne sont pas traitées. La symbolique de la violence reste le pilier de l’Etat, ce qui est propre aux sociétés féodales. Il reste un long chemin, on peut considérer que l’on avance, mais comme on fait un pas en avant un pas en arrière, je n’y crois pas.
La réduction de l’autonomie individuelle passe par le vecteur de la peur, notamment du terrorisme qui conduit l’occident depuis le 11 septembre 2001 à une société sécuritaire. De la même façon, l’intégrisme n’est pas seulement islamique. Ne craignez-vous pas que certaines interprétations de votre livre n’entrent en contact avec l’islamophobie ambiante ?
Lorsque j’écrivais, je voyais à chaque ligne, l’exploitation que l’on pourrait faire de mon travail, dans le bon et le mauvais sens. La société occidentale se radicalise on est dans l’atmosphère des années 30. L’Europe se délite, les contrôles aux frontières sont rétablis.
Cette question est vraiment centrale, est ce que la crainte que sa parole soit exploitée est une raison suffisante pour ne pas dire ? Est-ce qu’on ne fait pas en sorte de nous empêcher de nous exprimer ? Parce que dès qu’on dit un mot, on peut être taxé de raciste, à l’égard des blancs, des noirs, des islamophobes, des anti européens. Les accusations fusent dans tous les sens.
On dit que tel texte est récupéré par l’extrême-droite mais beaucoup de textes sont aussi récupérés par le discours islamiste. Le fait est, que partout dans le monde on ne peut plus parler. Je pense que comme les gens qui prennent les armes pour leur liberté politique, il y a des gens qui doivent se battre pour leur liberté d’expression quelle que soit l’exploitation que l’on peut en faire. Si j’avais tenu compte de ce paramètre, je n’aurais jamais écrit.
Vous dessinez un islam global, sans marquer la différence entre chiites et sunnites qui est actuellement un enjeu géopolitique majeur…
C’est actuel, mais je situe l’action de mon livre dans un siècle. A la différence de l’islamisme qui n’évolue guère, l’islam lui, évolue. Regardez ce qui s’est passé en trente ans. Tout cela est appelé à changer très vite. Dans un siècle, l’islam pourrait très bien se situer entre le chiisme, le sunnisme et la démocratie.
Rejoignez-vous la pensée d’Orwell qui préférait les mensonges de la démocratie au totalitarisme ?
Absolument, j’ai un compagnonnage politique de longue date avec Orwell qui a écrit beaucoup de textes en dehors de son oeuvre romanesque. On a différé sur un point, malgré le fait que j’ai été très tenté de le suivre. 1984 s’articule autour d’une histoire d’amour. J’avais envie de reprendre cela mais dans l’environnement de l’islam, cela paraissait très difficile sur le plan de la narration. Comment envisager l’amour dans un pays où des amoureux de 17 ans mettent des mois pour parvenir à se toucher la main ?
Vous concluez votre livre sur une note positive ; le passage d’une frontière…
C’était pour le plaisir. Après une année à mariner dans cet univers carcéral, j’étais fatigué donc je me suis dit : sois un peu optimiste. Et puis cette idée de frontière qui est là bas et qu’il suffit de franchir m’est apparue très romantique. J’ai succombé à cette porte de sortie en me disant que cela ferait plaisir aux lecteurs.
Recueilli par Jean-Marie Dinh
2084 édition Gallimard 19,50 euros
Source : La Marseillaise 17/10/2015
Voir aussi : Rubrique Livre, Littérature, Littérature Arabe, rubrique Méditerrannée, Moyens Oriens, rubrique Rencontre,