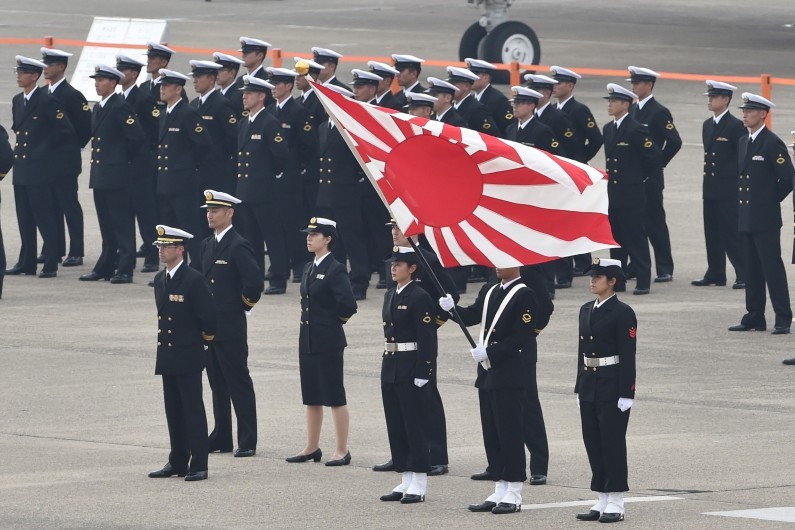Devant un auditoire dense réuni au parc des expositions de Santa Cruz, la capitale économique de la Bolivie, un homme en blanc fustige « l’économie qui tue », « le capital érigé en idole », « l’ambition sans retenue de l’argent qui commande ». Ce 9 juillet, le chef de l’Eglise catholique s’adresse non seulement aux représentants de mouvements populaires et à l’Amérique latine, qui l’a vu naître, mais au monde, qu’il veut mobiliser pour mettre fin à cette « dictature subtile » aux relents de « fumier du diable » (1).
« Nous avons besoin d’un changement », proclame le pape François, avant d’inciter les jeunes, trois jours plus tard au Paraguay, à « mettre le bazar ». Dès 2013, au Brésil, il leur avait demandé « d’être des révolutionnaires, d’aller à contre-courant ». Au fil de ses voyages, l’évêque de Rome diffuse un discours de plus en plus musclé sur l’état du monde, sur sa dégradation environnementale et sociale, avec des mots très forts contre le néolibéralisme, le technocentrisme, bref, contre un système aux effets délétères : uniformisation des cultures et « mondialisation de l’indifférence ».
En juin, dans la même veine, François adressait à la communauté internationale une « invitation urgente à un nouveau dialogue sur la façon dont nous construisons l’avenir de la planète ». Dans cette encyclique sur l’écologie, Laudato si’ (« Loué sois-tu »), il appelle chacun, croyant ou non, à une révolution des comportements et dénonce un « système de relations commerciales et de propriété structurellement pervers ». Un texte « à la fois caustique et tendre », qui « devrait ébranler tous les lecteurs non pauvres », estime la New York Review of Books (2). En France, 100 000 exemplaires de ce petit manuel se sont envolés en six semaines (3).
Voici donc un pontife qui assure qu’un autre monde est possible, non pas au jour du Jugement dernier, mais ici-bas et maintenant. Ce pape superstar, dans la lignée médiatique de Jean Paul II (1978-2005), tranche et divise : canonisé par des figures écologistes et altermondialistes (Naomi Klein, Nicolas Hulot, Edgar Morin) pour avoir « sacralisé l’enjeu écologique » dans un « désert de la pensée » (4) ; diabolisé par les ultralibéraux et les climato-sceptiques, capables de faire de lui « la personne la plus dangereuse sur la planète », comme l’a caricaturé un polémiste de la chaîne ultraconservatrice américaine Fox News.
Les droites chrétiennes s’inquiètent de voir un pape au discours gauchisant et si peu disert sur l’avortement. Et les éditorialistes de la gauche laïque s’interrogent sur la profondeur révolutionnaire de cet homme du Sud, premier pape non européen depuis le Syrien Grégoire III (731-741), qui crie au scandale face au trafic des migrants, appelle à soutenir les Grecs en rejetant les plans d’austérité, nomme « génocide » un génocide (celui des Arméniens), signe un quasi-concordat avec l’Etat de Palestine, appuie son front, façon prière au mur des Lamentations, sur la barrière de séparation que les Israéliens imposent aux Palestiniens (lire « La cérémonie de l’humiliation ») et se rapproche de M. Vladimir Poutine sur la question syrienne quand l’heure, chez les Occidentaux, est aux sanctions contre la Russie en raison du conflit ukrainien.
« Il a remis l’Eglise dans le jeu international », estime Pierre de Charentenay, ancien rédacteur en chef de la revue Etudes, aujourd’hui spécialiste des relations internationales à la revue jésuite romaine La Civiltà Cattolica. « Il a aussi changé son visage. Il est le champion de l’altermondialisme ! A côté de lui, Benoît XVI est un gentil garçon. » Le prédécesseur, en effet, tout en introversion théologique, toujours enclin à condamner, fait figure de rabat-joie à côté du miséricordieux Argentin, plutôt prêt à pardonner. Mais, sur le fond, « sa force est surtout d’interroger l’ensemble d’un système », estime le père de Charentenay.
Voici ce que dit précisément ce premier pape jésuite et américain : l’humanité porte la responsabilité de la dégradation généralisée et laisse le système capitaliste néolibéral détruire la planète, « notre maison commune », en semant les inégalités. Elle doit donc rompre avec une économie de laquelle, comme le dit l’économiste — et jésuite lui aussi — Gaël Giraud, « depuis Adam Smith et David Ricardo, la question éthique est exclue par la fiction de la main invisible » censée réguler le marché (5). Elle a besoin désormais d’une « autorité mondiale », de normes contraignantes et, surtout, de l’intelligence des peuples, au service desquels il convient d’urgence de replacer l’économie. Car la solution, politique, se trouve entre leurs mains, et non entre celles des élites, égarées par la « myopie des logiques du pouvoir ».
Pour le pape, la crise environnementale est d’abord morale, fruit d’une économie déliée de l’humain, où les dettes s’accumulent : entre riches et pauvres, entre Nord et Sud, entre jeunes et vieux. Où « tout est lié » : pauvreté-exclusion et culture du déchet, dictature du court-termisme et aliénation consumériste, réchauffement climatique et glaciation des cœurs. De sorte qu’« une vraie approche écologique se transforme toujours en une approche sociale ». Appelée à se ressaisir, l’humanité doit donc se doter d’une « nouvelle éthique des relations internationales » et d’une « solidarité universelle » — ce que plaidera François à l’Assemblée générale de l’Organisation des Nations unies (ONU) le 25 septembre, à l’occasion du lancement des Objectifs du millénaire pour le développement.
Certes, arguera-t-on, tout cela n’est pas totalement neuf. « François s’inscrit avec une assez belle continuité dans la ligne du concile Vatican II [qui s’est tenu entre 1962 et 1965 et dont le but était d’ouvrir l’Eglise au monde moderne] », constate par exemple à Rome M. Michel Roy, secrétaire général du réseau humanitaire Caritas Internationalis. De fait, le pontife renvoie à l’Evangile, revisite la doctrine sociale de l’Eglise élaborée à l’ère industrielle et, surtout, arrime ses convictions à celles de Paul VI (1963-1978), en qui le père de Charentenay voit son « maître intellectuel et spirituel (6) ».
Premier pape de la mondialisation et des grands voyages intercontinentaux, Paul VI, à la suite du réformateur Jean XXIII (1958-1963), est celui qui a physiquement sorti la papauté de l’Italie, internationalisé le collège des cardinaux, multiplié les nonciatures (ambassades du Saint-Siège) et les relations bilatérales avec les Etats (7). Celui, aussi, qui a amené l’Eglise à outrepasser ses compétences restreintes de gendarme des libertés religieuses pour la rendre « solidaire des angoisses et des peines de l’humanité tout entière (8) ». Pour Paul VI, le développement était le nouveau nom de la paix ; une paix appréhendée non pas comme un état de fait, mais comme le processus dynamique d’une société plus humaine, ouvrant sur une richesse partagée.
Cependant, s’il y a là de la continuité, et même, pour certains, comme un aboutissement du grand chambardement catholique entamé dans les années 1960, il est difficile d’ignorer que le pontife argentin tranche sur ses prédécesseurs. Même s’ils n’étaient pas, eux non plus, avares de discours antilibéraux, les pontificats du Polonais Jean Paul II et de l’Allemand Benoît XVI, ces Saints-Pères la rigueur, ont été marqués par leur ancrage doctrinal. Le dernier a en outre été éclaboussé par quelques « affaires » que l’administration vaticane a eu un certain mal à gérer, tel le scandale VatiLeaks : la diffusion de documents confidentiels accusant l’administration du Saint-Siège de corruption et de favoritisme, notamment pour des contrats signés avec des entreprises italiennes.
Deux types de causes peuvent être avancés au renouveau actuel : les unes tiennent au contexte ; les autres sont inhérentes à l’homme. « Sur un plan éthico-politique, François comble un vide au niveau international », constate François Mabille, professeur de sciences politiques à la Fédération universitaire et polytechnique de Lille et spécialiste de la diplomatie pontificale. Il est le pape de l’après-crise financière de 2008, comme Jean Paul II avait été celui de la fin du communisme. « En procédant à un aggiornamento de la doctrine sociale, François introduit une pensée systémique, c’est-à-dire où tout fait système, et il occupe avec succès le créneau de la sollicitude contestataire. » Il y avait urgence, ajoute Mabille : « Le temps de l’Eglise n’était plus celui du monde. Tout allait bien trop vite pour Benoît XVI. Il y avait une nécessité d’être dans l’anticipation et non plus dans la réaction. »
Avant d’aller secouer le monde, le nouveau pape a donc bousculé sa maison. Adepte d’une sobriété qu’il partage avec François d’Assise, dont il a emprunté le nom, il a instauré, si l’on peut dire, une papauté « normale », qu’il veut exemplaire. Il a remisé au placard les derniers attributs vestimentaires honorifiques de sa fonction et pris demeure dans un deux-pièces de 70 mètres carrés qu’il a préféré aux luxueux appartements pontificaux. Le pape aime le symbole et joint souvent le geste à la parole, ce qui paie dans une société de l’image.
Ainsi, avec une bonhomie qui semble faire de lui le curé du monde, il apparaît direct, spontané, et appelle un chat un chat — au risque de quelques écarts diplomatiques, qu’ensuite porte-parole et nonces parviennent (ou pas) à rattraper. Désigné par ses pairs pour réformer en profondeur la curie, c’est-à-dire l’appareil d’Etat du Saint-Siège, il a listé sans prendre de gants quinze maux frappant l’institution, marquée par un clientélisme à l’italienne. Parmi ces fléaux : l’« Alzheimer spirituel » et, en première place, l’habitude de « se croire indispensable » (9)…
Théologie de la libération non marxiste
Pour gouverner, François s’est entouré d’une garde rapprochée de huit prélats de terrain. Il a lancé des commissions pour réformer les finances et la communication ; multiplié les installations d’experts laïcs pour conseiller son administration ; créé un tribunal au Vatican pour juger les évêques ayant couvert des prêtres pédophiles ; nommé un premier jet d’une quinzaine de nouveaux cardinaux, futurs électeurs de son successeur. Le prochain pape sera choisi a priori de son vivant, comme l’avait voulu Benoît XVI pour lui-même. François l’a répété avant d’aller voir M. Evo Morales en Bolivie et M. Rafael Correa en Equateur : il est, lui, contre les « leaders à vie »…
Ses nouveaux hussards pourpres, le pape les choisit parmi ceux qui sont allés au charbon, là où les plaies sociales sont vives, comme à Agrigente, au diocèse de laquelle appartient Lampedusa, l’île des migrations clandestines. Il va les chercher en Asie, au fin fond de l’Océanie, en Afrique, en Amérique latine, s’affranchissant ainsi de règles non écrites : fini les archidiocèses qui poussaient mécaniquement leurs titulaires vers la haute hiérarchie romaine en augmentant le poids de l’Europe au conclave et, en son sein, celui de l’Italie (10).
« Ce pape brise les tabous, donne des coups de pied dans la fourmilière, sans trop prendre de précautions, constate un diplomate français, observateur de l’action pontificale. Il a compris qu’il était chef d’Etat. La fonction le rattrape. Il est pragmatique et très politique. » Tout cela déteint sur l’Eglise, puisque François « est » l’Eglise, comme il l’a lui-même rappelé, non sans une onction maligne de jésuite « un peu rusé » (c’est ainsi qu’il se définit), à ceux qui s’inquiétaient de savoir si l’institution le suivait.
« On se presse pour le voir ! », se délecte à l’autre bord, côté nonciatures, un conseiller pontifical. En deux ans, plus de cent chefs d’Etat ont été reçus au Vatican. Certains recherchent sa médiation : les Etats-Unis et Cuba, dont il a facilité le rapprochement ; la Bolivie et le Chili, en bisbille quant à l’accès de la première à l’océan (lire « La Bolivie les yeux vers les flots) ; et jusqu’à la guérilla des Forces armées révolutionnaires de Colombie (FARC), qui, lorsqu’il passera à Cuba, demande à bénéficier de son intercession… Ainsi soient les désirs du pape, qui fait rouvrir à Rome un bureau de médiation pontificale. Sans succès garanti : en juin 2014, faire prier ensemble, très médiatiquement, le président palestinien Mahmoud Abbas et le président israélien Shimon Pérès dans les jardins du Vatican n’a pas empêché les meurtrières attaques israéliennes sur Gaza un mois plus tard.
Né en Argentine Jorge Mario Bergoglio, François « est le premier pape qui comprend véritablement les échanges Sud-Sud, que ce soit en matière de biens matériels ou de biens symboliques, religieux, estime Sébastien Fath, membre du Groupe sociétés, religions, laïcités (GSRL) du Centre national de la recherche scientifique (CNRS). Il sait que des prédicateurs africains sont en lien avec des Eglises brésiliennes, que les jésuites indiens partent en mission en Afrique. » C’est un « Latino parfait… qui ne parle pas anglais », complète M. Roy chez Caritas. Petit-fils d’immigrés piémontais, « il fait penser à un pape européen qui aurait quitté l’Europe : une Europe no future ! », reprend notre diplomate français. « Il n’a pas une vision à proprement parler géopolitique du monde », précise M. Roy. Un monde qu’il connaît d’ailleurs peu : François n’a quasiment pas voyagé avant la papauté. « Il pointe d’abord du doigt un système, matérialiste, basé sur la promotion de l’individu, qui détruit les solidarités traditionnelles et plonge les plus fragiles dans la pauvreté. » Pour le conseiller pontifical, « c’est un lanceur d’alerte ! ».
Jadis gamin des faubourgs de Buenos Aires, Bergoglio a cependant sa propre géographie de l’espace : moins une opposition entre Sud et Nord qu’entre un centre et des « périphéries », qu’elles soient spatiales (pays pauvres, banlieues, bidonvilles) ou existentielles (populations précaires, exclus, détenus, etc.). Il y a, dans cette vision, bien des périphéries au Nord et des visages colonialistes dans les circuits globalisés ; et c’est là qu’il veut que son Eglise prioritairement travaille.
Bergoglio a choisi son camp : celui de « l’option préférentielle pour les pauvres » et les « petits », que, dans ses discours, comme à Santa Cruz, il accroche personnellement : « chiffonnier », « ramasseur d’ordures », « vendeur ambulant », « transporteur », « travailleur exclu », « paysan menacé », « indigène opprimé », « migrant persécuté », « pêcheur qui peut à peine résister à l’asservissement des grandes corporations »… C’est un pasteur avec des élans missionnaires très forts, dit-on. Pas un diplomate. Est-ce un problème ? Pour cela, il y a… des diplomates, pilotés par l’expérimenté secrétaire d’Etat du Vatican Pietro Parolin, jadis l’homme de missions délicates au Venezuela, en Corée du Nord, au Vietnam ou en Israël.
Le synode sur la famille bientôt achevé
« Le pape est convaincu que l’avenir repose sur ceux qui sont sur le terrain », reconnaît M. Roy. Il se méfie des organisations (à commencer par la sienne !), dont les dérives mènent, selon lui, à la stérilité des discours autoréférentiels éloignés des réalités. Cela fait de lui un dirigeant à l’approche humaine et managériale très ascendante, constatent les diplomates, alors que ses prédécesseurs étaient totalement vectorisés du sommet vers la base par la transcendance. « Je vous demande votre prière qui est la bénédiction du peuple pour son évêque », a dit François aux fidèles place Saint-Pierre, en inversant les rôles, le jour de son élection.
Cet attachement aux populations, qui lui confère des accents populistes (il a été proche d’un groupe de la Jeunesse péroniste (11)), il l’ancre conceptuellement dans la théologie du peuple, une branche argentine non marxiste de la théologie de la libération (12). La théologie du peuple ? « Une théologie pour le peuple et non par le peuple, résume Pierre de Charentenay pour marquer la différence. Le pape opère une sorte de reprise populaire et culturelle de la théologie de la libération. » Mezza voce, ce n’en est pas moins une réhabilitation. Issue de l’appropriation latino-américaine de Vatican II dans les années 1970, la théologie de la libération était honnie par Benoît XVI et Jean Paul II pour son approche marxisante. En septembre 2013, François recevait en audience privée, à Rome, l’un de ses illustres fondateurs, le père péruvien Gustavo Gutierrez. En mai 2015, il béatifiait Mgr Oscar Romero, l’archevêque de San Salvador assassiné en 1980 en pleine messe par des militants d’extrême droite. Ses prédécesseurs ne s’étaient guère empressés d’instruire la procédure. Selon M. Leonardo Boff, l’un des chefs de file brésiliens du mouvement, la vision de François s’inscrit « dans le grand héritage de la théologie de la libération ». Son règne pourrait même ouvrir sur une « dynastie de papes du tiers-monde » (13).
Mais Bergoglio détonne aussi car il est un vrai chef d’Eglise, un pape manager, le premier à avoir concrètement exercé des responsabilités territoriales, extra-diocésaines, à un niveau national. De 2005 à 2011, il fut président de la Conférence épiscopale argentine (14). Du coup, « les troupes [au Vatican] sont bien mieux organisées, constate un observateur romain, et sa personnalité, son implication personnelle, ont redynamisé la diplomatie du Saint-Siège ».
En dirigeant, François a défini un cap pour sa multinationale. Habilement, il a découplé l’attaque en fonction de la cible. Au grand monde, il donne à son projet l’air connu de l’« internationalisme catholique » (15) : participer à la pacification des relations entre Etats, promouvoir la démocratie, insister sur les structures de dialogue international, sur la justice pour les peuples, le désarmement, le bien commun international ; tous thèmes qui confèrent parfois à l’Eglise catholique des airs de pure organisation non gouvernementale (ONG). Et en interne, à ses collègues cardinaux sur le point de l’élire, le jésuite argentin rappelle l’essentiel : évangéliser, bien sûr. Mais aussi sortir l’Eglise d’elle-même, de son « narcissisme théologique », pour aller sans attendre vers les « périphéries » (16).
Certains semblent n’avoir pas mesuré à qui ils confiaient les clés. Car pour évangéliser, François ne brandit pas sa croix comme Jean Paul II, qui, dès son premier sermon, passait à l’offensive : « N’ayez pas peur ! Ouvrez toutes grandes les portes au Christ (…), ouvrez les frontières des Etats, des systèmes politiques et économiques (17)… » Le pape argentin a un autre sens politique. Il ne rechigne pas à faire travailler l’Eglise avec les mouvements populaires, qui sont bien loin de partager sa foi. Il a compris que si l’Eglise restait universelle, elle n’était plus le centre du monde — tout au plus une « experte en humanité », comme la présentait Paul VI.
Ces nouvelles inclinations ne cachent pas les difficultés. Au Proche-Orient, où François, en 2013, lançait le retour de la diplomatie vaticane en appelant à la paix en Syrie quand la France et les Etats-Unis voulaient en découdre avec le régime de M. Bachar Al-Assad, le Saint-Siège a finalement dû en rabattre face à l’urgence : un an plus tard, il demandait aux Nations unies de « tout faire » pour contrer les violences de l’Organisation de l’Etat islamique (OEI), responsable d’« une espèce de génocide en marche » qui contraignait les chrétiens à l’exode. Les fondamentalismes n’ont que faire du dialogue interreligieux.
De même, en Asie, région perçue comme un gisement de développement, la diplomatie vaticane patine. Si les relations avec le Vietnam sont en cours de réchauffement, en Chine, tout un courant catholique, contrôlé par l’Association patriotique des catholiques chinois, une structure étatique, continue d’échapper à l’évêque de Rome. Certes, François a fait des pas de deux pour amadouer le président Xi Jinping — en évitant notamment une rencontre avec le dalaï-lama — et a reconnu une ordination d’évêque intervenue en juillet à Anyang (province du Henan), ce qui n’était pas arrivé depuis trois ans. Mais la réalité est bien loin des rêves missionnaires : ces derniers mois, rapporte l’agence Eglises d’Asie, les autorités chinoises ont fait détruire par dizaines les croix sur les églises, trop ostensibles, notamment dans la province du Zhejiang. Enfin, en Inde, l’infime minorité catholique (2,3 % de la population) subit régulièrement des atteintes aux biens et aux personnes.
Les obstacles, pour François, ne sont pas qu’en terres lointaines non christianisées. Aux Etats-Unis, où il s’exprimera le 24 septembre devant le Congrès, sa cote de popularité a pris du plomb dans l’aile : de 76 % d’opinions favorables en février, elle a chuté à 59 % en juillet, après l’encyclique et le discours de Santa Cruz, surtout chez les républicains (45 %) (18). Le ton, tout autant que le fond, passe mal. On lui reproche son tropisme latino-américain, son peu de considération pour ce que le capitalisme a pu apporter aux pays pauvres ou ses sermons qui ne proposent pas de solutions (19). A gauche, on suspecte une offensive de charme pour faire passer des pilules plus amères. On remarque qu’il maintient l’opposition doctrinale à la contraception et ne fait pas évoluer celle relative à l’usage du préservatif en matière de lutte contre le sida. Qu’il élude les conséquences de la démographie galopante, aussi problématique que le consumérisme. « La croissance démographique est pleinement compatible avec un développement intégral et solidaire », assure-t-il au contraire. Les conservateurs, eux, le renvoient sèchement à ses attributions théologiques et morales. « Je ne tiens pas ma politique économique de mes évêques, de mon cardinal ou de mon pape », a déclaré M. Jeb Bush, candidat républicain à la Maison Blanche converti au catholicisme il y a vingt ans (20). Le pape ne s’en formalise pas : « N’attendez pas de ce pape une recette » ; « L’Eglise n’a pas la prétention (…) de se substituer à la politique. »
Plus généralement, François est attendu sur les questions de société, au sujet desquelles les orgues vaticanes jouent depuis deux ans en sourdine. En 2014, il a ouvert une boîte de Pandore en demandant aux évêques, réunis en synode, de plancher sur la famille. Les travaux se termineront cette année, en octobre. A plusieurs reprises, il a semblé plaider pour une évolution, sur la question, très sensible dans l’institution, des divorcés remariés privés de communion, ou encore sur l’homosexualité — son retentissant « Qui suis-je pour juger ? », qui ne l’a cependant pas empêché de geler, au printemps, la procédure de nomination auprès du Saint-Siège d’un nouvel ambassadeur de France dont l’orientation sexuelle était stigmatisée, notamment par la curie.
En interne, plus d’un l’attend au tournant. Il veut rompre avec le centralisme romain, développer la collégialité, rendre aux conférences épiscopales leur part d’autorité doctrinale, promouvoir l’inculturation de la liturgie… De quoi chahuter l’unité de son Eglise. Or il a déjà 78 ans… Et la curie, un univers qui lui était inconnu, oppose de belles résistances. « Il s’y casse les dents, observe Pierre de Charentenay. La charrue s’est bloquée dans une terre difficile. » Pour la famille, François appelle « un miracle ». Et pour le reste, rien ne dit pour l’instant que ce pape qui dérange réussira.