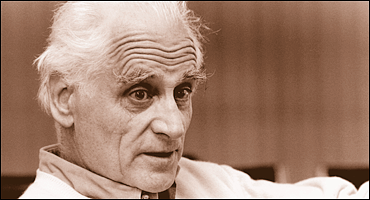Les dernières troupes combattantes américaines ont quitté l’Irak. C’est ce qu’annoncent les Etats-Unis, même si 50 000 de leurs soldats, regroupés sur des dizaines de bases, demeureront encore jusqu’à fin 2011, « en appui » à l’armée irakienne. Ce retrait s’opère conformément à l’accord-cadre stratégique signé par l’administration Bush sur le départ avec le gouvernement irakien à la fin 2008. Le président Obama a décidé de respecter ce texte et d’accélérer le désengagement.
On peut certes prétendre que, par rapport à la situation existante à la fin 2006, avec une insurrection active et des attentats quotidiens meurtriers, le contexte actuel est meilleur. Il faut néanmoins prendre du recul par rapport à cette vision et essayer de dresser un bilan de cette guerre qui ne fut pas seulement une faute, mais un crime dont on aurait tort de dédouaner les Etats-Unis (lire « “Leurs” crimes et les “nôtres” »).
Cette guerre d’agression, non provoquée, déclenchée sous le faux prétexte de chercher des armes de destruction massive, est d’abord une violation des principes des Nations unies qui, le 14 décembre 1974, à travers leur assemblée générale, adoptaient un texte définissant l’agression (PDF). Son article 3 s’énonce ainsi :
« L’un quelconque des actes ci-après, qu’il y ait eu ou non déclaration de guerre, réunit, sous réserve des dispositions de l’article 2 et en conformité avec elles, les conditions d’un acte d’agression :
a) L’invasion ou l’attaque du territoire d’un Etat par les forces armées d’un autre Etat, ou toute occupation militaire, même temporaire, résultant d’une telle invasion ou d’une telle attaque, ou toute annexion par l’emploi de la force du territoire d’un autre Etat ;
b) Le bombardement, par les forces armées d’un Etat, du territoire d’un autre Etat, ou l’emploi de toutes armes par un Etat contre le territoire d’un autre Etat ;
c) Le blocus des ports ou des côtes d’un Etat par les forces armées d’un autre Etat ;
d) L’attaque par les forces armées d’un Etat contre les forces armées terrestres, navales ou aériennes, la marine ou l’aviation civiles d’un autre Etat ».
Au-delà de cette dimension juridique et des querelles qu’elle peut susciter, le bilan de la guerre américaine, menée sans l’aval des Nations unies, est accablant :
— Destruction du pays, de ses structures étatiques et administratives. Il n’existe plus d’Etat irakien qui fonctionne. Sept ans après la guerre, l’électricité arrive à peine quelques heures par jour, la production pétrolière stagne, l’administration ne fonctionne pas, les écoles et les universités sont à l’abandon, etc. Reconstruire une structure unifiée et efficace nécessitera sans doute des décennies.
— Le confessionnalisme, encouragé dès les premiers jours par l’occupant, a été institué dans toutes les fonctions, et la répartition des postes se fait désormais en fonction de l’appartenance communautaire ou nationale. Les principales forces politiques sont « chiites », « sunnites » ou « kurdes ». Et demeurent une série de bombes à retardement, comme la délimitation des « frontières incertaines du Kurdistan ». La question de Kirkouk, où un référendum est prévu depuis décembre 2007 (et sans cesse reporté) pour décider du rattachement ou non de cette ville à la région autonome du Kurdistan, n’est pas le moindre des défis.
— Le bilan humain est terrible. Si on connaît précisément les pertes américaines (environ 4 400 tués), celles des Irakiens ont fait l’objet d’évaluations très diverses : on ne recense pas un mort « arabe » comme on recense un mort « occidental » ; seul ce dernier a un visage. Entre cent mille et plusieurs centaines de milliers de personnes tuées, des milliers de disparus, des centaines de milliers de personnes déplacées et de réfugiés (notamment en Syrie – lire Theodor Gustavsberg, « Silencieux exil des Irakiens en Syrie » – et en Jordanie), des centaines de milliers de blessés.
— Malgré les coups qui lui ont été portés depuis 2007, Al-Qaida, qui, rappelons-le, était absente d’Irak jusqu’en 2003, s’y est implantée. Elle garde des structures efficaces, comme le prouvent les attentats coordonnées de ce mois d’août 2010. Des milliers de combattants du monde arabe et musulmans ont transité ces dernières années par l’Irak et ont ensuite porté le combat en Afghanistan, en Somalie, au Liban, en Afrique du Nord.
Seul point positif, la chute de la dictature de Saddam Hussein, l’une des plus brutales de la région. On ne peut que s’en féliciter, mais cela valait-il de telles souffrances ? D’autant que le risque est grand de voir émerger un « pouvoir autoritaire à dominante chiite ».
Et la question que personne ne posera : qui sera jugé pour ce crime ? Comment s’étonner que nombre de pays ne suivent pas le Tribunal pénal international quand il inculpe le président soudanais Omar Al-Bachir, ou des criminels de tel ou tel petit pays africain, alors que MM. George W. Bush, Dick Cheney et Donald Rumsfeld continuent tranquillement à couler des jours heureux en donnant des conférences sur le monde libre, la démocratie et le marché pour quelques dizaines de milliers de dollars la prestation ?
Personne n’affirme plus que les Etats-Unis ont gagné la guerre en Irak, surtout si l’on se reporte aux objectifs initiaux du président George W. Bush : installation à Bagdad d’un gouvernement allié, prêt à collaborer avec Washington, à lui accorder des bases et disposé à établir des relations diplomatiques avec Israël ; ouverture des ressources de l’Irak au marché libre ; démocratisation du Proche-Orient ; isolement du régime iranien.
Personne n’explique plus doctement que, certes, la guerre était une erreur, mais que si les Etats-Unis se retiraient ce serait encore pire. Il faut le répéter : c’est la présence américaine qui est la cause de l’instabilité, et non l’instabilité qui nécessite la présence américaine.
Les conséquences régionales de cette guerre sont aussi graves. Incontestablement et paradoxalement, elle a renforcé le poids de l’Iran, même s’il ne faut pas croire que les chiites irakiens regardent tous vers Téhéran, ni sous-estimer le poids du nationalisme irakien et arabe. L’absence de pouvoir central entraîne forcément l’ingérence des puissances voisines dans les affaires irakiennes : ni la Turquie, ni l’Arabie saoudite, ni la Syrie, ni bien évidemment l’Iran ne s’en privent. Ankara a ouvert plusieurs consulats, dont un à Bassorah, dans le sud chiite ; il a aussi développé ses relations avec le pouvoir autonome kurde, ce qui n’a pas mis un terme à ses bombardements contre les forces du PKK réfugiées au Kurdistan.
Quel est désormais le poids des Etats-Unis en Irak ? Les élections de mars 2010 ont débouché sur une impasse et le pays n’a toujours pas de gouvernement. Quatre forces se partagent le Parlement : un bloc kurde qui représente une région vivant sous autonomie de fait ; le bloc du premier ministre en exercice Nouri Al-Maliki, à majorité chiite ; le bloc de l’ancien premier ministre Iyad Allaoui, chiite qui a obtenu le vote de nombreux sunnites ; et, enfin, l’Alliance nationale composée de l’organisation de Moqtada Al-Sadr et du Conseil suprême islamique, deux formations chiites.
Joost Hiltermann, dans un article de la New York Review of Books (19 août 2010) intitulé « Iraq : The impasse », remarque :
« Ce qui est frappant avec l’approche actuelle de l’administration Obama n’est pas seulement sa préférence pour un parti donné, celui de Allaoui en l’occurrence, mais son manque de volonté inexplicable de pousser pour une solution donnée, un fait que tous les politiciens ont noté. Les Etats-Unis essaient d’exercer une forte pression uniquement de manière sporadique, sous la forme d’une visite du vice-président Joe Biden, l’envoyé spécial de facto de l’administration en Irak. » Mais leurs tentatives d’obtenir la formation d’un gouvernement d’unité entre Maliki et Allaoui avant leur retrait n’ont pas abouti. Et Hiltermann de conclure que les Etats-Unis sont « une puissance en déclin » en Irak.
Ce n’est pas l’avis de tous les commentateurs, comme en témoigne un éditorial de Seumas Milne dans le quotidien britannique The Guardian (4 août 2010), « The US isn’t leaving Iraq, it’s rebranding the occupation ». Pour Milne, les Etats-Unis donnent simplement un autre visage à une occupation qui se poursuit sous d’autres formes.
Alexander Cockburn lui répond vertement dans « Thank You, Glenn Beck ! » (CounterPunch, 27-29 août). Il reprend certains arguments de Rosen et explique aussi que, sur le pétrole, pour l’essentiel, ce ne sont pas les compagnies pétrolières américaines qui ont bénéficié des premiers contrats passés, mais des sociétés russe, norvégienne, chinoise, malaisienne, etc.
Alors, poursuite de l’occupation sous d’autres formes ou non ? Ce qui est sûr, c’est que, en ce XXIe siècle, aucune puissance ne peut gouverner durablement un pays étranger, lui imposer sa volonté. A ceux qui rêvaient d’un retour de l’empire, la guerre d’Irak a apporté un démenti flagrant. Un démenti qui sera confirmé demain en Afghanistan.
Alain Gresh*
*Alain Gresh est directeur adjoint du Monde Diplomatique, spécialiste du Proche Orient. Il est notamment l’auteur de Israël Palestine, vérités sur un conflit (Fayard 2007).
Voir aussi : Rubrique Irak, Une série d’attentats marque l’ouverture des élections , Pétrole contre nourriture L’Irak demande des réclamations, Le président irakien vient conclure des contrats à Paris, Rubrique Afghanistan, Enlisement total , Rubrique Turquie : l’UE est une machine kafkaïenne, Lien On Line Le blog d’Alain Gresh Nouvelles d’Orients,



 La partie internationale du livre est une jolie balade au pays des tontons flingueurs en chef de la planète : Kadhafi, Bush, Hu Jintao, Poutine… Est-ce ce regard déformé par la pratique professionnelle qui conduit Plantu à percevoir l’essentiel ? Ou l’esprit d’indépendance cher et incorruptible qui le pousse à prendre position ? Toujours est-il que son propos fait mouche dans le grand bastringue de l’info. Déjà pas cire-pompe à la Une du Monde où son regard contraste en clair avec l’obscure collision de certains éditos, Plantu l’est encore moins quand il a quartier libre. La sélection de dessins du livre comporte quelques épreuves où il passe la ligne jaune. Pour autant, Plantu ne se lève pas le matin pour le plaisir de dézinguer une personnalité politique. C’est ce qui assure la longévité de son parcours. Il faut savoir rester frais dans la pratique d’un art qu’il définit comme « un savant dosage entre la provocation, la colère et le respect de la personne humaine. » Pour 2008, la couverture du livre arrive en guise de synthèse avec cette grosse rose qui roupille dans ses petites baskets rue de Solferino et le titre qui tombe d’évidence.
La partie internationale du livre est une jolie balade au pays des tontons flingueurs en chef de la planète : Kadhafi, Bush, Hu Jintao, Poutine… Est-ce ce regard déformé par la pratique professionnelle qui conduit Plantu à percevoir l’essentiel ? Ou l’esprit d’indépendance cher et incorruptible qui le pousse à prendre position ? Toujours est-il que son propos fait mouche dans le grand bastringue de l’info. Déjà pas cire-pompe à la Une du Monde où son regard contraste en clair avec l’obscure collision de certains éditos, Plantu l’est encore moins quand il a quartier libre. La sélection de dessins du livre comporte quelques épreuves où il passe la ligne jaune. Pour autant, Plantu ne se lève pas le matin pour le plaisir de dézinguer une personnalité politique. C’est ce qui assure la longévité de son parcours. Il faut savoir rester frais dans la pratique d’un art qu’il définit comme « un savant dosage entre la provocation, la colère et le respect de la personne humaine. » Pour 2008, la couverture du livre arrive en guise de synthèse avec cette grosse rose qui roupille dans ses petites baskets rue de Solferino et le titre qui tombe d’évidence.