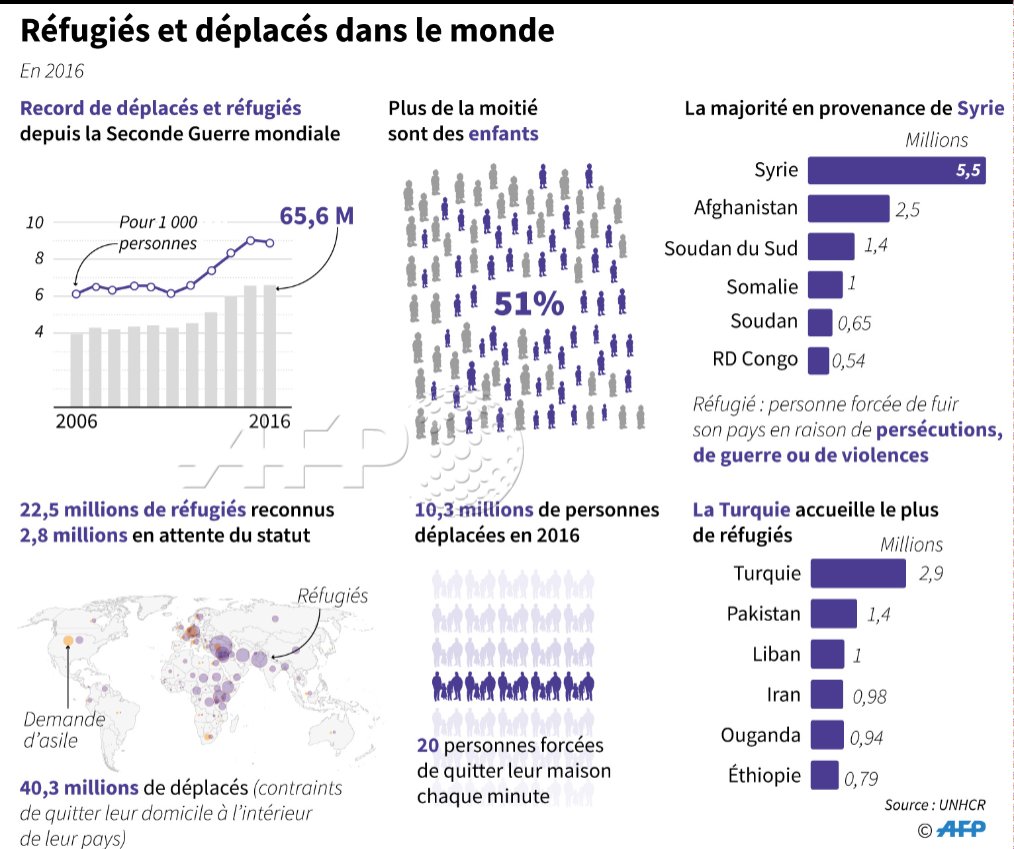Dans une vidéo diffusée sur les réseaux sociaux hier, Emmanuel Macron, préparant un discours, s’exclamait : « On met un pognon de dingue dans des minima sociaux, les gens sont quand même pauvres. On n’en sort pas. Les gens qui naissent pauvres, ils restent pauvres. Ceux qui tombent pauvres, ils restent pauvres. On doit avoir un truc qui permet aux gens de s’en sortir ! »
Le ton familier utilisé par le président a pu choquer ou susciter le sarcasme. Mais au-delà de la forme, il s’inscrit dans la droite ligne des différentes prises de position de ses ministres ou des membres de la majorité ces dernières semaines. Que ce soit Gérald Darmanin, le ministre de l’Action et des Comptes publics, ou encore Bruno Le Maire, le ministre de l’Economie, plusieurs voix se sont déjà élevées pour pointer du doigt des aides sociales trop nombreuses, trop coûteuses et finalement peu efficaces.
Un credo qu’Emmanuel Macron a encore martelé ce mercredi devant le congrès de la Mutualité française, où il a déclaré que « la solution n’est pas de dépenser toujours plus d’argent ». A quoi bon, en effet, dépenser autant d’argent si cela ne permet pas de sortir les gens de la pauvreté ?
Les vertus du modèle social français
Cependant, si le président de la République a raison de rappeler que la pauvreté est une situation de laquelle on hérite trop souvent, il est faux de dire qu’il est impossible d’en sortir. Mieux encore, le « truc » qui permet aux gens de s’en sortir existe, et est clairement identifié : il s’agit de notre système fiscal (les impôts) et notre système de redistribution, via les prestations sociales (RSA, prime d’activité, allocations logements, etc).
Les prestations sociales coûtent cher en effet, et sans doute le système n’est-il pas parfait. Mais il est loin d’être inefficace ! En 2014, les impôts et prestations sociales ont en effet fait baisser le taux de pauvreté de 7,9 points. En clair, les aides sociales (et les impôts) ont permis à 4,9 millions de personnes de sortir de la pauvreté cette année-là.
L’efficacité du modèle social français ressort encore mieux lorsqu’on compare ses performances à celle des autres pays européens. Avec 13,6 % de pauvres dans la population, la France est bien en dessous de la moyenne européenne (17,3 %), de l’Allemagne (16,5 %), du Royaume-Uni (15,9 %) ou encore de l’Italie (20,6 %).
Or, non seulement il y a relativement moins de pauvres en France qu’ailleurs, mais ces derniers sont mieux lotis dans l’Hexagone que dans le reste de l’Union européenne. C’est flagrant quand on s’intéresse à l’intensité de la pauvreté. Cet indicateur mesure l’écart entre le niveau de vie moyen des personnes pauvres et le seuil de pauvreté. En France, par exemple, le seuil de pauvreté est officiellement fixé à un peu plus de 1 000 euros. Mais est-ce que la plupart des pauvres ont un niveau de vie situé juste en dessous, vers 950 euros, ou disposent-ils de beaucoup moins, comme 600 euros ? Autrement dit, les pauvres sont-ils pauvres, très pauvres ou très très pauvres ?
A l’aune de cet indicateur, la France est l’un des meilleurs élèves de la classe européenne : l’intensité de la pauvreté y est de 16,6 %, nettement sous la moyenne européenne (25 %). Ce qui veut dire qu’en France, les pauvres ont un niveau de vie relativement proche du seuil de pauvreté. A l’inverse, en Roumanie, en Grèce, en Espagne et en Bulgarie l’intensité de la pauvreté dépasse les 30 %, signe que ces pays cumulent un fort taux de pauvreté et des inégalités élevées.
Au-delà de la pauvreté stricto sensu, les inégalités de revenus sont plutôt contenues en France. C’est ce que montre le rapport interdécile, c’est-à-dire le rapport entre le revenu plancher des 10 % les plus aisés et le revenu plafond des 10 % les plus modestes. C’est l’indicateur qui est couramment utilisé pour mettre en évidence les écarts de revenus entre riches et pauvres. Ce ratio est de 3,5 en France, deux fois moins qu’aux Etats-Unis ! On est plus proche en réalité du modèle des pays scandinaves que du modèle anglo-saxon. Enfin, pour le moment…
Et qu’on ne s’y trompe pas : c’est bien le système de redistribution français qui permet de limiter à la fois la pauvreté et les inégalités. Comme nous l’avons détaillé dans un précédent article, les 10 % de personnes les plus pauvres disposent d’un niveau de vie moyen de 3 080 euros par an et par unité de consommation, contre 72 690 euros pour les 10 % les plus aisées, soit 24 fois plus. Après redistribution, ce rapport passe à 6 ! Les 10 % les plus pauvres voient leur niveau de vie grimper à 9 860 euros tandis que celui du dixième le plus riche tombe à 55 800 euros. Et ce sont les prestations sociales qui sont le plus efficaces en la matière, comme le précise l’Insee.
L’impact local de la redistribution
Ce qui est vrai à l’échelle nationale, l’est aussi à l’échelle régionale. La France est loin d’être homogène en matière de niveau de vie. Mais sans les prestations sociales et les impôts, le fossé entre régions serait bien plus grand. Avant redistribution, le rapport interdécile s’élève à 7,6 en Ile-de-France, 6,8 en Paca et 6,5 dans les Hauts-de-France. Après redistribution, il se réduit assez nettement, notamment là où les inégalités étaient les plus fortes. On passe ainsi de 7,6 à 4,5 en Ile-de-France, et de 6,5 à 3,3 dans les Hauts-de-France. A Paris, une fois passé à la moulinette de notre modèle social, le rapport interdécile chute de 4,5 points, en Seine-Saint-Denis et dans les Bouches-du-Rhône, les inégalités sont divisées par deux.
Car il faut bien avoir en tête que les aides sociales soi-disant « inefficaces » représentent près de la moitié du revenu des plus modestes en Hauts-de-France ! Au niveau départemental, la part des prestations sociales dans le revenu disponible des 10 % de la population ayant les revenus les plus bas grimpe à 52 % dans le Nord, 50 % dans le Pas-de-Calais ou 48,7 % en Seine-Maritime.
On peut certes critiquer le mille-feuille de notre système fiscalo-social, sa complexité. Certaines prestations sont sans doute mal calibrées, tandis que notre fiscalité pourrait être plus redistributive. Tout cela est vrai. Mais il ne faut pas oublier pour autant que le modèle social français, dans l’ensemble, fonctionne plutôt bien. Et couper dans les aides sociales aura des conséquences immédiates et très concrètes pour de nombreuses personnes…
Laurent Jeanneau, Vincent Grimault et Xavier Molénat