Depuis l’avènement du conflit syrien, le gouvernement libanais œuvre sans relâche pour faire face aux conséquences économiques et sociales, et autres retombées du conflit sur le Liban, dont un flux de réfugiés d’une ampleur sans précédent. Le Liban, déjà pays le plus densément peuplé de la région, porte le poids principal de la présence de réfugiés. En effet, il est devenu le plus grand pays d’accueil à la fois en nombre absolu, et en comparaison avec la taille de son territoire et sa faible population. Dans cette crise, le peuple et le gouvernement libanais, aux prix de grands efforts, font preuve d’une compassion et solidarité manifestes envers la détresse et le désespoir des réfugiés. Toutefois, les ressortissants syriens représentent déjà plus du quart de la population résidente du Liban et cette proportion ne cesse d’augmenter. Devant ce fait, il devient impératif qu’une politique rationnelle émanant d’un consensus national solide soit adoptée pour mettre en place des solutions réalistes et appropriées. Cet afflux peut donner lieu à des divisions susceptibles, à terme, d’affaiblir la cohésion nationale au sein de la société libanaise, et d’élargir le fossé de discorde et d’inimitié qui se creuse entre réfugiés et communautés d’accueil.
Outre la question des réfugiés, la guerre en Syrie a des retombées directes et indirectes sur l’économie libanaise. Cela s’est notamment traduit par le déclin de l’investissement, la perte d’emploi, la perturbation des routes commerciales et l’émergence d’un environnement peu propice au tourisme ainsi que la baisse des recettes du Trésor. Au Liban, ces effets négatifs sont substantiels vu la dépendance profonde de l’économie sur le secteur des services qui représente 75 % du produit économique, et est fortement vulnérable aux risques politiques et à l’insécurité.
Dans ce cadre, le Premier ministre a demandé à la Banque mondiale et aux Nations unies d’aider les autorités libanaises à mesurer l’impact multidimensionnel et le coût économique de cette situation, afin de mieux cibler et d’améliorer l’efficience de l’appui de la communauté internationale au Liban sur ce dossier, et l’amener à supporter la charge de cette crise majeure dont le Liban n’est en rien responsable.
Pour ce faire, la Banque mondiale a examiné les effets à court et long terme de cette crise sur le développement économique et social, en mettant l’accent sur : l’incidence du conflit sur le produit intérieur brut ; la capacité amoindrie de l’État à satisfaire la demande sans cesse croissante des réfugiés dans les domaines de l’éducation et la santé, et les secteurs divers de l’infrastructure ; et les conséquences de la crise sur les finances publiques. L’étude n’aborde pas l’aide humanitaire selon l’hypothèse que cette dernière sera toujours fournie par les agences humanitaires spécialisées. Les questions de sécurité et leurs retombées financières étaient au-delà des termes de référence de l’évaluation de la Banque mondiale.
Les principales conclusions de cette évaluation en termes de coûts économiques et budgétaires sur la période 2012-2014 appellent à la prudence et la circonspection, d’autant qu’elles ne reflètent que les conditions actuelles d’une crise encore en voie d’évolution, sans aucune visibilité quant à sa durée de stabilisation. Les effets du conflit se font sentir à plus d’un niveau. Tout d’abord sur l’économie nationale, par un manque à gagner de 7,5 milliards de dollars en PIB. Ensuite, sur le Trésor public, par un coût de 5,1 milliards de dollars, dont 1,1 milliard de dollars en dépenses budgétaires courantes pour les services fournis aux réfugiés, tels que les soins médicaux dans les hôpitaux publics, l’éducation dans les écoles publiques, et les subventions pour l’électricité et autres services et produits de consommation ; 2,5 milliards de dollars en investissements supplémentaires nécessaires pour maintenir l’accès aux services à leur niveau d’avant la crise en 2011, par exemple le nombre d’heures d’approvisionnement en électricité par jour pour 4 millions de résidents libanais et 1,2 million de ressortissants syriens ; et 1,5 milliard de dollars en diminution de recettes publiques résultant de l’affaiblissement de l’économie.
Les coûts sociaux sont tout aussi dévastateurs, car l’afflux massif de réfugiés augmente sensiblement l’offre de la main-d’œuvre, exerçant par là une pression à la baisse sur les niveaux des salaires. Pour les citoyens libanais, les conséquences sociales en sont désastreuses et se traduisent par la hausse des taux de chômage à près du double de leurs niveaux actuels, en particulier parmi les travailleurs non qualifiés dans les régions les plus pauvres (Nord et Békaa) qui, par le hasard de la géographie, abritent le plus grand nombre de réfugiés ; et l’ajout de 170 000 personnes au million de Libanais qui vivent en deçà du seuil de la pauvreté.
L’amplitude des coûts dérivés de l’analyse devrait soulever auprès des responsables comme des donateurs de graves préoccupations quant à la viabilité des politiques qui régissent actuellement les programmes d’assistance aux réfugiés, et ce à la lumière de coûts poussés à la hausse par les flux de réfugiés sans cesse grandissants. Ces conclusions soulignent la nécessité impérative pour le gouvernement de réévaluer ces politiques, notamment la nature et le contenu du programme de services offerts par secteur, ainsi que la gouvernance et le cadre organisationnel dans lequel l’aide est fournie. En outre, le gouvernement doit continuer d’explorer de nouveaux mécanismes et outils financiers susceptibles d’accroître et d’optimiser les flux de financements extérieurs reçus par les institutions libanaises, et qui jusqu’ici se sont avérés négligeables.
En conclusion, pour assurer de façon réaliste la viabilité du programme d’assistance aux réfugiés, les modifications à apporter à l’ensemble des services offerts doivent être basées sur le principe d’airain que les réfugiés se trouvent au Liban en des circonstances exceptionnelles et à titre temporaire dans l’attente de leur retour en Syrie, leur patrie.
Le devoir moral des autorités libanaises au cours de cette période par définition limitée est d’offrir, dans les domaines essentiels, un niveau abordable de services de base conforme aux normes appliquées de par le monde aux réfugiés de guerre dans des situations critiques comparables. Ne bénéficieraient de ces prestations que ceux qui seraient admis au Liban à titre de réfugié de guerre dûment qualifié selon des critères établis et vérifiés par les autorités libanaises. Les services publics et sociaux que les citoyens libanais sont habilités à recevoir ne peuvent plus constituer, en termes d’accès et de qualité, la référence qui définit l’aide apportée aux réfugiés. L’inexorable loi du nombre rend d’ailleurs cette approche aujourd’hui inabordable.
Si elle devait être poursuivie, une politique qui en termes de services offrirait le même niveau de prestations au réfugié qu’au citoyen, serait de fait une politique non déclarée visant à promouvoir, indépendamment de toute considération de sécurité, une immigration économiquement motivée de la Syrie vers le Liban voisin, facilement accessible et accueillant, où le niveau de vie mesuré par le revenu par habitant est de 3 à 4 fois plus élevé qu’en Syrie, et où les ressortissants syriens qui le souhaitent peuvent, par simple enregistrement, accéder à des services publics gratuits ou largement subventionnés. Pour illustrer comment le paquet de services offert jusqu’ici aux réfugiés peut être une incitation effective à l’immigration économique, il suffit de noter qu’en moyenne les coûts au Liban de l’éducation par élève syrien (2 300 dollars), ajoutés aux coûts des soins de santé par réfugié (400 dollars), actuellement dépasseraient à eux seuls le revenu total moyen par habitant de Syrie.
Voir aussi : Rubrique Moyen-Orient, Liban, Syrie, rubrique Géopolitique, rubrique Politique de l’immigration, rubrique Rencontre, Amin Maalouf

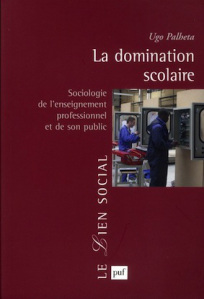
 Il est cependant regrettable que Palheta ne se réfère jamais, ni au fil de son texte, ni dans sa bibliographie, au travail antérieur d’Aziz Jellab, publié en 2008 aux presses universitaires du Mirail et intitulé Sociologie de l’enseignement professionnel. Même si le livre de Jellab ne s’inscrit pas aussi rigoureusement que celui de Palheta dans l’héritage de la sociologie de la reproduction, il n’en est pas moins tout à fait sérieux. Il s’appuie sur un mise en perspective historique tout aussi complète que celle de Palheta, et surtout il met déjà bien en évidence les clivages internes propres au public des LP, notamment en termes de stéréotypes de genre, ce qui constitue un des passages forts du livre de Palheta.
Il est cependant regrettable que Palheta ne se réfère jamais, ni au fil de son texte, ni dans sa bibliographie, au travail antérieur d’Aziz Jellab, publié en 2008 aux presses universitaires du Mirail et intitulé Sociologie de l’enseignement professionnel. Même si le livre de Jellab ne s’inscrit pas aussi rigoureusement que celui de Palheta dans l’héritage de la sociologie de la reproduction, il n’en est pas moins tout à fait sérieux. Il s’appuie sur un mise en perspective historique tout aussi complète que celle de Palheta, et surtout il met déjà bien en évidence les clivages internes propres au public des LP, notamment en termes de stéréotypes de genre, ce qui constitue un des passages forts du livre de Palheta.


