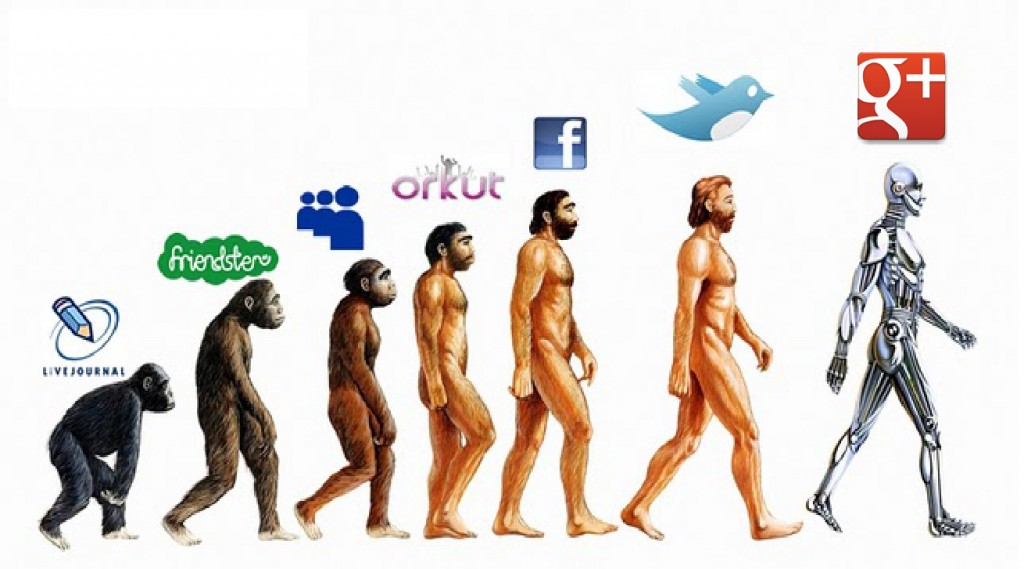N’a-t-on pas, en titrant que François Hollande avait, lors de sa conférence de presse, fait ses « adieux à la gauche », été prisonniers de vieux réflexes idéologiques pavloviens ?
Après tout, ce n’est pas la première fois que la gauche se glisse dans l’eau de « l’offre ». Ce que nous vivons a un petit parfum du début des années 80. A cette époque, la gauche découvrait l’entreprise. Avec la ferveur du converti. Elle en faisait une « valeur », la présentant comme la cellule de base de la création de richesses. En octobre 1985, devant un parterre de patrons, lors du Forum de L’Expansion, Michel Rocard pouvait déclarer, non sans provocation :
La question n’est pas si simple, car il existe, en France, de nombreuses gauches : étatiste, libertaire, productiviste, écologiste, autogestionnaire, européenne, eurosceptique, etc.
Leur point commun, c’est l’idée qu’il faille construire une société dans laquelle l’intérêt général prendrait le pas sur les intérêts particuliers, les inégalités sociales seraient limitées, et les plus fragiles seraient protégés contre les duretés de la vie.
Pour construire une telle société, la gauche prône une politique reposant sur cinq piliers :
Aujourd’hui, dans la formulation de ses priorités, force est de constater qu’il s’est bien éloigné de ce socle idéologique. Depuis novembre 2012, il a pris comme cap la compétitivité des entreprises, et il prend des mesures allant dans ce sens. Il n’hésite pas à prélever des impôts chez les ménages (TVA) et à alléger sans contrepartie les charges des entreprises (CICE).
Lorsque, dans les années 1980, le PS se laisse pour la première fois tenter par les sirènes de l’offre, celle-ci était idéologiquement à la mode.
Ronald Reagan et Margaret Thatcher étaient passés par là. Ils avaient promu « l’économie de l’offre » ( « supply-side economics »), en rupture avec la pensée keynésienne alors encore dominante et qui privilégiait, comme moteur de l’économie, la demande : les consommateurs.
En arrivant au pouvoir, Reagan a prôné la levée des contraintes fiscales et règlementaires sur les entreprises pour libérer l’initiative privée et l’investissement. La France, quelques années plus tard, a emboîté le pas. La gauche était aux commandes, partie à la chasse de ses propres archaïsmes sous l’influence de clubs d’intellectuels et d’hommes d’entreprise comme la Fondation Saint-Simon.
Pendant sa conférence de presse, François Hollande n’a pas hésité à déclarer :
« L’offre crée même la demande. »
Un axiome posé par Jean-Baptiste Say, économiste français du début XIXe siècle, héros des libéraux, qui considérait que « c’est la production qui ouvre des débouchés aux produits » (loi de Say). L’idée : quand vous créez un produit, vous ouvrez, par la valeur créée par ce produit, un débouché pour d’autres produits. Agir sur la consommation ne sert donc à rien.
La conséquence de cette loi, c’est que l’économie retrouve, à long terme, l’équilibre, de façon automatique. Plus tard, Keynes a démoli la loi de Say :
« A long terme, nous serons tous morts. Les économistes se fixent une tâche peu utile s’ils peuvent seulement nous dire que, lorsque l’orage sera passé, l’océan sera plat à nouveau. »
Pour Keynes, dans les situations de sous-emploi, l’Etat doit agir sur la demande afin de relancer la machine économique : en baissant les impôts ou en augmentant les dépenses publiques.
3 Hollande avait-il le choix ? La question du « taux de marge »
Au sein du gouvernement, on explique volontiers que le Président n’avait, de toute façon, guère le choix. L’appareil productif de la France se délite rapidement, et il faut intervenir pour que cette dégradation cesse.
L’ampleur du problème est généralement illustrée par le taux de marge des entreprises. Il mesure ce qui reste une fois que l’on a distribué les salaires et payé ses fournisseurs. C’est la mesure de la rentabilité d’une entreprise. Plus le taux de marge est important, plus il est facile d’investir sans avoir à trop s’endetter.
En 1970, le taux de marge des sociétés produisant des biens et services non financiers était de 30%. Lorsque la gauche est arrivée au pouvoir en 1981, il était tombé à 25%. Lorsque Rocard pavanait devant les entrepreneurs du Forum de L’Expansion, en octobre 1985, il était remonté à 27%. A la fin des années 80, il s’est établi à plus de 30% et s’est maintenu à ce niveau.
La crise de 2008 l’a de nouveau affecté : au troisième trimestre 2013, le taux de marge est tombé à 27,7%, le plus bas niveau depuis plus de 25 ans. Et le plus bas niveau d’Europe.
Explications généralement avancées : les entreprises n’ont pas suffisamment réduit leurs effectifs pour s’adapter à la baisse d’activité, les salaires ont, pendant cette période de creux, continué à augmenter…
Le taux de marge en Allemagne dépasse 40%, celui que l’on constate en moyenne dans l’Union européenne est de 37%.
Grave ? Préoccupant, oui. Maintenant, quel est le remède ? Le Medef et le gouvernement suggèrent de baisser les cotisations patronales : donner de l’oxygène à l’offre.
Mais on peut prendre le problème par l’autre bout du raisonnement : la baisse du taux de marge a été causée par la baisse de l’activité économique, consécutive à la crise financière. Les entreprises paient autant de salaires et de cotisations qu’avant, mais leurs ventes ont baissé. Si l’on relançait l’activité, on rétablira donc le taux de marge : il faut pour cela agir sur la demande.
La gauche préfère généralement privilégier cette seconde voie. Car si vous baissez les cotisations des entreprises, il faut soit réduire d’autant les dépenses publiques, soit transférer leur charge vers les ménages.
François Hollande considère que cette voie-là, la relance, est impossible. Il a fait du rétablissement des comptes publics une de ses priorités et il a renoncé à « renverser la table » européenne afin de provoquer une remise en question des politiques d’austérité. Il s’est résigné à suivre une voie qui n’était pas prévue dans son programme électoral, une voie éloignée des politiques économiques de gauche : la politique de l’offre.
4 Le pacte de responsabilité peut-il créer des emplois ?
L’idée du « pacte de responsabilité » est un donnant-donnant : moins d’impôts et de charges pour les entreprises, plus d’emplois pour la société.
Le raisonnement est le suivant : on allège les charges des entreprises, elles reconstituent leurs marges, elles peuvent investir. Si elles investissent, elles embaucheront et elles participeront à la reprise économique.
C’est faire le pari que la décision d’investir dépend de la santé financière et d’elle seule. En réalité, elle dépend de bien d’autres facteurs, à commencer par le niveau de la demande.
Le pari peut fonctionner pour certaines entreprises exportatrices, celles qui visent des marchés en croissance : les débouchés existent. Pour les autres, c’est bien plus aléatoire.
Si les entreprises ne jouent pas le jeu, on risque de se retrouver avec, d’un côté, de plus gros dividendes et, de l’autre, une sécurité sociale fragilisée ou un pouvoir d’achat affecté (car la baisse des cotisations familles sera financée par une baisse des prestations ou par une hausse des prélèvements sur les ménages). François Hollande a assuré qu’il ne s’agissait pas de prendre aux ménages pour donner aux entreprises, mais c’est un risque qu’il prend pourtant.
Rien ne peut en effet obliger une entreprise à embaucher. Pierre Gattaz, le patron du Medef, a beau évoquer la création d’un million d’emplois sur cinq ans, il est bien placé pour savoir que cette projection n’a pas grand sens. Dans les années 80, son père et prédécesseur à la tête du patronat avait promis 471 000 emplois en cas de suppression de l’autorisation administrative de licenciement, promesse qui n’avait pas été tenue quand il avait reçu satisfaction en 1986, au retour de la droite au pouvoir. De même, plus récemment, sous Sarkozy, la baisse de la TVA dans la restauration n’a créé que très peu d’emplois dans le secteur…
Jusque-là, les premières enquêtes auprès des patrons de PME laissent sceptiques quant aux chances de voir le pacte de responsabilité déboucher sur des emplois. Ce qu’ils attendent pour investir, disent-ils, ce sont des commandes plus que des baisses de charges.
Pascal Riché
Source Rue 89 : 15 01 2014
La politique de l’offre de Hollande, « une vraie rupture » dans l’histoire de la gauche

Il a assumé sa politique rigoureuse, et soucieuse des entreprises… loin des aspirations de la gauche radicale. Le président François Hollande a justifié, lors de sa conférence de presse, mardi 13 novembre, ses choix, niant ce qui s’apparente pourtant à un tournant opéré dans sa politique au bout de six mois d’exercice de pouvoir, avec des mesures qui s’éloignent de son discours de candidat.
Pour expliquer ce qui l’a poussé à opter pour un discours et une politique de l’offre, en mettant en œuvre un pacte de compétitivité, qui vise à consentir 20 milliards d’euros de baisses d’impôts aux entreprises à partir de 2014, le chef de l’Etat a relativisé ce virage en le situant à l’intérieur même de la pensée socialiste.
- Hollande justifie le recours à une politique de l’offre
« Je connais bien la pensée socialiste, je l’ai étudiée pendant des années avec lucidité et en même temps espoir ! », s’est-il d’abord amusé, lors de sa conférence de presse mardi 13 novembre. « Il y a toujours eu deux conceptions, une conception productive – on a même pu parler du socialisme de l’offre – et une conception plus traditionnelle où on parlait de socialisme de la demande », qui vise à soutenir la consommation des ménages, a-t-il ensuite expliqué après une question sur la baisse du coût du travail pour soutenir l’emploi.
« Aujourd’hui, nous avons à faire un effort pour que notre offre soit consolidée, plus compétitive et je l’assume ! Et en même temps, nous devons préserver la demande et faire la mutation, c’est-à-dire comprendre que le monde est en train de changer, que la transition vers une nouvelle façon de produire, de consommer, de nous transporter est en marche. Et c’est là que nous devons nous enrichir d’apports qui sont ceux de tout notre environnement. Nous devons faire cette révolution », a-t-il conclu.
- Le discours d’un dirigeant socialiste pour une politique de l’offre : « une vraie rupture »
« Le pacte de compétitivité est un tournant très fort », estime Rémi Lefebvre, politologue à l’université de Lille, spécialiste du PS. Le discours de François Hollande franchement en faveur d’une politique de l’offre constitue « une vraie rupture » dans l’histoire de la gauche, renchérit Gérard Grunberg, directeur de recherche à Sciences Po et spécialiste de la gauche.
« Même s’il ne renie pas une politique de demande, c’est la première fois qu’un leader socialiste dit aussi clairement qu’il faut mener une politique de l’offre. A gauche, même du temps de Lionel Jospin ou de François Mitterrand, personne n’a jamais été partisan d’une telle politique, estimant que trouver un compromis avec les entreprises revenait à mener une politique libérale », souligne-t-il.
Si certains dirigeants socialistes, comme Michel Rocard dans les années 1970, Laurent Fabius en 1984, puis Lionel Jospin à Matignon ont bien amorcé ce virage vers une politique de l’offre, en admettant que l’Etat devait prendre en compte les intérêts des entreprises, ils ont toujours dit que le rôle de celui-ci était fondamental, justifie M. Grunberg. En cela, la gauche a toujours été dominée par les keynésiens, estime le chercheur.
- Hollande dans les pas de « la deuxième gauche » ?
Faut-il en conclure que le président Hollande – avec sa politique de l’offre – s’inscrit dans « la deuxième gauche », ce courant idéologique apparu dans la seconde moitié des années 1970 avec Michel Rocard ? Ce n’est pas l’analyse des spécialistes de la gauche contactés par Le Monde.fr.
« Le tournant initié par François Hollande relève du social-libéralisme, tranche Rémi Lefebvre, proche de l’aile gauche du parti. Même si le candidat Hollande tenait un discours modéré, sans trop promettre, le pacte de compétitivité s’apparente au tournant de la rigueur en 1983, dans le sens où c’est un retour au réel et une forme de capitulation devant les injonctions des milieux économiques. »
Gérard Grunberg a, de son côté, une position plus nuancée. Selon lui, le chef de l’Etat s’inscrit dans la gauche réformiste et « a compris que la social-démocratie moderne doit se situer en compromis avec les intérêts des entreprises ». De cette manière, M. Hollande « recolle au peloton des social-démocraties européennes, qui, dans la crise, sont contraintes de composer avec les libéraux et le centre droit », d’après lui.
- Qu’est-ce que la « première » et la « deuxième » gauche ?
A l’origine, ce que l’on appelle « la première gauche » est un courant idéologique apparu en 1905 avec la création de la Section française de l’Internationale ouvrière (SFIO). La SFIO, qui donnera naissance au PS en 1969, est de culture marxiste et jacobine. Elle préconise l’instauration d’un Etat fort dans la tradition de la centralisation à la française, avec des nationalisations des grands groupes industriels du pays. Ce courant de la première gauche regroupait les partisans de François Mitterrand.
La « deuxième gauche », de son côté, s’est construite en opposition avec la « première ». Elle est apparue dans la seconde moitié des années 1970 avec Michel Rocard. Ce courant de pensée regroupait autour de l’ancien premier ministre, le Parti socialiste unifié (PSU) fondé en 1960 avant de s’auto-dissoudre en 1989, et une partie de la CFDT. « La ‘deuxième gauche’ n’était pas libérale. Rocard soulignait qu’il fallait prendre en compte les intérêts des entreprises. Mais il n’a jamais été pour autant favorable à une politique de l’offre. Il reste davantage un keynésien », explique Gérard Grunberg.
Par ailleurs, la « deuxième gauche » avait la particularité de « se méfier du communisme et s’opposait à la ‘première’ en disant que l’Etat ne devait pas s’occuper de tout, notamment de l’économie. C’est pour cette raison qu’elle prônait la décentralisation », explique-t-il.
Alexandre Lemarie
Source : Le Monde 15/01/2013
Le « socialisme de l’offre », ou la politique de la déflation
par David Cayla

Il y a un an, François Hollande annonçait une nouvelle politique économique : « le socialisme de l’offre ». Derrière cette formule creuse se cache en réalité une stratégie suicidaire pour la France. Car la politique de l’offre menée dans un contexte européen de croissance « poussive », n’a aucune chance d’améliorer la situation de l’emploi et des entreprises.
Le « socialisme de l’offre » c’est la formule trouvée par François Hollande pour expliquer sa stratégie économique lors de sa conférence de presse de novembre 2012 : « Il y a toujours eu deux conceptions, une conception productive – on a même pu parler du socialisme de l’offre – et une conception plus traditionnelle où on parlait de socialisme de la demande. Aujourd’hui, nous avons à faire un effort pour que notre offre soit consolidée, plus compétitive. » La formule est reprise par Pierre Moscovici qui explique ainsi le retournement stratégique opéré par gouvernement : « Dans l’opposition, nous avons rejeté toute idée que la France souffrait d’un problème de compétitivité liée au coût du travail. C’est l’honneur de ce gouvernement, suite au rapport Gallois, d’avoir laissé de côté une position partiellement idéologique et très datée, et d’avoir pris la mesure d’un enjeu national. »1
C’est donc au nom du pragmatisme, de l’efficacité et, en somme, de « l’honneur », que le gouvernement a choisi de tourner le dos aux politiques qu’il préconisait dans l’opposition. Sans remettre en cause la sincérité des propos du ministre, notons qu’il est bien délicat de devoir justifier, auprès des électeurs, un tel écart entre la politique menée au pouvoir et celle qu’on proclamait dans l’opposition. Il n’aura en effet pas fallu plus de six mois pour que la gauche, élue au nom du social et du retour à la retraite à 60 ans, pourfendeuse de la TVA et de la « règle d’or », se transforme en commis d’une politique au service des entreprises.
UNE NOUVELLE POLITIQUE
Depuis novembre 2012, depuis un an, le retournement est indéniable. Le programme des « 60 propositions » est mis en sourdine pour laisser place à l’orchestre triomphant de la Nouvelle politique. Toute l’énergie du gouvernement se concentre sur des mesures de compétitivité. Il y eut d’abord le CICE (crédit impôt compétitivité emploi), un allègement d’impôt de 12 à 15 milliards d’euros accordé sans contrepartie aux entreprises et financé par la hausse de la TVA. Il y eut ensuite la loi sur la sécurisation de l’emploi qui permet aux entreprises de baisser les salaires et de modifier le contrat de travail sans avoir à recourir à des licenciements. Il y eut enfin l’économie des dépenses publiques et une réforme des retraites qui enterre de fait le départ à taux plein à 60 ans. Comme le souligne l’économiste Bruno Amable2, le bilan de cette politique est que les cadeaux aux entreprises sont payés par les ménages et les salariés. Hausse des impôts, stagnation salariale et accentuation de la flexibilité du travail constituent les modalités du paiement.
Injuste, cette politique l’est sans conteste. Est-elle au moins nécessaire ou efficace ? L’économie française souffre-t-elle d’un coût du travail trop élevé ? Pour appuyer son analyse, le gouvernement souligne deux chiffres : le déséquilibre de la balance commerciale, en constante dégradation depuis 2002, et la chute, depuis 2007-2008, du taux de marge des entreprises3.
Si ces chiffres sont incontestables, l’interprétation qu’on leur donne mérite débat. La hausse des salaires est-elle responsable de la baisse de compétitivité de l’économie française ? L’affirmer reviendrait à porter au crédit de l’UMP, au pouvoir à cette époque, d’avoir massivement augmenté les salaires. Bien sûr, il n’en est rien. D’après l’INSEE, entre 2002 et 2011, le pouvoir d’achat du salaire net moyen a augmenté de moins de 6 % tandis que le PIB a augmenté de 12 %. Les actifs ont à peine bénéficié de la moitié des gains de productivité qu’ils ont créés par leur travail. On peut tourner le problème dans tous les sens, la baisse de compétitivité des entreprises françaises n’est pas due à une hausse du coût du travail.
LES ENTREPRISES VICTIMES DE L’AUSTÉRITÉ
Pour comprendre ce problème il faut s’interroger sur la chronologie. Que s’est-il passé en 2007-2008 pour que le taux de marge des entreprises s’effondre ? Une crise du système financier international, la chute du commerce mondial, une récession sans précédent depuis 1945 dans les économies développées. C’est d’abord la brutalité avec laquelle la demande mondiale s’est contractée qui explique la baisse du taux de marge des entreprises. Il en est résulté une sous-exploitation des capacités productives, une baisse de la production et une hausse du chômage.
Dans un tel cas de figure, les recettes des entreprises diminuent forcément plus vite que leurs charges, car elles doivent continuer de payer un appareil productif sous-utilisé. Elles attendent une reprise qui ne vient pas. Et pour cause. Après de timides plans de relance engagés ici ou là en 2009, les États européens se sont tous engouffrés dans des politiques de « rétablissement des finances publiques », envoyant leurs populations dans une marche forcée vers l’austérité. Au final, la demande intérieure stagne, prise en ciseau par les hausses d’impôts et les baisses de dépenses publiques.
Dans les pays d’Europe du sud où l’austérité est la plus forte, la demande s’effondre. Pour compenser, les gouvernements, avec le soutien actif de la Troïka, se sont tournés vers une hypothétique demande extérieure, en espérant que les entreprises trouveront à l’étranger les parts de marché qui leur manquent. Cette politique nécessite une stratégie de type néo-mercantiliste : baisse du coût du travail, aides aux entreprises, accentuation de l’austérité. C’est une politique de l’offre classique, qui n’a rien de « socialiste ». Mais un problème se pose : si un pays individuel peut momentanément compenser une faiblesse de sa demande intérieure par une hausse de ses parts de marché à l’étranger, cette stratégie ne peut fonctionner à l’échelle mondiale. Toutes les balances commerciales ne peuvent être en excédent, car les déficits des uns font les excédents des autres. Il en résulte une guerre absurde4 où chacun se bat pour augmenter sa part d’un gâteau que les politiques d’austérité généralisées s’acharnent à faire diminuer.
Résultat, les marges des entreprises baissent à mesure que la guerre commerciale s’intensifie. Certains pays, comme l’Allemagne, s’en sortent bien. Avec une population vieillissante et peu portée sur la consommation et l’investissement, l’économie allemande gagne plus à l’étranger que ce qu’elle perd en interne. Pour d’autres pays, comme la France, une telle stratégie est suicidaire. Un pays qui possède, avec l’Irlande, le plus haut taux de fécondité de l’Union européenne, a besoin de consommer et d’investir. L’austérité généralisée ne fait qu’affaiblir ses capacités de croissance future tandis que les potentialités extérieures sont clairement moins avantageuses que le gaspillage de ses ressources internes, sous-exploitées.
LA DÉFLATION, UN RETOUR AUX ANNÉES 30

On connaît très bien les effets d’une politique de l’offre généralisée, où chacun cherche à diminuer ses coûts pour être plus compétitif que son voisin. La diminution des coûts entraîne la baisse des revenus qui conduit à la compression de la demande. Aussi, pour ne pas voir leur part de marché s’effondrer, les entreprises sont contraintes de baisser leurs prix, ce qui diminue leurs marges. C’est ce qu’on appelle la déflation. On y est. A force de mener des politiques de compétitivité en Europe du sud et partout ailleurs, les prix diminuent en Grèce et à Chypre, ils stagnent au Portugal, en Espagne et en Irlande.
Mais la déflation ne s’arrête pas aux pays sous perfusion de la Troïka. Elle touche l’ensemble de la zone euro. En France, si l’on ne constate pas encore de baisse des prix, on mesure tout de même un dangereux ralentissement de l’inflation depuis près de deux ans.
Or, la déflation est un poison mortel. Elle pousse les consommateurs à reporter leurs achats (dans l’attente d’une baisse des prix) ; elle pénalise les emprunteurs et favorise les rentiers (en raison de la hausse des taux d’intérêt réels) ; elle décourage les producteurs et les investissements ; elle assèche les recettes publiques et nourrit les déficits. Plus grave, elle tend à augmenter la valeur du stock de dettes en circulation, ce qui génère à terme des défauts et des faillites bancaires.
La déflation, c’est le retour de la crise des années 30. Face à une telle menace, il serait bon que le gouvernement prenne la mesure des problèmes réels de l’Europe et revoit sérieusement l’idéologie churchillienne, à base de sang et de larmes, qui l’a conduite à inventer le concept du « socialisme de l’offre ».
David Cayla
Source : Blog des Economistes Attérés 20/12/2013
1. Pierre Moscovici (2013) : Combats – pour que la France s’en sorte, Flammarion, Paris.
2. Bruno Amable : « Qui ressent le ras-le-bol du ‘socialisme de l’offre’ ? » Libération, le 14/10/2013, en ligne sur : http://www.liberation.fr/economie/2013/10/14/qui-ressent-le-ras-le-bol-du-socialisme-de-l-offre_939426
3. Le taux de marge mesure le rapport entre le profit réalisé par les sociétés non financières (mesuré par l’excédent brut d’exploitation) et leur richesse produite (mesurée par la valeur ajoutée). Depuis la fin des années 80, le taux de marge des sociétés non financières française n’était jamais descendu en dessous de 37 %. Il est tombé à 35,1 % en 2012.
4.voir article publié sur le site de Parti Pris : « Compétitivité : le retour de l’idéologie de la guerre économique », décembre 2012.
Voir aussi : Rubrique Politique, Rubrique Economie, Rubrique Philosophie, Habermas : Pour une Europe démocratique ! , Michéa : la gauche de notre imaginaire collectif, On Line : Pourquoi le pacte de responsabilité mène à la récession,
 Pour sortir du piège infernal d’un démantèlement programmé vers lequel notre pays avance pas à pas, il était urgent d’obtenir la sanctuarisation du budget de la culture. Le candidat Hollande l’avait promis. Cette promesse n’a pas été tenue, comme d’autres, diront certains, sans vraiment mesurer les enjeux politiques et économiques de ce manquement. La culture ne se réduit pas à une offre de pratiques et de services culturels. C’est pourquoi l’étude réalisée par les ministères de l’économie et de la culture est à double tranchant. Justement, parce qu’en surfant sur ces chiffres enthousiasmants, – la culture a généré 58 Mds d’euros de valeur ajoutée en 2012- on aurait tôt fait de réduire la richesse de la culture à son poids économique en oubliant le reste.
Pour sortir du piège infernal d’un démantèlement programmé vers lequel notre pays avance pas à pas, il était urgent d’obtenir la sanctuarisation du budget de la culture. Le candidat Hollande l’avait promis. Cette promesse n’a pas été tenue, comme d’autres, diront certains, sans vraiment mesurer les enjeux politiques et économiques de ce manquement. La culture ne se réduit pas à une offre de pratiques et de services culturels. C’est pourquoi l’étude réalisée par les ministères de l’économie et de la culture est à double tranchant. Justement, parce qu’en surfant sur ces chiffres enthousiasmants, – la culture a généré 58 Mds d’euros de valeur ajoutée en 2012- on aurait tôt fait de réduire la richesse de la culture à son poids économique en oubliant le reste. Toutes les organisations sont sur le pont. «On avait jamais connu ça. 90% du personnel de la Drac est mobilisé, constate Myriam Marchadier de la CGT Culture, la réduction des effectifs se poursuit chaque année et on nous enlève des missions. Après que l’Etat se soit désengagé de ses compétences patrimoniales, c’est maintenant la maîtrise d’oeuvre en archéologie qui file vers le privé.» Au sein de la CGT, les préoccupations du porte-parole du SNJ-CGT de France 3, Philippe Menu, illustrent le rapprochement opéré entre journalistes et acteurs culturels. Le budget de France Télévision amputé de 150 M par le ministère de la culture et de la communication s’ajoute au manque à gagner résultant de la réduction publicitaire imposée par Sarkozy et laissée en l’état par son successeur avec de criantes répercutions régionales. « Localement, France 3 n’assure plus qu’une heure de programme par jour. Essentiellement de l’actu qui concentre 88% de la production avec un peu de culture en bout de programme. Les production autour des spectacles, de la vie en région, de ses habitants, ont disparu. La télé en tant qu’élément de liens social et culturel est clairement menacée.»
Toutes les organisations sont sur le pont. «On avait jamais connu ça. 90% du personnel de la Drac est mobilisé, constate Myriam Marchadier de la CGT Culture, la réduction des effectifs se poursuit chaque année et on nous enlève des missions. Après que l’Etat se soit désengagé de ses compétences patrimoniales, c’est maintenant la maîtrise d’oeuvre en archéologie qui file vers le privé.» Au sein de la CGT, les préoccupations du porte-parole du SNJ-CGT de France 3, Philippe Menu, illustrent le rapprochement opéré entre journalistes et acteurs culturels. Le budget de France Télévision amputé de 150 M par le ministère de la culture et de la communication s’ajoute au manque à gagner résultant de la réduction publicitaire imposée par Sarkozy et laissée en l’état par son successeur avec de criantes répercutions régionales. « Localement, France 3 n’assure plus qu’une heure de programme par jour. Essentiellement de l’actu qui concentre 88% de la production avec un peu de culture en bout de programme. Les production autour des spectacles, de la vie en région, de ses habitants, ont disparu. La télé en tant qu’élément de liens social et culturel est clairement menacée.»