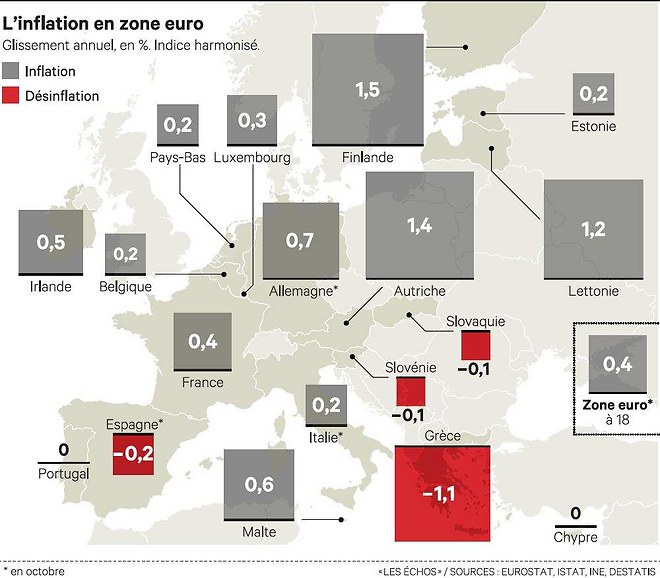C’est le brillant économiste Irving Fisher qui fut le premier – dès les années 1930 – à formuler cette proposition dont le point culminant consistait à imposer aux banques 100% de réserves en échange des dépôts de leurs clients. Les épisodes mélodramatiques de paniques bancaires et de ruées des épargnants pour retirer leurs avoirs seraient dès lors relégués aux manuels d’Histoire, car les banques ne seraient plus en mesure de prêter que leurs fonds propres. Les cycles d’activité seraient considérablement lissés et apaisés car les bulles spéculatives seraient comme neutralisées en amont.
Du coup, les déficits publics en seraient progressivement réduits car, d’une part, les États n’auraient plus à dépenser les deniers du contribuable pour renflouer un système financier aussi inconscient qu’ingrat. La stabilisation au long cours de l’activité économique – et donc la pérennisation des recettes fiscales – contribuant d’autre part à redresser les comptes publics.
Les banques ne seraient plus que des intermédiaires financiers
C’est donc l’État qui serait aux sources et au cœur de toutes les transactions monétaires. Les citoyens, consommateurs, et autres usagers conserveraient leurs avoirs au sein de leurs établissements bancaires qu’ils paieraient, en revanche, pour ce service rendu. C’est uniquement les sommes volontairement dédiées par certains clients – privés ou entreprises – à des fins d’investissement qui pourraient être affectées au circuit du financement. En d’autres termes, les banques ne seraient plus que des intermédiaires financiers qui mettraient en relation une somme de créanciers et de débiteurs, moyennant rétribution évidemment. En tout état de cause, les banques ne seraient définitivement plus en capacité de créer de l’argent à partir du néant. Le corollaire étant que les pertes potentielles n’affecteraient que les titulaires de ces comptes d’investissement ayant sciemment pris la décision de financer une entreprise, un ménage ou de spéculer en bourse…
L’Etat pourrait créer de la monnaie pour financer ses propres dépenses
La tâche de création monétaire de l’Etat serait ainsi entièrement mise au service de l’économie et de la promotion de la croissance. Il serait dès lors en mesure de financer ses propres dépenses, au lieu de taxer et d’emprunter. Il aurait la capacité de transférer des liquidités directement en faveur de certains citoyens, voire de rembourser certaines dettes du secteur privé. La soustraction du pouvoir de création monétaire au système de l’intermédiation financière autoriserait donc l’augmentation de la masse monétaire en cas de besoin, mais sans encourager les consommateurs, investisseurs et entrepreneurs de se charger de dettes, et permettrait donc de maîtriser le risque de bulle spéculative. Ce transfert de pouvoir vers l’Etat – et donc vers les citoyens – annihilerait donc de facto les « Too bigs to fail », et stabiliserait immédiatement l’ensemble du système financier qui serait contraint de revoir ses prétentions considérablement en baisse, car il serait privé de ce pouvoir et de ce levier formidables lui ayant été originellement conféré par les Etats.
La création monétaire, un véritable « prérogative thaumaturgique »
N’est-il pas invraisemblable d’avoir – par le biais de la création monétaire – remis nos destinées aux mains d’un secteur privé seul préoccupé (de manière compréhensible) par ses profits, alors que c’est les pouvoirs publics qui devraient être dotés de cette prérogative thaumaturgique ? Stabilisons nos économies et rassérénons ses acteurs en remettant à sa juste place le système bancaire, en le cantonnant au rôle de simple intermédiaire financier. Et ôtons lui ce pouvoir, qui s’est révélé au fil des années et des décennies écoulées, comme un authentique facteur de nuisance pour la croissance. Voire comme un trou noir, où se sont engouffrés les fonds publics soucieux de sauver une infrastructure financière dont on n’a pas arrêté de nous convaincre que son renflouement était le préalable à notre survie économique. Alors que, dans nos pays occidentaux, seuls 10% environ de la totalité des prêts bancaires sont canalisés vers les entreprises et vers la vraie économie, le reste étant destiné aux spéculateurs et investisseurs, bref à cette caste déconnectée des réalités qui génère le gros des bénéfices de la finance.
Bénéfices engrangés précisément grâce à cette faculté de création monétaire, qui doit donc aujourd’hui être du seul ressort de l’Etat. Outre la mise hors d’état de nuire du système financier, un tel changement de paradigme nous contraindrait du coup à considérer les déficits publics et même les impôts sous un autre angle. Pour le plus grand bénéfice de la collectivité.
Michel Santi
Michel Santi est directeur financier et directeur des marchés financiers chez Cristal Capital S.A. à Genève. Il a conseillé plusieurs banques centrales, après avoir été trader sur les marchés financiers. Il est l’auteur de : « Splendeurs et misères du libéralisme« , « Capitalism without conscience » et « L’Europe, chroniques d’un fiasco économique et politique« .
Source : La Tribune 10/11/2014,
Voir aussi : Rubrique International, rubrique Débat, rubrique Finance, rubrique Economie,