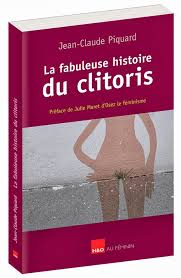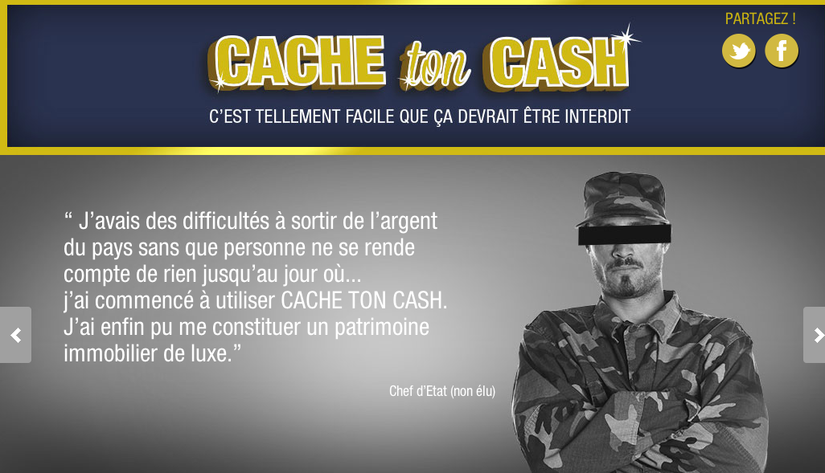En marge de la soixante-huitième Assemblée générale des Nations unies, à New York, M. François Hollande a rencontré son homologue iranien, qu’hier encore il voulait exclure des négociations sur la Syrie. Un revirement de Paris, une fois de plus inspiré par les décisions diplomatiques de Washington.
A rebours de l’opération « Serval », déclenchée au Mali en janvier 2013, jugée remarquable sur le plan militaire et satisfaisante sur le plan politique (1), la terrible affaire syrienne constitue déjà un échec complet pour la diplomatie française.
L’humiliation objective subie par Paris, lâché par ses alliés après avoir tenu le rôle du matamore jusqu’au-boutiste, est profonde et laissera des traces. Les maladroits coups de menton en retraite, proposés in extremis par une France qui aurait « fait plier Moscou » et « entraîné » Washington, résistent peu à l’analyse, contrairement à ce qu’écrivent certains quotidiens de l’Hexagone. Hors de nos frontières, l’angle est moins sophistiqué : dans les chancelleries et les journaux étrangers, cette autosatisfaction a été commentée avec une commisération mêlée de Schadenfreude (« joie mauvaise » suscitée par l’échec de l’autre).
Le plan de sortie de crise proposé par le président russe Vladimir Poutine, le 9 septembre 2013, qui consiste, sous supervision de l’Organisation des Nations unies (ONU), à « sécuriser » les mille tonnes de l’arsenal chimique de Damas, et qui fait désormais l’unanimité, avait sans doute été évoqué avec les Etats-Unis de façon bilatérale au G20 de Saint-Pétersbourg, dès le 5 septembre. Cet accord informel entre « grands » — l’adjectif dénotant en l’occurrence une maturité diplomatique plus qu’un niveau de puissance — s’est établi sans que la France, qui espérait visiblement un statut de premier lieutenant après la défection britannique (2), ne soit même consultée.
La Russie permettait ainsi au président américain Barack Obama, foncièrement réticent à toute intervention, de sortir du piège qu’il s’était lui-même tendu avec sa mention en 2012 d’une « ligne rouge » concernant l’emploi d’armes chimiques dans la guerre civile syrienne. La dureté verbale du secrétaire d’Etat John Kerry a ensuite meublé la scène en sauvant ce qui pouvait l’être de la cohérence américaine, jusqu’à ce que la convergence prévue avec M. Poutine s’accomplisse, à la satisfaction des deux parties.Dès le 20 septembre, M. Kerry et son homologue russe Sergueï Lavrov étaient à Genève, pour des entretiens bilatéraux préparant les conditions d’une conférence internationale sur la Syrie, dite « Genève 2 », prévue en juillet 2014.
Maître des horloges, M. Poutine a conservé en permanence sa liberté d’action et mené le bal, forçant ses partenaires à emprunter toutes les issues qu’il ouvrait. Il augmente encore son emprise sur le régime de M. Bachar Al-Assad, tout en renforçant un argumentaire efficace car très simple : dans quelle mesure, demande-t-il, des frappes ciblées et limitées dans le temps soulageraient-elles le peuple syrien ? La force favorise- t-elle l’objectif d’une conférence internationale de paix ? Pourquoi pourchasser le djihadisme partout dans le monde, et lui venir en aide en Syrie ?
Dans ce jeu cynique de realpolitik à trois bandes, Moscou a rendu service au président américain en le tirant d’une opération qu’il redoutait, tandis que Paris, déjà sorti de la tranchée, jouait le clairon excité et vertueux en courant vers les lignes de barbelés sans s’assurer d’être couvert. Quelle que soit son orientation politique, tout Français ne peut qu’avoir été accablé par l’isolement du président François Hollande à Saint-Pétersbourg, et par la subordination au moins apparente de Paris envers le positionnement américain et les jeux d’appareil du Congrès. L’Elysée et le Quai d’Orsay auront réussi le tour de force simultané d’exaspérer Washington, de gêner Londres, de faire lever les yeux au ciel à Berlin, de désespérer Beyrouth, de déclencher un concert de soupirs à Bruxelles et d’amuser les joueurs d’échecs de Moscou.
Une partie de la population se range aux côtés d’un régime qu’elle n’aime pas
Pour clore ce tableau, mentionnons le ralliement révélateur du député de l’Union pour un mouvement populaire (UMP) Frédéric Lefebvre au prurit d’ingérence français (3), qui établit un pont entre l’aventurisme libyen de M. Nicolas Sarkozy et l’imprudence syrienne de M. Hollande, au nom d’une géographie de l’inadmissible qui sélectionne ses indignations : la Palestine et une quinzaine d’autres scandales internationaux ne figurent pas dans la liste de ses « Munich » putatifs. A l’arrivée, le réel crédit acquis au Mali est entamé, cependant que l’image positive du refus de la guerre d’Irak en 2003 apparaît soudainement abîmée tant sur le plan de l’indépendance que sur celui de la lucidité jusque-là prêtées à la France.
Le président de la République, venu cueillir les dépouilles opimes à Bamako le 19 septembre, va peiner à faire oublier les fourches caudines de Saint-Pétersbourg, ce dont personne ne peut se réjouir. D’autant que le discours prononcé à cette occasion a permis d’apprendre que la France fournirait désormais officiellement des armes à la rébellion. M. Hollande évoque des livraisons « dans un cadre contrôlé, car nous ne pouvons pas accepter que des armes puissent aller vers des djihadistes » et non à « l’ASL », l’Armée syrienne libre. Le problème est malheureusement que l’équation présente trois inconnues, puisque les termes « contrôlé », « djihadistes » et même « ASL » ne sont aucunement définissables en l’état. Quel degré de porosité entre l’ASL et des groupes aux « tendances islamistes plus marquées (4) » comme Ahrar Al-Cham et Liwa Al-Tawhid, ou le Front Al-Nosra, encore plus extrémiste ? La décision de « livrer des armes », légitimée par le fait que « les Russes [le font] régulièrement » (5), jette de l’huile sur le feu et pourrait prolonger la folie de la boucherie syrienne, permettant à M. Al-Assad de dénoncer encore plus commodément l’ingérence étrangère. En somme, un coup de dés sans aucun espoir de traçabilité, contredisant la volonté proclamée par toutes les parties de parvenir à un règlement politique du conflit.
Comment en est-on arrivé là ? La faute, comme l’analyse Bernard-Henri Lévy, à une « diplomatie d’opinion (6) » enchaînée aux sentiments munichois d’un public qui refuse, sans doute par incomplétude cérébrale, de prendre la mesure de la gravité des événements syriens ? Comme toujours chez le chroniqueur du Point, la formule a le mérite de l’aplomb. Mais l’ellipse indignée peut-elle pour autant remplacer le raisonnement géopolitique et diplomatique ?
L’échec syrien s’explique en premier lieu par une évaluation hémiplégique de la situation régionale et de ses conséquences. Depuis des mois, des experts sont consultés par le ministère des affaires étrangères. Certains sont de vrais connaisseurs de la région, et à ce titre ont souligné la complexité de la réalité syrienne ; ils ont pointé le soutien « faute de mieux » d’une partie de la population à la dictature de M. Al-Assad — par rejet d’une « nouvelle » Syrie qui, le visage de la rébellion étant ce qu’il est, risque de se retrouver in fine en proie aux extrémismes confessionnels et aux manipulations de parrains régionaux dont on sait qu’il sont les sponsors indirects d’un obscurantisme condamnant les pays arabes à l’immobilisme. Ces Syriens-là, qui ne savent pas forcément où se trouve Munich, prévoient que l’après-Al-Assad, du moins dans les conditions actuelles, ne leur offrira que peu de sécurité, et c’est une litote.
Au milieu de tant de rumeurs, voilà donc un fait : une partie importante de la population syrienne se bat, ou plus exactement se débat, aux côtés d’un régime qu’elle n’aime pas. Les Irakiens ont lâché Saddam Hussein. Les Libyens ont abandonné le colonel Mouammar Kadhafi. Les Egyptiens ont congédié M. Hosni Moubarak. Tous ou presque l’ont fait dans leur ensemble, même quand ils doutaient à raison (c’est le cas de la jeunesse égyptienne, et d’une partie des Libyens) que le nouveau pouvoir serait plus vertueux et plus juste que le précédent. En Syrie, si aucune des deux parties ne semble pouvoir l’emporter sur l’autre, c’est non pas seulement en raison de la supériorité militaire du régime, mais à cause du loyalisme résigné d’une part de la population, qui refuse de lâcher M. Al-Assad malgré la brutalité, le népotisme clanique et l’immobilisme policier qui caractérisent son régime. Entre le Scylla alaouite — bien éloigné des idéaux de Michel Aflak (7) — et le Charybde des exécutions au sabre (8), de la charia intégrale et de l’oppression des minorités, quel espoir pour la Syrie de Maaloula, de Lattaquié et des confins kurdes ? C’est bien la réponse à cette question qui devrait structurer prioritairement toute analyse du drame syrien.
Une partie de la rébellion désespère de cette influence des plus extrémistes, mais ce sont ces derniers qui, très rapidement, ont eu le vent en poupe dans cette guerre civile. De nombreux experts — peu abonnés aux plateaux télévisés — ont discrètement fait valoir cette complexité, dérangeante sur le plan moral mais éminemment factuelle, à leurs interlocuteurs officiels à Paris. Leurs analyses semblent cependant avoir été passées par pertes et profits lors de la folle semaine qui a vu monter aux extrêmes la position de la France sur ce dossier.
Cet emballement diplomatique et médiatique constitue sans doute le second élément le plus préoccupant de l’affaire syrienne. La France avait-elle assez brocardé le vocabulaire de cow-boy des Américains après le 11-Septembre ! Avec raison, chacun en convient à présent. « Vous êtes avec nous ou avec les terroristes » : on se souvient de cette expression de l’ancien président américain George W. Bush, qui restera comme le degré zéro du positionnement diplomatique, sur le mode néo-conservateur (9). On peut donc se demander, dans le cas syrien, pourquoi il a été jugé si nécessaire d’annoncer à grand fracas la volonté de Paris de « punir » M. Al-Assad. A quoi cette « punition » correspond-elle dans la grille de gravité évolutive qui régit et pondère l’expression de la position des Etats dans le système des relations internationales ? Comme le regrette le professeur Bertrand Badie, « tout a été mêlé : la responsabilité de protéger le peuple syrien — le conflit syrien a fait plus de cent mille morts en deux ans — et la volonté de punir le régime de Bachar Al-Assad. Or punir et protéger sont deux choses différentes (10) ».
« La guerre civile est le règne du crime » (Corneille)
L’indignation est compréhensible, et l’ignoble attaque chimique du 21 août dans la plaine de la Ghouta ne peut laisser indifférent. Elle ne doit cependant pas faire perdre le sens de la mesure au plus haut sommet de l’Etat. La Syrie est aujourd’hui le cadre d’une guerre civile qui, par définition, transforme les hommes en bêtes : « La guerre civile est le règne du crime » (Pierre Corneille). Aucune des deux parties ne pouvant prendre l’ascendant sur l’autre, et aucune des deux n’étant en réalité plus « vertueuse » que l’autre, l’urgence est de stabiliser politiquement et militairement les lignes de front existantes, de manière à ce que les massacres cessent.
La Russie livre des armes au régime. Certains Etats du Golfe approvisionnent les différents groupes de la rébellion, en fonction de leur degré d’inféodation à leurs objectifs géopolitiques. La guerre civile s’est transformée en guerre régionale, où la Turquie, l’Arabie saoudite et l’Iran prennent des positions de plus en plus antagonistes, transformant l’une des terres les plus anciennement civilisées du monde en un champ clos dont le destin s’écrit ailleurs.
Dans ces conditions, le rôle du Quai d’Orsay, appuyé tant sur Moscou que sur Washington, aurait pu être de proposer une autre voie, diplomatique et équilibrée (11). Evidemment imparfaite. Assurément incomplète. Mais adaptée au nombre des inconnues de l’équation.
En devenant tout au contraire un élément d’instabilité supplémentaire dans le maelström syrien, Paris s’interdit pour le moment le rôle exigeant et indispensable d’arbitre. Berlin, froid et pondéré, représentera parfaitement l’Europe lorsqu’il s’agira, dans quelques mois, de réunir autour d’une table les Caïn et Abel syriens, sous la présidence sourcilleuse des Etats-Unis et de la Russie, et avec la présence probable de l’Iran, ce qui pourrait contribuer à débloquer en partie la situation. Bien que les présidents Rohani et Obama n’aient pu se rencontrer à l’ONU le 25 septembre, la diplomatie américaine semble favorable à un traitement plus réaliste des relations diplomatiques avec Téhéran. De son côté, M. Hollande, qui estimait le 18 juin que M. Rohani serait « bienvenu (…) s’il était utile » à la prochaine conférence internationale sur l’avenir de la Syrie, a finalement accepté de discuter avec le président iranien à New York.
Ces retournements pragmatiques montrent combien le terme de « punition », slogan de vengeur autoproclamé méprisant le Conseil de sécurité avant même qu’une inspection de l’ONU ne se soit penchée sur le drame de la Ghouta, peut être considéré comme l’une des bévues les plus incompréhensibles de ces dernières années, de la part d’un pays dont l’appareil diplomatique conserve à l’étranger une réputation méritée de professionnalisme et de mesure. Voilà ce que juge, en son for intérieur, « l’antipeuple qu’est l’opinion [publique] (12) », qui a sans doute tort, dans sa naïveté, de ne pas oublier la fiole de M. Colin Powell et les « armes de destruction massive » irakiennes.
De nombreuses voix, sur tout le spectre politique, appellent à revenir, sinon à la raison, du moins à la prudence, comme celle de M. Jean-Pierre Chevènement : « Autrefois, il y avait le droit. Aujourd’hui, on a remplacé le droit par la morale. Et de la morale on passe à la punition. C’est plus facile, mais c’est très dangereux, car le fameux “droit d’ingérence”, c’est toujours le droit du plus fort : on n’a jamais vu les faibles intervenir dans les affaires des forts (13). » En 2002-2003, la France, sans nier les crimes du régime irakien, appelait avec une hauteur de vue remarquée à une précautionneuse fermeté, dans le respect du fonctionnement des Nations unies.
Les gazages présumés de M. Al-Assad répondent à ceux avérés d’Hussein en Irak en 1988. Le parallèle doit-il être poursuivi à vingt-cinq ans de distance en faisant se répondre invasion de l’Irak et bombardements en Syrie ? M. Obama, qui lit quotidiennement les dépêches de ses services sur l’état réel de l’Irak après que Washington y a dépensé des centaines de milliards de dollars en pacification démocratique entre 2003 et 2013 (14), semble avoir une idée de la réponse. Elle ne sera que peu goûtée par les hérauts français de l’ingérence-réflexe (15). Ce qui devrait nous incliner à penser qu’elle est raisonnable.
Chargé d’études à la Compagnie européenne d’intelligence stratégique (CEIS), Paris