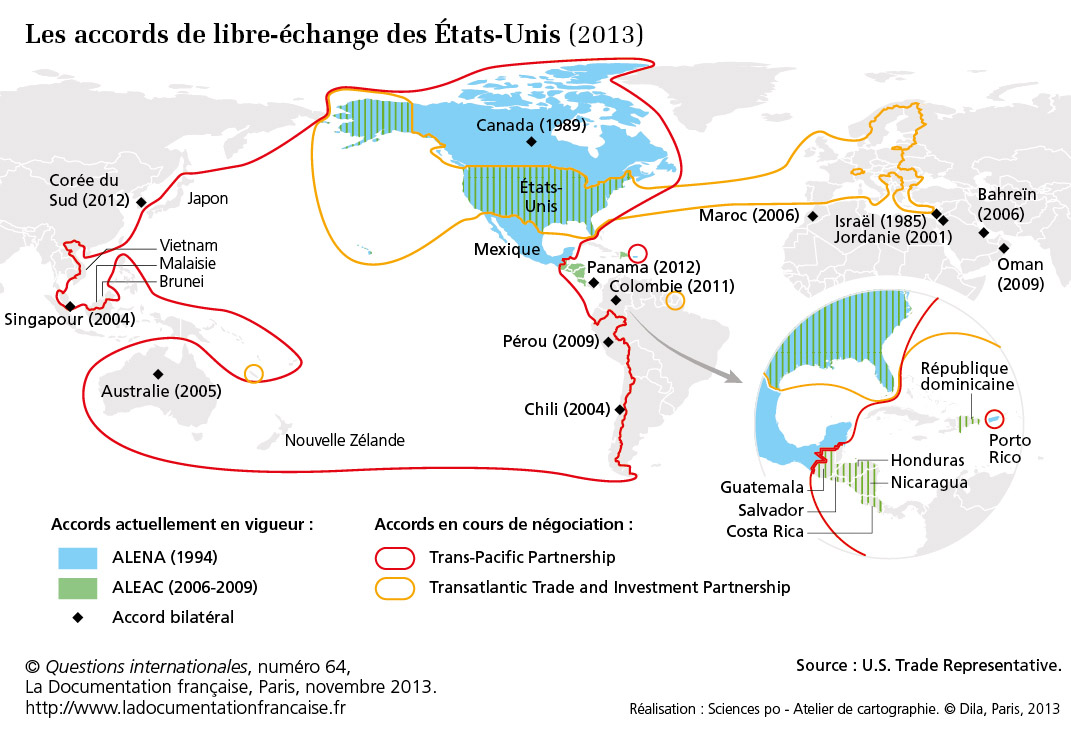Tous les jours, brandissant leurs pancartes, une poignée de militants « pro-life » alpaguent les femmes qui entrent ou sortent de la Jackson Women’s Health Organization, seul établissement pratiquant l’avortement dans l’Etat du Mississippi. Au point qu’en janvier 2013 la directrice, Mme Diane Derzis, a dû mettre en place un système d’escortes afin d’accompagner les femmes entre leur voiture et la porte d’entrée. « Le climat s’est vraiment durci ces derniers mois, depuis que la clinique est menacée de fermeture, regrette-t-elle. Les manifestants se galvanisent mutuellement. »
Le Mississippi deviendra-t-il le premier Etat américain à ne plus pratiquer l’avortement ? Le symbole serait fort, alors que ce territoire de trois millions d’âmes, vaste comme l’Angleterre, est aussi le plus pauvre des Etats-Unis. La clinique de Jackson se trouve en effet en infraction vis-à-vis d’une loi votée au niveau de l’Etat en 2012, qui requiert que les médecins pratiquant l’interruption volontaire de grossesse (IVG) soient conventionnés avec un hôpital proche qui s’engage à prendre en charge leurs patientes en cas de problème. Les trois gynécologues de l’établissement se sont tous vu refuser ces conventions. « Aucun hôpital n’a accepté. Pour des raisons idéologiques, par peur, ou parce que certains de nos médecins ne sont pas résidents du Mississippi, explique Mme Derzis. Ces conventions n’ont rien à voir avec la sécurité de la procédure : de toute façon, les hôpitaux ne peuvent pas refuser nos patientes si une hospitalisation se justifie. Les législateurs savaient parfaitement que cela nous mettrait en péril. »
Le gouverneur républicain Phil Bryant n’a pas masqué son intention de faire du Mississippi le premier abortion free state (Etat où l’avortement ne se pratique plus) du pays. En attendant, la clinique de Jackson, où ont lieu deux mille IVG par an, ne doit la poursuite de ses activités qu’à une décision suspensive d’un juge fédéral. Un procès se tiendra au printemps 2014.
Cette situation n’est pas unique aux Etats-Unis. Des bras de fer similaires ont actuellement lieu dans le Dakota du Nord, en Virginie, dans l’Indiana ou dans l’Alabama. Au total, cinquante-quatre cliniques ou services d’avortement ont fermé depuis trois ans, d’après une enquête menée par le Huffington Post auprès des services de santé (1). Trois Etats, les Dakotas du Nord et du Sud et le Mississippi, ne disposent plus que d’un établissement proposant cet acte.
Le droit à l’avortement aux Etats-Unis repose pourtant sur un socle juridique solide au niveau fédéral. En 1973, l’arrêt « Roe vs Wade » de la Cour suprême a unifié les pratiques divergentes des Etats et établi que toute femme était libre d’avorter jusqu’à la viabilité de son fœtus hors de l’utérus, soit autour de vingt-deux à vingt-quatre semaines. Un délai bien plus long que celui qui prévaut en France, où l’IVG est autorisée jusqu’à douze semaines (l’interruption médicale de grossesse, en revanche, n’est pas soumise à un délai). Un autre arrêt de 1992 (« Planned Parenthood vs Casey ») a complété la jurisprudence en permettant aux Etats d’encadrer le droit à l’avortement, à condition que cet encadrement ne constitue pas un « fardeau excessif » pour les femmes souhaitant avorter. Pour les militants anti-IVG, le combat se joue donc au niveau de chaque Etat.
Un acte encore considéré comme honteux
Durant la seule année 2011, quatre-vingtdouze mesures ont été votées dans les Etats fédérés, selon les calculs du Guttmacher Institute (2). En 2012, leur nombre se montait à quarante-trois, et pour l’année 2013 le compteur affichait déjà soixante-huit au 1er octobre. Une inflation sans précédent. L’organisation Americans United for Life publie même un guide proposant des modèles de lois restreignant le droit à l’avortement.
Vingt et un Etats requièrent désormais des autorisations parentales pour les mineures — parfois des deux parents, comme dans le Mississippi et le Dakota du Nord. Une dizaine ont rendu les échographies obligatoires. Dans le Wisconsin et en Louisiane, le praticien est même tenu de présenter l’image à la patiente et de la décrire. Dans cinq Etats, on a instauré une « séance d’information » qui évoque le lien entre l’avortement et un risque accru de cancer du sein — lien démenti par l’Organisation mondiale de la santé (OMS) — ou mentionne la douleur fœtale. Huit Etats interdisent aux compagnies d’assurances de leurs territoires, pourtant privées, de rembourser l’IVG.
Mais la véritable nouveauté tient à la multiplication des mesures visant les cliniques, souvent gérées par le planning familial ou par d’autres associations (aux Etats-Unis, peu d’avortements ont lieu à l’hôpital). Au nom de la sécurité des patientes, de nouvelles lois leur demandent de réaliser de lourds travaux afin de les aligner sur les standards des hôpitaux pratiquant la médecine ambulatoire : équipements, mais aussi taille des salles, des couloirs, du parking, etc. Selon les recommandations de l’OMS, de tels aménagements n’ont pourtant aucun caractère de nécessité pour les cliniques pratiquant l’avortement au cours du premier trimestre de grossesse. Ces lois « découragent les cliniques, ou font peser sur elles une charge qu’elles ne peuvent supporter », dénonce ainsi la National Abortion Federation (3).
« L’avortement compte au nombre des actes médicaux les plus sûrs. Le risque de complication est minimal, avec moins de 0,5 % de complications majeures », affirme l’American Congress of Obstetricians and Gynecologists dans un communiqué de juillet 2013, en réaction à une nouvelle loi votée au Texas qui exige des cliniques qu’elles s’équipent à la manière des hôpitaux, et des médecins qu’ils disposent de conventions. Elue au Sénat de l’Etat, Mme Wendy Davis s’est élevée contre cette mesure. Attirant l’attention des médias, elle a discouru pendant onze heures, debout devant son pupitre, sans parvenir à empêcher l’adoption du texte. Du fait de cette loi, le Dallas Morning News rapportait que quatre cliniques rurales pratiquant l’IVG étaient sur le point de fermer et que trois autres étaient menacées (4). Si ces fermetures se confirment, un quart des cliniques du Texas auront disparu en 2013.
A ces difficultés s’ajoute parfois le blocage des villes. Le Washington Post relate que la clinique de Fairfax, l’une des plus fréquentées de Virginie, a fermé durant l’été 2013 à la suite d’une bataille avec le conseil municipal : celui-ci lui refusait l’emménagement dans de nouveaux locaux, nécessaire pour se mettre en conformité avec une loi votée par l’Etat en 2011 (5).
Ce durcissement réglementaire s’explique en premier lieu par la vague républicaine de 2010, qui a permis aux conservateurs de contrôler la majorité des chambres des Etats (vingt-sept sur cinquante) et des postes de gouverneur (trente sur cinquante). Elle a également mis sur le devant de la scène de nouvelles figures du Tea Party disposant d’un programme particulièrement réactionnaire sur le thème des droits reproductifs. Alors que dans la plupart des pays d’Europe l’IVG est majoritairement considérée comme un droit acquis, les Américains restent divisés sur le sujet. Dans les Etats du centre et du Sud, actuellement dominés par les républicains (Alabama, Arkansas, Louisiane, Mississippi, etc.), qui comptent parmi les plus pauvres des Etats-Unis (6), 52 % des personnes interrogées par le Pew Research Center estiment que l’avortement devrait être illégal « dans la plupart des cas ». Elles étaient 45 % en 1995. A l’inverse, dans certains Etats de la Côte est (Connecticut, Vermont, New Hampshire, Maine), de tradition démocrate, cette proportion tombe à 20 % (7).
« Avec les armes à feu, l’avortement est l’un des grands clivages culturels qui traversent les Etats-Unis, et qui nous opposent à l’Europe. C’est étonnant, car sur d’autres sujets comme le mariage gay, l’opinion américaine évolue dans un sens progressiste. Et, simultanément, au nom de la morale ou de la religion, l’avortement reste un acte considéré comme honteux. Dans les enquêtes sociologiques, la moitié des femmes qui ont avorté ne le déclarent pas, même face à un ordinateur : les chiffres sont deux fois moins élevés que ceux des statistiques de santé publique », relève Theodore Joyce, professeur en santé publique à la City University de New York. Ces dernières années, en effet, le mariage homosexuel a effectué des progrès considérables aux Etats-Unis. Il est désormais autorisé dans quatorze Etats, dont certains, comme l’Iowa ou le New Jersey, sont gouvernés par des républicains, et l’adoption de ces mesures n’a pas déclenché les manifestations observées en France.
Dans ce climat de division, le maintien du droit à l’avortement dans les Etats les plus conservateurs tient beaucoup à l’action des juges, qui, au nom de l’arrêt « Roe vs Wade », ont à plusieurs reprises fait annuler des législations votées par les chambres. Début 2013, un juge a ainsi retoqué une loi entérinée par les chambres du Dakota du Nord qui affirmait que la viabilité du fœtus était effective dès la perception d’un battement de cœur à l’échographie (soit six semaines) et interdisait l’avortement au-delà de ce terme.
En mai 2013, un autre juge a bloqué une loi qui venait d’être votée par l’Arkansas et qui aurait proscrit l’avortement après douze semaines. « Il était évident que ces lois allaient à l’encontre de “Roe vs Wade” et qu’elles seraient rejetées, remarque le professeur de droit David Garrow. Ce genre d’investissement irrationnel est une tactique politique pour relancer en permanence le débat et occuper le terrain médiatique. » Pour Elizabeth Nash, chercheuse au Guttmacher Institute, « il s’est instauré une forme de concurrence entre Etats : c’est à qui votera la loi la plus stricte ».
Si la Cour suprême basculait…
Alors que les procès et les procédures d’appel se multiplient, certains cas remontent jusqu’à la Cour suprême du pays, qui rend des avis divers et dont la position sur le sujet n’est jamais à l’abri d’un revirement. « Le maintien de “Roe vs Wade” ne tient qu’à une voix. Si un nouveau juge nommé par un président républicain modifie l’équilibre, la Cour peut basculer », s’inquiète Garrow. Plusieurs Etats attendent ce jour avec impatience. Les deux Dakotas, le Mississippi et la Louisiane ont déjà fait voter des lois « provisionnelles » qui rétabliraient immédiatement l’interdiction de l’avortement en cas de renversement de l’arrêt de 1973. Douze autres, comme le Wisconsin, l’Alabama, la Virginie-Occidentale ou l’Oklahoma, n’ont même jamais annulé leurs anciennes lois prohibitionnistes, qui seraient automatiquement réactivées en cas de revirement de la jurisprudence.
Pour l’heure, peu d’études sociologiques mesurent l’impact de ces nouvelles lois sur les patientes. Le taux d’avortements aux Etats-Unis est stable depuis dix ans : autour de 19 pour 1 000 femmes en âge de procréer. Il est moins élevé dans les Etats qui disposent des mesures les plus restrictives, mais la tendance n’a pas évolué au cours des dernières années.
Dans un article publié en 2011 dans le Journal of Policy Analysis and Management, Theodore Joyce a observé que, lorsque le Texas a mis en place, en 2004, une loi demandant aux cliniques pratiquant l’avortement au deuxième trimestre de grossesse de s’équiper à la manière des hôpitaux, « le nombre d’avortements après seize semaines a baissé de 88 % » en un an, tandis que le nombre de femmes se déplaçant dans un autre Etat pour avorter a quadruplé. Les échographies obligatoires, en revanche, ne sembleraient pas avoir d’effet sur les patientes : « Elles sont surtout un moyen de stigmatiser les femmes, les médecins et l’acte, mais, d’après les enquêtes, cela ne les fait pas changer d’avis. »
D’autres travaux sont en cours à l’université de Californie à San Francisco. « Notre sentiment est que ces mesures ont un impact avant tout sur les femmes les plus pauvres. Faute de clinique proche, elles doivent se déplacer toujours plus loin, et payer le voyage. Ce qui peut les amener à reconsidérer leur décision », estime Sarah Roberts, professeure à la faculté de médecine. Son centre de recherche, l’Advancing New Standards in Reproductive Health (Ansirh), mène une vaste étude : elle compare, sur cinq ans, la situation de femmes aux revenus modestes qui ont avorté et d’autres qui ont cherché à le faire mais n’ont pas réussi (8). Les résultats montrent que ces dernières sont beaucoup plus nombreuses à se retrouver au-dessous du seuil de pauvreté et à dépendre d’aides publiques. Pour les Américains, qui voient souvent ces aides d’un mauvais œil, ces résultats apportent un nouvel éclairage sur le coût des politiques antiavortement pour la société.