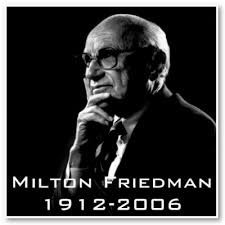Lorsqu’il apprend la victoire électorale de Salvador Allende, le 4 septembre 1970, le général Augusto Ugarte Pinochet, alors commandant de la région d’Iquique (1 600 km au nord de Santiago) réunit ses collaborateurs et leur déclare: «Allende a gagné. C’est un communiste. Le pays s’est fourré dans un sale pétrin.» L’épisode, confirmé par le général, balaye les nombreuses déclarations faites sur la «loyauté constitutionnelle» de l’officier. Dès le verdict des urnes, Pinochet met la démocratie sous haute surveillance. A compter de cette date, les destins du général et du Président s’entremêlent jusqu’au coup d’Etat du 11 septembre 1973 qui met un terme à l’expérience de «transition pacifique et dans la légalité vers le socialisme», tentée par Allende. Originaires de Valparaiso, les deux hommes se sont croisés dans leur jeunesse dans les bars à matelots du port chilien. Mais l’aversion du fils laborieux de militaire pour l’enfant de grands bourgeois aux idées socialistes, libre penseur et franc-maçon, vice-président de la Fédération des étudiants et fort en gueule, est immédiate. A l’issue de ses études de médecine, Allende exerce dans les bidonvilles de Santiago. Cofondateur du Parti socialiste chilien en 1933, «el Pocho» devient vite la coqueluche des habitants des bas quartiers qui apprécient ses idées, sa chaleur humaine et son goût de la vie. Il a 25 ans.
Pinochet, de son côté, poursuit de strictes études au collège du Sacré-Coeur, tenu par une congrégation française. Sa mère, professeur de botanique, tient à préserver les racines francophones d’une famille originaire de Saint-Malo qui a émigré au début du XVIIIe siècle. Pinochet entre à l’Académie militaire l’année même où Allende fonde le PS. Il enseigne ensuite la géographie à l’Ecole de guerre et se passionne pour les questions de «sécurité nationale». Leitmotiv des futures dictatures latino-américaines, mis en avant par les conseillers américains pour lutter contre la «subversion communiste».
4 septembre 1970. Allende président.
Allende abandonne tôt la médecine pour se lancer en politique. Elu député en 1938, il est, quatre ans plus tard, ministre de la Santé d’un gouvernement Front populaire avant d’accéder au Sénat en 1945. A trois reprises (1952, 1958 et 1964), il se présente en vain à la présidence. La dernière fois, il est devancé par le démocrate-chrétien Eduardo Frei (père de l’actuel président chilien). Mais, en 1967, de graves dissensions opposent le Parti démocrate-chrétien (PDC) et le gouvernement Frei. L’aile gauche du parti majoritaire se prononce pour une voie «non capitaliste de développement». Les conflits sociaux s’exacerbent, les grèves perturbent l’économie, les occupations de terres se multiplient. Le PDC finit par éclater: son aile droite décide de soutenir un candidat indépendant, Radomiro Tomic, à l’élection présidentielle de septembre 1970. L’aile gauche de la démocratie chrétienne quitte alors le PDC et crée le Mouvement d’action populaire unitaire (Mapu) avec les partis communiste, socialiste, radical, social-démocrate et l’Action populaire indépendante. Réunie autour d’un programme d’Unité populaire (UP), la gauche soutient la candidature d’Allende. Le 4 septembre, ce dernier obtient 36,3% des suffrages, devançant le candidat de droite, Jorge Alessandri, et Radomiro Tomic. Il revient au Congrès de départager les deux candidats arrivés en tête. C’est Allende qui l’emporte grâce à la démocratie chrétienne, à laquelle il a promis de respecter scrupuleusement la Constitution.
Fuite des capitaux Lorsque Allende entre en fonction, le 4 novembre 1970, la crise s’est aggravée. En deux mois, les opposants au nouveau régime ont procédé à des retraits massifs de capitaux, la production industrielle a chuté, l’approvisionnement marque le pas et le marché noir des devises s’est emballé. Le nouveau président, fort de 36% des suffrages seulement, n’en réaffirme pas moins ses grandes orientations . «Le Chili vient de donner la preuve au monde entier de son haut niveau de conscience et de développement politique. Il permet à un mouvement anticapitaliste d’assumer le pouvoir par le libre exercice des droits civiques [« ] Nous en finirons avec les monopoles qui livrent à quelques familles le contrôle de l’économie [« ] Nous allons mettre en oeuvre une authentique réforme agraire. Nous en terminerons avec le processus de dénationalisation de nos industries qui nous soumet à l’exploitation étrangère. Nous allons restituer à notre peuple les grandes mines de cuivre, de charbon et de salpêtre »»
Dans son réduit d’Iquique, Pinochet s’attend à être limogé. Convoqué à Santiago par le commandant en chef de l’armée de terre, le général René Schneider, il pense se voir signifier sa mise à la retraite. «Augusto, le président Allende m’a appelé pour me dire qu’il ne relèvera aucun général de ses fonctions, lui explique le commandant en chef. Tu peux retourner tranquillement à Iquique.» En fait, Allende mise sur ses bonnes relations avec certains officiers supérieurs, via la franc-maçonnerie, pour neutraliser l’armée. C’est compter sans la fraction «autoritaire» de la hiérarchie: quelques jours plus tard, Schneider est assassiné par l’extrême droite militaire. Allende appelle Pinochet et lui offre le poste de commandant en chef de Santiago. «J’ai accepté en sachant très bien que le pays allait vers la débâcle, confiera le général après son coup d’Etat. Mais j’étais mieux à ce poste pour servir le Chili que chez moi.» Aussitôt constitué, le gouvernement d’Unité populaire cherche à relancer l’économie en soutenant la consommation. Contrôle des prix et augmentation des salaires parviennent à fouetter le marché. Les dépenses publiques dans les secteurs de la santé, de l’éducation, du logement, des transports et de la sécurité sociale soutiennent le processus. Près de 10 millions d’hectares sont expropriés au profit de plus de 100 000 familles. La nationalisation du cuivre (principale ressource du pays) est votée à l’unanimité par le Parlement. L’opération se fait pratiquement sans indemnisation des entreprises américaines qui exploitaient les mines. Cette politique porte ses fruits pendant un moment: le PNB augmente de plus de 8% la première année, le chômage régresse, l’inflation paraît maîtrisée. Et aux élections municipales d’avril 1971, l’Unité populaire récolte plus de 50% des suffrages.
Dissensions et grèves L’orientation socialo-communiste et la politique économique de l’UP hérissent les Etats-Unis, qui n’acceptent pas la «spoliation» de leurs intérêts. Par CIA interposée, ils déstabilisent Allende. En même temps, le fragile équilibre politique interne fondé sur le soutien de la démocratie chrétienne est mis à mal. D’autant que la confiance n’a jamais existé entre partenaires de la coalition.
Le déficit budgétaire croissant des trois années de gouvernement d’Allende (+ 33%en 1971, + 42% en 1972 et + 50% en 1973) finit par déchaîner l’inflation (509% en 1973). Marché noir et grèves reprennent. Dans les derniers mois du régime, la démocratie chrétienne et, avec elle, les classes moyennes lâchent Allende. Présidée par Patricio Aylwin, la DC prend la tête, avec les partis de droite, du mouvement de grève des mineurs d’El Teniente puis de ceux des transports publics, des petits commerçants, des professions libérales et enfin des camionneurs. Sur fond de complots, de vagues d’attentats et d’autodéfense armée, la DC accuse alors le gouvernement de «trahir la classe ouvrière qu’il avait promis de défendre».
Dans le même temps, les relations se sont détériorées entre l’UP et les forces armées. «Des milliers de délinquants défilaient dans les rues, cachés sous des passe-montagnes et armés de casques et de manches de pioche, a raconté Pinochet. Des milliers de guérilleros armés attendaient autour de la capitale pour venir assassiner les Chiliens. C’était le chaos.» Sept tentatives de putsch avortent. Parallèlement, les Etats-Unis accroissent leur aide aux militaires chiliens (13 millions de dollars en 1972, contre 1 million en 1970). Dans ce contexte, en juillet 1973, Allende demande au Parlement d’instituer la loi martiale pour six mois. «La subversion est en marche et les institutions de l’Etat sont en danger», explique-t-il. Le projet est repoussé par l’Assemblée. Fin juillet, un aide de camp d’Allende est assassiné par un commando d’extrême droite. Dans un pays paralysé, le Président est contraint de former un cabinet d’union nationale; les militaires lui apportent un soutien mesuré. Le commandant en chef de l’armée de terre, le général Carlos Prats, ami du Président, accepte le ministère de la Défense. Deux autres généraux prennent les portefeuilles des Travaux publics et du Trésor. Mais la grève des camionneurs, qui en est à sa sixième semaine, financée par Washington, empêche tout approvisionnement. Une vague d’attentats ensanglante le Chili. «Le pays est au bord de la guerre civile», prévient Allende, le 13 août, dans un discours interrompu par une panne d’électricité due à un attentat. A la fin du mois, les militaires abandonnent le gouvernement, les uns après les autres.
Allende est définitivement lâché le 23 août, lorsque le général Prats démissionne du cabinet et de ses fonctions de commandant en chef. Le Président, qui croit encore en la loyauté de Pinochet, le désigne comme successeur. En fait, le général complote depuis plusieurs semaines sous le nom de code de » Pinocchio! L’heure du golpe de estado a sonné.
11 septembre 1973. Le coup d’Etat.
A l’aube du 11 septembre 1973, alors qu’Allende se prépare à annoncer un référendum sur les institutions politiques, l’infanterie de marine se soulève à Valparaiso. Une junte, composée de Pinochet pour l’armée de terre, de l’amiral José Merino et des généraux César Mendoza (carabiniers) et Gustavo Leigh (armée de l’air), somme Allende de se rendre. Les tanks envahissent le centre de Santiago et font le siège du palais de la Moneda, où le Président s’est barricadé en compagnie de ses derniers fidèles. Tandis qu’il négocie la libération des employés de la présidence, on lui propose un avion pour quitter le pays. Des sources militaires le mettent en garde: l’avion devrait s’abîmer en mer après le décollage. Allende refuse et confirme sa décision «de résister par tous les moyens, même au prix de sa vie». Son discours est interrompu lorsque les rebelles s’emparent des émetteurs. Allende, coiffé d’un casque de combat, ceint de l’écharpe présidentielle et armé d’une Kalachnikov offerte par Castro, tire sur les chars. Les putschistes font donner l’aviation. Peu après, l’ambassadeur des Etats-Unis sable le champagne avec son staff.
Dans les décombres fumants, les militaires découvrent les corps de Salvador Allende et de son attaché de presse, Augusto Olivares. Le Président s’est suicidé. La nuit suivante, sa dépouille est transportée au petit cimetière de Vina del Mar (à 120 km de Santiago), où elle est inhumée anonymement sous une dalle de granit. Jusqu’à l’enterrement officiel d’Allende, en septembre 1990, des bouquets de fleurs déposés sur la tombe constitueront autant de pieds de nez à la dictature. Hortensia Bussi, femme du Président, et ses deux filles, Beatriz et Maria Isabel, partent en exil.
Répression aveugle Lorsqu’ils s’emparent de Santiago, les militaires craignent une résistance des partisans de l’UP. L’armée décide de frapper fort. En fait, l’opposition est faible, les armes stockées n’ont pas été distribuées, et peu de Chiliens sont prêts à défendre la démocratie. L’armée de terre se lance pourtant dans une répression aveugle. En intervenant contre l’ordre institutionnel, elle a perdu sa réputation surfaite d’armée constitutionnelle (elle a tenté une dizaine de putschs en trente ans). Elle va maintenant gagner ses galons dans l’horreur. Les opposants au golpe descendus dans les rues sont impitoyablement frappés, voire exécutés sur place. «Le rio Mapocho (fleuve qui traverse Santiago, ndlr) charriait les cadavres, se rappelle Diego, à l’époque militant communiste. La violence de la répression nous a pris de court, et de nombreux camarades ne pensaient plus qu’à se réfugier dans les ambassades étrangères.» Des milliers de jeunes sont parqués dans le stade de Santiago, torturés, violés. Beaucoup sont exécutés. La répression est féroce: on arrête, on rassemble, on fusille. Elle touche surtout les militants communistes, socialistes, ceux du Mouvement de la gauche révolutionnaire (MIR) et du Mapu. Près de 1800 personnes sont assassinées en quelques semaines.Officiellement, un mois après le coup d’Etat, on comptait plus de 5 000 détenus dans le stade de Santiago, 1 500 sur un bateau ancré à Valparaiso et plusieurs centaines dans des îles proches de la côte.
Dans un communiqué publié après le putsch, le chef de la démocratie chrétienne, Patricio Aylwin, félicite les nouveaux maîtres du Chili: «Le nouveau gouvernement mérite la coopération patriotique de tous les secteurs de la société. Les traditions portent à croire que les forces armées, dès qu’elles auront accompli les tâches dont elles se sont chargées pour éviter la destruction qui menaçait la nation, remettront le pouvoir au peuple souverain.» Un demi-million de Chiliens est contraint à l’exil en Argentine, au Mexique, en France, en Allemagne, dans les pays scandinaves. Le gouvernement établit des listes de proscription, tandis que des milliers de syndicalistes sont déportés vers les terres australes (les relegados). Le Parlement est fermé, les partis de gauche et les syndicats sont interdits, les autres partis «suspendus». Toute tentative de manifestation est sévèrement réprimée. Des camps de prisonniers sont ouverts dans chacune des treize provinces. Couvre-feu, état de siège et état d’urgence sont décrétés sur un Chili vaincu et humilié. «Nos communiqués minoraient systématiquement l’ampleur de la répression contre les humanoïdes marxistes, nous a affirmé en 1989 le général Manuel Contreras, l’ancien chef de la Dina. Nous devions terroriser le peuple pour l’empêcher de se soulever. Le recours à la torture était systématique et les ordres venaient du plus haut niveau.»
Plébiscites Pinochet, en effet, a créé sa police politique, la Direccion de investigacíon nacional, qui ne répond qu’à lui et traque les opposants. Enlèvements, disparitions et tortures dans des centres «spécialisés», comme ceux de Villa Grimaldi, Tres Alamos, Calle Londres ou Borgono (pour la capitale), se multiplient. Les supplices de l’électricité, de la baignoire, de l’émasculation, de l’amputation des doigts et des oreilles deviennent monnaie courante. Certaines unités se spécialisent même dans l’assassinat des prisonniers par enfermement dans un grand sac avec un condor, le rapace des Andes » Cependant, l’assassinat du général Carlos Prats, le 30 septembre 1974 à Buenos Aires, où il a trouvé refuge, et l’attentat meurtrier à la voiture piégée en plein centre de Washington contre Orlando Letellier, ancien ministre des Affaires étrangères d’Allende, en septembre 1976, mettent le régime Pinochet au ban des nations. Les deux meurtres ont été commis par Michael Townley, membre de la Dina, sur ordre du général Contreras qui contrôle la police secrète. En 1977, Pinochet remplace la Dina par la CNI (Centrale nacional de investigaciones), mais la violence reste la même. Des escadrons de la mort font aussi leur apparition.
Pinochet, d’abord chef de la junte, s’est tour à tour fait nommer chef suprême de la nation, chef de l’Etat et enfin président de la République en décembre 1974. Il abandonne peu à peu son uniforme et ses lunettes noires pour le costume civil, sourire aux lèvres et le verbe populiste. «J’ai toujours été une bonne personne. Je salue les dames, je fais des caresses aux enfants, j’aide les pauvres. En fait, je suis un démocrate » à ma manière», aime-t-il confier. Le général cherche surtout à améliorer son image tout en préparant une nouvelle Constitution. Il finit par organiser un référendum, le 4 janvier 1978. A la proposition «Face à l’agression internationale lancée contre notre patrie, j’appuie le général Pinochet dans la défense de la dignité du Chili, et je réaffirme la légitimité du gouvernement de la République [« ]», une écrasante majorité de Chiliens répond oui. Fort de ce résultat, le général en profite pour épurer l’armée des officiers peu sûrs: le général Leigh est de ceux-là. Dans la foulée, huit généraux d’aviation sont mis à la retraite tandis que dix autres démissionnent. Entre-temps, la loi du 19 avril 1978 a amnistié tous les crimes et délits commis par des militaires, des policiers et des agents de sécurité du régime.
En septembre 1980, un deuxième référendum approuve la nouvelle Constitution et désigne Pinochet comme président pour un mandat de neuf ans. La Constitution prévoit qu’à l’issue de ce mandat les citoyens se prononcent de nouveau par référendum sur le prochain candidat choisi » par les commandants en chef des armées. Cette disposition vise bien sûr Pinochet, qui régnerait alors jusqu’en 1997. L’article 45 de la Constitution lui accorde également de devenir sénateur à vie après son dernier mandat.
Libéralisme sauvage Tout à la répression, le gouvernement militaire abandonne les rênes de l’économie aux monétaristes adeptes de l’école de Chicago, fondée par Milton Friedman. Les «Chicago Boys» (qui placent la stabilité monétaire au centre de tout) trouvent dans la dictature un prodigieux laboratoire pour mettre en oeuvre leur libéralisme sauvage: pas de grève, pas de syndicats, pas de contestation sociale » et une police omniprésente. Dans un premier temps, les droits de douane sont supprimés en pratique et le Chili est inondé de produits étrangers. Suivent privatisations, licenciements collectifs, coupes claires dans les budgets de l’éducation et de la santé, chute vertigineuse des salaires » Entre 1976 et 1980, le taux de croissance est de 7% l’an, mais les faillites se multiplient, le système financier s’enraye et le mécontentement populaire inquiète les autorités. Neuf ans après le coup d’Etat, le peso a perdu 50% de sa valeur, 30% de la population active est au chômage, les exportations ont chuté de 18%, l’industrie est au point mort, le déficit de la balance des paiements se monte à 680 millions de dollars et la dette extérieure s’élève à 18 milliards. Tous les indicateurs sont au rouge. Les classes moyennes sont ruinées. L’échec du modèle ultralibéral est consommé le 15 décembre 1982 avec une grande manifestation dans les rues de Santiago aux cris de «Pain, travail, justice et liberté!».
Etat de siège La faillite des «Chicago Boys» entraîne la généralisation des protestas, puis des appels à la grève générale. Afin de désamorcer le mécontentement, Pinochet publie, le 14 janvier 1983, une liste de 79 exilés politiques autorisés à rentrer au Chili. Peine perdue. Les Chiliens semblent avoir vaincu la peur. La mobilisation des poblaciones se poursuit. Le 11 mai 1983, la première journée de «protestation civile» est organisée par la Confédération des travailleurs du cuivre. De violents heurts font deux morts parmi les manifestants et des dizaines de blessés à Santiago. Les ménagères, qui défilaient sous le gouvernement d’Unité populaire en frappant sur des casseroles pour protester contre la pénurie, reprennent du service contre le régime. L’armée anticipe les manifestations par de violentes rafles dans les bas quartiers et réinstitue le couvre-feu. Les partis démocrate chrétien, radical, libéral et socialiste modéré se regroupent dans des structures tels le Manifeste démocratique ou le Projet démocratique national (Proden). Chaque manifestation provoque son lot de morts et de blessés. Dans l’espoir de désamorcer la tension, Pinochet annonce le 19 août un programme de grands travaux censés créer 80 000 emplois. Un mois plus tard, pour le dixième anniversaire du coup d’Etat, cinq personnes sont tuées. Fin septembre, le mouvement se radicalise: le Mouvement démocratique populaire, formé du Parti communiste, du Mouvement de la gauche révolutionnaire (MIR) et du Parti socialiste de Clodomiro Almeyda ancien ministre des Affaires étrangères d’Allende , appelle à manifester pour chasser les militaires. Le 16 octobre, six manifestants trouvent la mort.
Certains officiers commencent à critiquer la participation de l’armée au maintien de l’ordre. En décembre 1983, le Front patriotique Manuel-Rodriguez (FPMR), émanation du Parti communiste, entame la lutte armée contre le régime. Il se spécialise dans l’assassinat de carabiniers et échoue, le 7 septembre 1986, dans un attentat à la roquette contre le dictateur.
Pinochet cède du terrain. Le 11 mars 1984, il annonce, sans en fixer la date, un référendum sur une réforme constitutionnelle afin de «poser les bases d’un rétablissement de la démocratie au Chili». Mais les protestas redoublent. Le 27 mars, le Chili est paralysé par la grève et, pour la première fois, les quartiers résidentiels de Santiago participent au mouvement. Toute l’année, les manifestations se poursuivent. Le 4 septembre, une protesta est très brutalement réprimée. Dans le bidonville la Victoria, symbole de la résistance, le prêtre français André Jarlan est assassiné par un caporal. L’état de siège est réinstauré.
«L’exemple chilien»
A partir du 11 février 1985, un étrange personnage apparaît dans les couloirs du palais présidentiel. Hernan Büchi, 42 ans, chevelu en blazer qualifié de «rock star» ou de «hippie économiste», vient d’être nommé ministre des Finances. Ancien de Columbia University, l’homme est une forte tête et un anticonformiste. Avant le coup d’Etat militaire, il ne cachait pas sa sympathie pour le MIR, mais a renié ses convictions de jeunesse.
L’Eglise traditionnelle et les durs du régime ne font aucune confiance à ce protégé de Lucia, la femme de Pinochet. Tour à tour conseiller à l’Economie, sous-secrétaire d’Etat à la Santé, directeur général des Banques et enfin ministre des Finances, il trouve dans la dictature l’occasion de mettre en pratique ses idées. Friedmanien pragmatique et fort de l’état d’urgence, il impose une nouvelle cure d’austérité. Cette fois-ci, la recette fonctionne. En quatre ans (1985-1989), le développement des mines d’or et d’argent, des dérivés du pétrole, de l’industrie forestière, de la pêche et de la culture des fruits rend la balance commerciale bénéficiaire. La croissance se poursuit à marche forcée sans excès inflationniste, le budget est excédentaire et la dette extérieure en réduction. Mieux, les investissements étrangers notamment australiens, européens et américains affluent de nouveau. Toute l’Amérique latine lorgne vers «l’exemple chilien». En oubliant que plus du tiers des 13 millions de Chiliens restent sur la touche et que le Smic équivaut à 500 F. Pourtant, les Chiliens s’accrochent à un développement arraché «aux larmes et à la douleur». Fort de ces bons résultats, Pinochet se fait désigner candidat à la présidence pour l’élection de1989. Un référendum, le 5 octobre 1988, doit confirmer ce choix. Le 27 août 1988, Pinochet met fin à l’état d’urgence. Le 30, la junte le désigne à la candidature pour la présidence jusqu’en 1997. Dans la foulée, les partis politiques sont légalisés et tous les exilés autorisés à rentrer au pays. Mais les partis d’opposition, des socialistes-marxistes à la droite libérale, se regroupent au sein de l’Accord pour le non (à la candidature Pinochet). Le 31 septembre, dans une allocution télévisée, le général demande aux électeurs de lui pardonner ses erreurs éventuelles: «Si j’ai fait quelque chose de mal, pardonnez-moi, supplie-t-il. Mais je crois que quand vous ferez l’addition, il y aura plus de points positifs en ma faveur que de négatifs.» Le lendemain, une gigantesque manifestation regroupe dans les rues de Santiago plus d’un million de personnes en faveur du non. Et le 5 octobre, le dictateur est victime des urnes: le non recueille 56% des suffrages exprimés. «Je respecterai les résultats. Le Chili poursuivra son chemin jusqu’à la pleine démocratie sans que rien ni personne ne puisse l’arrêter», assure Pinochet.
Retraite assurée Divisé entre ses ambitions et le verdict des électeurs, Pinochet s’attache à organiser des élections tout en multipliant les embûches. La Ley organica del Banco central, par exemple, impose l’autonomie de la Banque centrale jusqu’à présent contrôlée par l’Etat et lui interdit de financer des dépenses publiques. Une loi sur les forces armées impose un budget militaire qui «ne peut pas être inférieur à celui de l’année précédente, en valeur constante». Les hommes de confiance du général, tous officiers supérieurs, sont implantés dans les conseils d’administration des principales entreprises publiques et privées.
Un Conseil de sécurité nationale est par ailleurs prévu par la Constitution de 1980, et les commandants en chef des armées, le directeur général des carabiniers et certains anciens ministres en sont membres de droit. Dernière nasarde à une classe politique qu’il méprise, le dictateur relègue le futur Congrès à Valparaiso. Il conserve pour sa part ses fonctions de commandant en chef de l’armée de terre jusqu’en mars 1998, puis devient sénateur à vie.
14 decembre 1989. La junte à terre. Que le dictateur s’en aille!» Vers 21h30, le 14 décembre 1989, la joie éclate enfin au Chili. Des centaines de milliers de personnes convergent en chantant vers le centre de Santiago pour une nuit de délire. Patricio Aylwin, candidat unique de l’opposition regroupée au sein de la Concertation des partis pour la démocratie remporte la présidentielle avec 55,2% des suffrages contre le candidat de la junte, Hernan Büchi (29,4%). Aylwin, dans son premier message, n’omet pas de rendre hommage aux forces armées. L’homme, qui, en 1973, avait mis de longs mois à prendre ses distances avec les militaires, confirme la couleur. Le gouvernement de «transition vers la démocratie» qui entre en fonction en mars 1990 suivra les rails des militaires. Un peu plus de social, plus de libertés, beaucoup moins de répression » mais un profond respect pour «l’oeuvre accomplie» par Pinochet. En 1994, son successeur, le démocrate-chrétien Eduardo Frei, ne changera pas la ligne.
Juste avant de quitter le pouvoir, Pinochet ordonne la dissolution de sa police secrète, la CNI. Toutes les archives de «cet organisme qui a servi [son] gouvernement et n’a plus de raison d’être», selon le dictateur, sont détruites ou transférées à l’armée de terre. En l’absence de preuves, il devient donc difficile pour le nouveau gouvernement, s’il en avait eu le désir, de diligenter des enquêtes. Quelques mois après le retour de la démocratie, une commission a été créée pour faire la lumière sur les crimes commis durant la dictature. Mais, soucieuse de ne pas offusquer l’état-major, elle a pris soin de mettre sur le même plan les exactions gouvernementales et les actes de terrorisme.
Un rapport de 2000 pages est rendu public un an après l’accession d’Aylwin à la présidence. Il fait état de 2 279 personnes assassinées par des agents de la dictature, de 641 morts «dans des conditions non élucidées» et de 957 «détenus disparus». En demandant «pardon aux familles», Aylwin a bien souligné que «l’Etat et la société dans son ensemble sont responsables et débiteurs à l’égard des victimes». Mais il n’a rien fait pour accélérer les actions judiciaires. Un temps réfugié à la Colonie Dignidad, secte composée d’anciens nazis et de leurs descendants à 200 km au sud de Santiago, le général Contreras, ancien chef de la Dina, a bien été arrêté. Mais «la démocratie chilienne n’est pas assez forte pour emprisonner 2 000 officiers coupables», affirment aujourd’hui encore de hauts responsables chiliens.
Gérard Thomas