
Soutien de l’opinion, opposition muselée, escadrons de la mort, tolérance internationale…, c’est l’état de grâce permanent pour le président philippin Rodrigo Duterte.
L’élection de Rodrigo (Digong) Duterte à la présidence de la République des Philippines en mai 2016 revêt une dimension nationale, mais aussi internationale. Duterte appartient au camp des nouveaux démagogues, comme Vladimir Poutine en Russie, Recep Tayyip Erdogan en Turquie ou Viktor Orban en Hongrie. Ces leaders populistes qui, pour reprendre les termes du politologue allemand Jan-Werner Müller, « ne s’arrêtent pas à une simple critique des élites [mais] affirment qu’eux, et eux seuls, représentent le vrai peuple »1.
Rodrigo Duterte est un démagogue exceptionnel tant par la violence de ses propos et de son action, que par le niveau de popularité dont il bénéficie toujours aux Philippines. Ce constat devrait nous inciter à nous interroger sur la nature des trajectoires démocratiques et sur la spécificité de chaque pays. Son élection n’est en effet pas un accident de l’histoire. Elle s’inscrit dans celle des Philippines. Dans les îles qui, depuis la colonisation espagnole (1565-1898), constituent l’archipel des Philippines, l’ordre social s’organisait autour des datus (hommes de prouesse) qui possédaient un pouvoir spirituel, le kapangyariahn. Ces hommes étaient souvent nommés cabezas de barangay (chefs de village) ou gobernadorcilos (chefs de province) par l’administration espagnole.
Par la suite, lors de la colonisation américaine du pays (1898-1946), les plus talentueux sont devenus maires ou, s’ils faisaient partie de l’élite métissée, des élus de la Législature consultative créée par les Américains pour préparer à la démocratie les little brown brothers (petits frères bruns), selon l’expression des administrateurs américains de l’époque. Pour les plus modestes, ou les moins métissés, la fonction publique restait le seul salut. La création du fonctionnariat aux Philippines est donc antérieure à celle de la nation et, a fortiori, d’un Etat-nation philippin. Aujourd’hui encore, tout individu confronté à un fonctionnaire philippin fait face à l’arbitraire. Car la distinction entre le pouvoir réglementé par un statut légal et le pouvoir personnel reste floue. La personnalisation du pouvoir fonctionne à outrance.
À la fois shérif et Robin des Bois
Rodrigo Duterte s’est présenté comme le candidat du peuple, opposé aux trappos (politiciens traditionnels), à l’élite de Manille et aux oligarques du Makati Business Club (symbole du grand patronat). Certes, il est le premier président des Philippines venant de l’île (pauvre) de Mindanao, au sud de l’archipel, mais sa famille est originaire de Cebu, située au centre de l’archipel.
Rodrigo Duterte a lui-même succédé à son père en 1988 au poste de maire de Davao, la grande ville du sud-est de Mindanao, poste qu’il a conservé pendant presque trente ans. Il a enrayé la criminalité dans cette ville en créant les escadrons de la mort. Sous sa magistrature, Davao est devenue la ville la plus sûre des Philippines, au prix toutefois d’un total mépris pour la justice. En même temps, Duterte s’est rapproché de la minorité musulmane et des forces de gauche, améliorant la couverture sociale de ses administrés et le système éducatif de sa ville.
Les Philippins sont en général indulgents avec leurs présidents, qui bénéficient d’une sorte d’état de grâce pendant la première année de leur mandat. Malgré sa « guerre contre la drogue » (ou en raison d’elle), qui a fait entre 8 000 et 12 000 victimes, exécutées par la police ou par les milices, Rodrigo Duterte, à la fois shérif et Robin des Bois, ne fait pas exception. D’autant plus qu’il a engagé des actions appréciées par la partie de son électorat la plus à gauche. Par exemple, dès son élection à la présidence, il a entamé des négociations avec la guérilla communiste de la Nouvelle armée du peuple (NPA) et avec les séparatistes musulmans du Front Moro islamique de libération (FMIL). Il a en outre fait entrer d’anciens communistes dans son gouvernement.
Le chef de l’Etat a également annoncé une hausse significative des investissements dans les infrastructures publiques. Il a lancé la création d’un système national de couverture maladie, rendu gratuit l’accès aux universités publiques, augmenté le niveau des retraites et limité le recours aux contrats de travail de courte durée. Ces mesures ont été très appréciées par la classe ouvrière et par la petite bourgeoisie. Rodrigo Duterte bénéficie donc à la fois du soutien de la gauche et de celui du milieu des affaires.
Son nationalisme est ethnique et identitaire, ce qui rassure la gauche philippine anti-américaine, mais il n’est nullement économique. Ainsi, depuis son élection, Duterte a libéralisé l’économie. Il a également obtenu la démission de son ministre de l’Environnement, hostile à l’exploitation du nickel dans le pays.
Une certaine nostalgie de la dictature de Marcos
Il a aussi acheté le silence de la classe politique dans son ensemble et il ne reste guère de force d’opposition au Congrès philippin, Duterte évitant de s’attaquer au système néopatrimonial qui permet aux politiciens philippins de jouer les seigneurs dans leur circonscription. Il jouit ainsi d’un fort soutien au Congrès : les caciques ne sont pas inquiétés tant qu’ils se taisent, à défaut de quoi le président n’hésite pas à faire fonctionner la répression. Il a notamment fait emprisonner son unique véritable adversaire au Sénat, Leila de Lima, présidente de la Commission des droits de l’homme. Quant à la vice-présidente du pays, Maria Leonor Robredo, son élection de 2016 pourrait être invalidée.
Rodrigo Duterte a aussi facilité la réhabilitation de l’ancien dictateur Ferdinand Marcos (1965-1986) en le faisant enterrer, dix-huit ans après sa mort, dans le cimetière des héros à Manille. Une certaine nostalgie de la dictature de Marcos est, du reste, encouragée par l’actuel chef de l’Etat. Par ailleurs, Duterte s’est emparé du Philippine Inquirer, l’un des seuls journaux qui a eu le courage de s’opposer à la guerre contre la drogue. Enfin, en augmentant les moyens de la police, et surtout de l’armée, et en accordant un blanc-seing aux militaires, Duterte est parvenu à les neutraliser, eux qui avaient longtemps été un pôle d’opposition, notamment en contribuant à la chute de Marcos en 1986. L’Eglise catholique, ou plutôt sa branche la plus libérale, est désormais la seule force à s’opposer au président.
Sur la scène internationale, Duterte bénéficie de la rivalité sino-américaine et de l’élection de son alter ego, Donald Trump. Le président américain se montre moins critique sur la situation des droits de l’homme dans l’archipel depuis que les Philippines sont devenues un nouveau front dans la guerre de Washington contre le terrorisme islamique après l’adhésion d’un des groupuscules islamo-séparatistes de Mindanao à l’Etat islamique.
Par ailleurs, pour attirer les investissements chinois, le président philippin a mis un voile sur le contentieux avec son voisin sur leurs zones de souveraineté respectives en mer de Chine du Sud. Il se garde donc bien de demander l’application du jugement du Tribunal d’arbitrage de La Haye du 11 juillet 2016 qui a pourtant donné gain de cause à son pays.
Il serait néanmoins trompeur de voir dans la popularité de Rodrigo Duterte le seul reflet de son populisme. Si plus des trois quarts des Philippins le soutiennent, c’est en raison de la défaillance de l’Etat. L’histoire montre que les méthodes expéditives des milices privées sont tolérées et même approuvées par la population lorsque l’Etat d’un pays est incapable d’assurer la sécurité et la justice de ses propres citoyens. Comment ne pas soutenir un justicier bienfaiteur du peuple ?
Voir Qu’est-ce que le populisme ? Définir enfin la menace, par Jan-Werner Müller, Premier Parallèle, 2016, p. 40.
David Camroux
Source Hors série Alter Eco 01/01/2018
Repéres
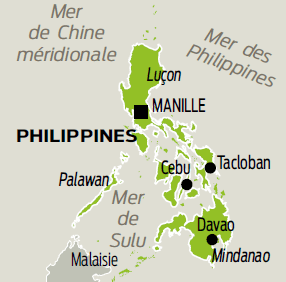 Population : 103 millions
Population : 103 millions
PIB : 305 milliards de dollars
Taux de croissance : + 6,9 %
Taux de chômage : 5,9 %
Espérance de vie : 69 ans
Source : Banque mondiale ; données 2016
Voir aussi : Actualité Internationale , Rubrique Asie, Philippines, Meurtre d’une écologiste en campagne contre le lobby du charbon, Birmanie , rubrique Indonésie,: le gouverneur chrétien de Jakarta battu par son rival musulman, Joko Widodo prend la tête de l’une des principales économies d’Asie, rubrique Thaïlande, Coup d’Etat soutenu par les Etats-Unis, rubrique Politique, Société civile, rubrique Société, Pauvreté,




