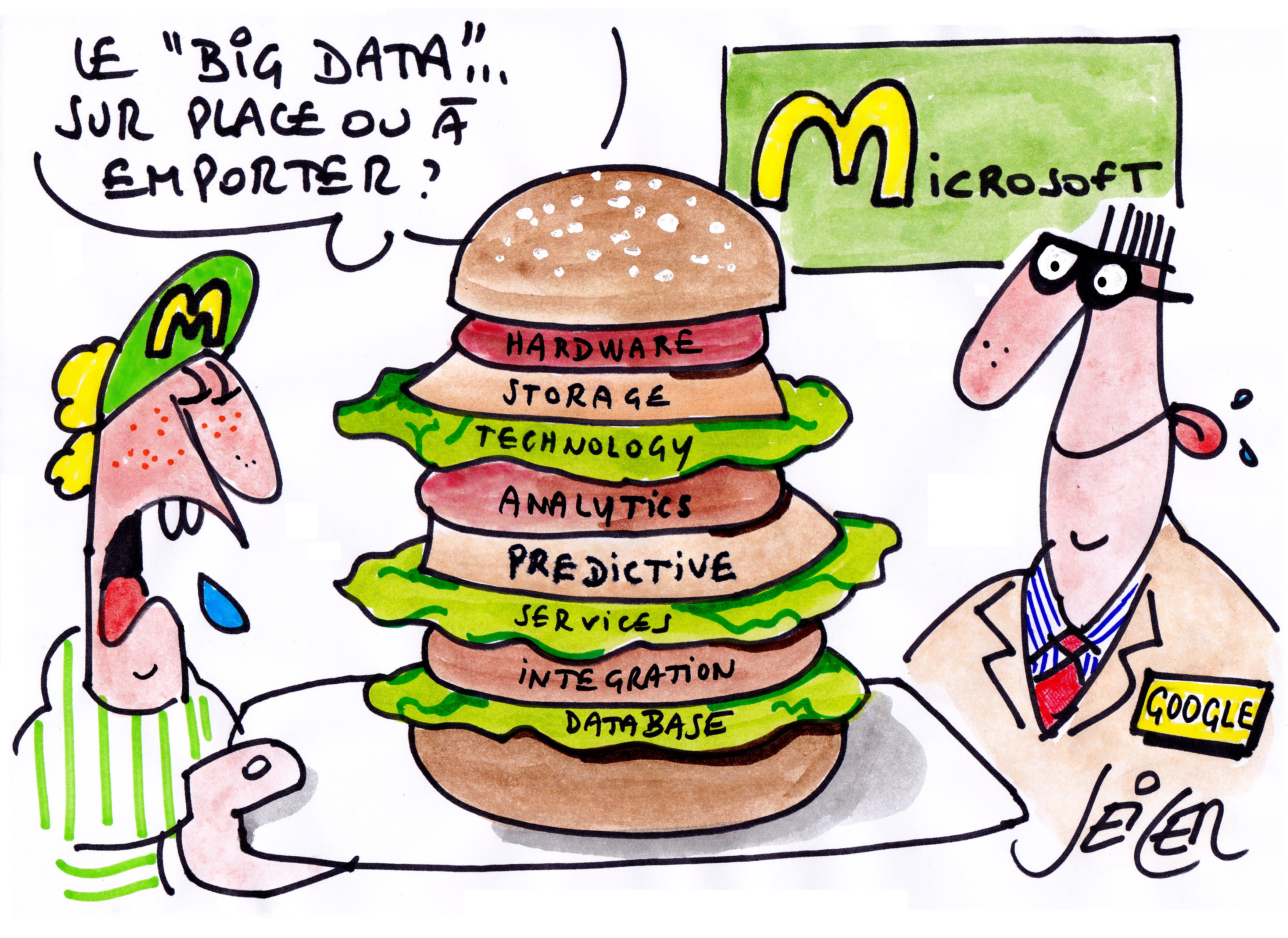Laurent Fabius et le ministre du pétrole saoudien Ali al-Naimi le 8 novembre à Paris. BERTRAND GUAY / AFP
Soyons réalistes, demandons l’impossible, clamaient dans les rues de Paris les utopistes de mai 1968. Etre réaliste aujourd’hui, c’est réclamer à ceux qui gouvernent d’aller aux racines de ce mal qui, le 13 novembre, a tué au moins 129 personnes dans la capitale française. Elles sont multiples, et il n’est pas question d’en faire ici l’inventaire. Nous n’évoquerons ni l’abandon des banlieues, ni l’école, ni la reproduction endogamique d’élites hexagonales incapables de lire la complexité du monde. Nous mesurons la multiplicité des causes de l’expansion de l’islamisme radical.
Comme nous savons à quel point l’étroitesse des rapports entretenus dans tout le monde arabe entre les sphères politique et religieuse a pu faciliter son émergence, nous n’avons aucune intention simplificatrice. Mais, aujourd’hui, c’est la politique internationale d’une France blessée, et de l’ensemble du monde occidental, que nous voulons interroger.
Sur l’islamisme d’abord. Depuis le début de sa montée en puissance, dans les années 1970, les dirigeants occidentaux se sont convaincus qu’il devenait la force politique dominante du monde arabo-musulman. Addiction au pétrole aidant, ils ont renforcé le pacte faustien les liant aux Etats qui en sont la matrice idéologique, qui l’ont propagé, financé, armé. Ils ont, pour ce faire, inventé l’oxymore d’un « islamisme modéré » avec lequel ils pouvaient faire alliance.
Le soutien apporté ces derniers mois au régime turc de M. Erdogan dont on connaît les accointances avec le djihadisme, et qui n’a pas peu contribué à sa réélection, en est une des preuves les plus récentes. La France, ces dernières années, a resserré à l’extrême ses liens avec le Qatar et l’Arabie saoudite, fermant les yeux sur leur responsabilité dans la mondialisation de l’extrémisme islamiste.
Le djihadisme est avant tout l’enfant des Saoud et autres émirs auxquels elle se félicite de vendre à tour de bras ses armements sophistiqués, faisant fi des « valeurs » qu’elle convoque un peu vite en d’autres occasions. Jamais les dirigeants français ne se sont posé la question de savoir ce qui différencie la barbarie de Daesh de celle du royaume saoudien. On ne veut pas voir que la même idéologie les anime.
Cécité volontaire
Les morts du 13 novembre sont aussi les victimes de cette cécité volontaire. Ce constat s’ajoute à la longue liste des soutiens aux autres sanglants dictateurs moyen-orientaux – qualifiés de laïques quand cela convenait – de Saddam Hussein à la dynastie Assad ou à Khadafi – et courtisés jusqu’à ce qu’ils ne servent plus. La lourde facture de ces tragiques inconséquences est aujourd’hui payée par les citoyens innocents du cynisme à la fois naïf et intéressé de leurs gouvernants.
L’autre matrice du délire rationnel des tueurs djihadistes est la question israélo-palestinienne. Depuis des décennies, les mêmes dirigeants occidentaux, tétanisés par la mémoire du judéocide perpétré il y a soixante-dix ans au cœur de l’Europe, se refusent à faire appliquer les résolutions de l’ONU susceptibles de résoudre le problème et se soumettent aux diktats de l’extrême droite israélienne aujourd’hui au pouvoir, qui a fait de la tragédie juive du XXe siècle un fonds de commerce.
On ne dira jamais assez à quel point le double standard érigé en principe politique au Moyen-Orient a nourri le ressentiment, instrumentalisé en haine par les entrepreneurs identitaires de tous bords. Alors oui, soyons réalistes, demandons l’impossible. Exigeons que la France mette un terme à ses relations privilégiées avec l’Arabie saoudite et le Qatar, les deux monarchies où l’islam wahhabite est la religion officielle, tant qu’elles n’auront pas coupé tout lien avec leurs épigones djihadistes, tant que leurs lois et leurs pratiques iront à l’encontre d’un minimum décent d’humanité.
Exigeons aussi de ce qu’on appelle « la communauté internationale » qu’elle fasse immédiatement appliquer les résolutions des Nations unies concernant l’occupation israélienne et qu’elle entérine sans délai la création trop longtemps différée de l’Etat palestinien par le retour d’Israël dans ses frontières du 4 juin 1967.
Ces deux mesures, dont riront les tenants d’une realpolitik dont on ne compte plus les conséquences catastrophiques, n’élimineront pas en un instant la menace djihadiste, aujourd’hui partout enracinée. Mais elles auront l’immense mérite d’en assécher partiellement le terreau. Alors, et alors seulement, les mesures antiterroristes prises aujourd’hui en l’absence de toute vision politique pourraient commencer à devenir efficaces.
Sophie Bessis et Mohamed Harbi (Historiens)
Sophie Bessis est l’auteur de La Double Impasse. L’Universel à l’épreuve des fondamentalismes religieux et marchand (La Découverte, 2014) ; Mohamed Harbi est ancien membre puis historien du Front de libération nationale algérien (FLN).
Voir aussi : Actualité nationale La France en première ligne dans la guerre terroriste ,
rubrique Politique Politique Internationale, Comment l’Arabie Saoudite promeut l’islamisme à l’échelle planétaire, Moyen Orient. , Agiter le peuple avant de s’en servir , Les déboires du « printemps de Damas »,
rubrique Moyen-Orient,
rubrique Rencontre, Antoine Sfeir, Gilles Kepel : « La politique française arabe est difficile à décrypter
rubrique Livre Repère sur la guerre dans la bande de Gaza, La question de Palestine,