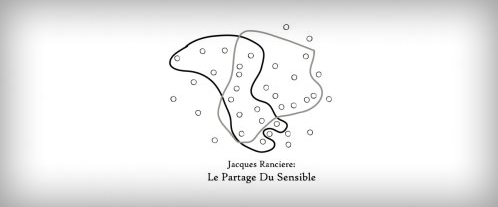Comment un Premier ministre, socialiste, ose-t-il demander : «Où sont les intellectuels ?» et les inciter à «monter au créneau» ? Il eût été plus inspiré si, au lieu de fustiger une prétendue absence de mobilisation politique des intellectuels, il avait appelé à une plus grande mobilisation intellectuelle des hommes politiques. Manuel Valls voulait sans doute dire : «Où puis-je, où les hommes politiques de gauche peuvent-ils trouver les outils théoriques forgés par les intellectuels, susceptibles d’expliquer l’expansion du Front national et de ses idées ?»
Comment un Premier ministre, socialiste, ose-t-il demander : «Où sont les intellectuels ?» et les inciter à «monter au créneau» ? Il eût été plus inspiré si, au lieu de fustiger une prétendue absence de mobilisation politique des intellectuels, il avait appelé à une plus grande mobilisation intellectuelle des hommes politiques. Manuel Valls voulait sans doute dire : «Où puis-je, où les hommes politiques de gauche peuvent-ils trouver les outils théoriques forgés par les intellectuels, susceptibles d’expliquer l’expansion du Front national et de ses idées ?»
Spontanément, on devrait répondre : «Si vous n’avez pas le temps de fréquenter les amphithéâtres, les colloques ou les laboratoires de recherche, allez donc dans une bibliothèque ou simplement dans une librairie, vous les trouverez là, les « intellectuels », sous forme de livres. Vous devrez y passer un peu de temps. Vous en auriez gagné si, il y a quinze ans, vous aviez lu les enquêtes dirigées par Pierre Bourdieu dans la Misère du monde, et entrevu déjà ce sur quoi allaient nécessairement déboucher les nouvelles formes de souffrance sociale. Mais cela ne fait rien. Dans la librairie, prenez d’abord la Pharmacologie du Front national du philosophe Bernard Stiegler, puis piochez au hasard : il y a des dizaines d’ouvrages de philosophie, de science politique, de sociologie, d’histoire, d’économie, expliquant les raisons qui ont fait élargir les bases idéologique et électorale du FN». Les propos du Premier ministre ne traduisent pas même du mépris pour les intellectuels : simplement l’ignorance de leur apport. La question n’est évidemment pas personnelle, et peut-être, après tout, Manuels Valls lit-il le soir Amartya Sen, Bourdieu, Stiegler, ou les analyses de Nonna Mayer (Ces Français qui votent Le Pen). L’essentiel est plutôt que la sphère politique s’est détachée du champ intellectuel, comme elle s’est coupée du social et de «la vie des gens» – devenant ainsi caste. Cette autarcie la condamne à l’assèchement, puisqu’elle ne peut plus se nourrir, pour les traduire en décisions politiques, des revendications venant des citoyens, ni se former théoriquement en faisant trésor du travail des intellectuels. Dès lors, elle «parle toute seule», parle encore de l’élection présidentielle trois ans après qu’elle a eu lieu et deux ans avant qu’elle n’ait lieu, la seule finalité de la politique étant désormais de conserver aux hommes politiques leurs sièges. A cette fin, la présence constante dans les médias, la formule, le bon mot, la gestion de l’image, le marketing sont bien plus utiles que la collaboration avec les intellectuels ou le travail moléculaire sur le territoire (que seuls les Témoins de Jéhovah font encore et, justement, en imitant la pratique du Parti communiste, le FN).
Dans ce monde de coups médiatiques et de buzz – régi par la vitesse et la sommation à la simplification, où le discours qui fait mouche prévaut sur le discours qui dit vrai, et où même un Eric Zemmour apparaît comme un «intellectuel» – les hommes politiques ne peuvent rencontrer que des intellectuels médiatiques, c’est-à-dire des intellectuels qui ont pratiqué vis-à-vis de la recherche et du travail théorique la même coupure que celle que la politique (politicienne) a faite avec le politique (gestion de la vie en commun). Cela a des effets délétères. Ne se sentant plus représentés par ceux qu’il a députés au gouvernement de la cité (qu’il soit national ou régional), les citoyens (on n’ose plus dire le peuple) s’«abstiennent», n’attendant plus rien de la classe politique. Se développe alors un discours «populiste» qui, sur l’air de «tous pourris !» ou «tous incapables !» (de réduire les inégalités, alléger les souffrances et la précarité engendrées par le Marché), condamne en bloc une caste qui ne travaillerait qu’à sa propre reproduction et au maintien de ses privilèges.
Le Front national a su habilement «accueillir» ce discours, et le ré-injecter dans l’opinion, créant ainsi une sorte d’effet de miroir dont le résultat est que les «gens», (sans croire du tout à l’efficience du programme de gouvernement «bleu marine», surtout économique), se «reconnaissent» dans le FN et votent pour lui. L’autre conséquence tient à ce que la classe politique ait coupé le lien organique qui l’attachait au monde intellectuel (lien qui jadis était tissé par la forme parti, aujourd’hui en déliquescence). Outre, évidemment, le triomphe du néocapitalisme, la crise interminable qu’a provoquée la financiarisation de l’économie, l’élargissement inédit de l’arc des inégalités, le chômage endémique, c’est cette coupure qui a participé à ce que l’on nommera, faute de mieux, la «défaite des idées de gauche» – lesquelles, il n’y a pas si longtemps, étaient encore culturellement dominantes.
Il suffit de rappeler que presque toute la culture française, de la chanson aux œuvres cinématographiques, de la sociologie aux travaux des «nouveaux historiens», de la science politique à la philosophie (qui grâce à une conjonction exceptionnelle connaissait, depuis Sartre, sa plus belle saison, avec Jankélévitch, Lévi-Strauss, Althusser, Levinas, Ricœur, Foucault, Derrida, Lyotard, Deleuze, Balibar, Rancière, Badiou, Nancy…), participait d’une «conception du monde» correspondant à des idéaux et des valeurs de gauche : critique du libéralisme, droits de l’homme, réflexion sur un «commun» où la liberté n’exclurait pas la justice, bannissement des discriminations, ethniques, religieuses, sexuelles, extension des droits à toute personne, quel que soit le genre de vie qu’elle se choisit dans ce qui est légalement permis, respect de la foi privée et critique de la religion, responsabilité devant autrui (se souvient-t-on de ce «Visage» qui, chez Levinas, est «ce qui interdit de tuer» ?), hospitalité, «politiques de l’amitié», multiculturalisme, citoyenneté, laïcité, transformation du racisme en délit, etc.
«Où sont les intellectuels ? Où est la gauche ?» se demande Valls. Où sont, devrait-on rétorquer, les hommes politiques de gauche, qui ont protégé ces valeurs, les ont transformées en «mesures», inscrites dans leur programme, introduites dans les institutions, réalisées ? Vaines questions, certes, adressées à une gauche au pouvoir qui n’a pas hésité à se trahir et à effectuer un «tournant néolibéral», qui a abandonné le terrain de la bataille des idées, laissant ainsi se «faner» celles, de gauche, qui circulaient dans la société et qui étaient devenues ce que Gramsci appelle le «bon sens». Quand elle n’était pas encore au pouvoir, elle s’est prise au piège que lui ont tendu Nicolas Sarkozy et Henri Guaino en promouvant sans aucune nécessité mais avec un beau génie stratégique le débat sur l’«identité nationale», qui doit être considéré comme le point de départ de la diffusion «publicitaire» des idées du FN. C’est à partir de là, en effet, que «les langues se sont déliées», que les discours identitaires, les discours d’exclusion, les propos racistes, les affrontements communautaires ont fait florès et se sont «dédouanés», devenant des «opinions comme les autres», que même des candidats à des élections peuvent afficher sur leur page Facebook.
Il se peut qu’il y ait à l’avenir un «sursaut républicain» et que la gauche ne perde pas tous les scrutins futurs. Ce n’est pas grave de toute façon. Le pire, la gauche politique l’a déjà fait : elle a égaré et fait perdre le monde intellectuel. Il lui reste à gouverner «à l’émotion», à en appeler non à la raison ni aux «Lumières», mais à la peur. Ce qui n’assure pas la victoire, face à des partis dont la spécialité est de parler directement au ventre – là où se love la «bête immonde» dont parlait Brecht.
Robert MAGGIORI Journaliste à Libération
Source : Libération 19/03/2015
Voir aussi : Rubrique Rencontre Jean Ziegler, Tzvetan Todorov, Michela Marzano, Jacques Broda, Jean-Claude Milner, rubrique Philosophie, Judith Butler, Daniel Bensaïd,