 Les fêtes de fin d’année sont souvent l’occasion de retrouvailles familiales. Un moment sympa… à condition qu’il ne dure pas trop longtemps.
Les fêtes de fin d’année sont souvent l’occasion de retrouvailles familiales. Un moment sympa… à condition qu’il ne dure pas trop longtemps.
Qui dit fêtes de fin d’année, dit famille… Et réveillon de Noël. Un huis-clos au potentiel explosif où quelques mots, un geste ou une intonation peuvent parfois suffire à transformer ces retrouvailles pleines de promesses en véritable barnum.
« La Bûche », « Conte de Noël », « Festen »… Le cinéma se nourrit amplement de ces raouts intimes où petits secrets et rancœurs (re)surgissent au grand jour. Car les réunions et repas de famille (Noël, en tête), comme le décrit l’humoriste Nora Hamzawi, c’est aussi ça :
« Hier, j’ai eu droit au traditionnel repas du dimanche chez ma mère, c’était super, on était trop contents de se retrouver. Et, hop, trois heures plus tard, comme par magie, plus personne pouvait se blairer. »
Et vous, combien de temps s’écoule-t-il avant que l’euphorie de retrouver vos proches ne s’essouffle et laisse place à de l’agacement, voire de l’exaspération ?
Trois jours, grand max’
Pour Léa*, c’est trois jours max’. « Une théorie basée sur une longue expérience », plaisante la jeune femme de 32 ans. Chaque année pour fêter Noël, celle qui vit à Paris depuis dix ans fait le déplacement chez ses parents, en Picardie. Oncles et tantes, grands-parents, cousins de cinq à 45 ans… Ils seront une quinzaine autour de la table.
Pour « éviter le craquage », elle a « calibré » son séjour à trois jours « pile ». Un « temps raisonnable » permettant aussi à sa mère, qui voudrait la voir plus, de ne pas se dire qu’elle « passe en coup de vent ». Pourtant, ses parents sont « plutôt cools ». La trentenaire explique :
« Pendant les trois premiers jours, les parents sont tellement contents qu’on soit là qu’ils laissent passer plein de trucs. Et c’est pareil pour nous. On s’aime bien parce qu’on ne s’est pas vus depuis longtemps.
Au-delà de cette « période bénie » ? Ça se complique.
« Très vite, tu es obligée de te réacclimater à leurs règles, alors que le reste de l’année tu as tes propres habitudes. Ça reste tes parents : c’est toi qui t’adaptes, et non l’inverse. »
Quand elle sort fumer, il n’est pas rare que la jeune femme écope d’un regard de désapprobation, voire d’un « tu pues la clope ». Idem quand elle traîne sous la couette.
« S’il m’arrive de dormir jusqu’à 11 heures ma mère commence à faire du bruit pour me faire comprendre qu’il est temps de profiter de la famille. »
Respecter le rythme de la maisonnée, justifier son mode de vie…. « Il y a aussi un décalage entre les grandes villes (surtout Paris) et la province », analyse Léa. « On me demande pourquoi je n’ai pas d’enfant, pourquoi je ne suis pas casée’ ni propriétaire de mon logement, contrairement à la plupart des trentenaires ici… » L’été dernier, la jeune femme a outrepassé « la règle des trois jours », voulant s’offrir une petite semaine de repos. Force est de constater que ce n’était pas « le meilleur endroit ».
« Ma mère m’a fait une crise parce que j’avais fait une griffure sur l’aspirateur en l’utilisant. J’avais le sentiment d’avoir encore 15 ans…
Rapports de place…
Pour bien comprendre se qui se joue quand on se retrouve en famille, la psycho-sociologue Dominique Picard rappelle que « les relations humaines se situent dans ce qu’on appelle des rapports de place ».
« Lorsqu’on est avec les autres, on n’a pas une position fixe mais une certaine place par rapport à celle des autres. Quand vous êtes avec votre ami, votre patron ou votre mère, vous n’êtes pas exactement la même personne qu’avec votre voisin de palier ou votre frère.
Or, dans une famille, il y a des rapports de places très anciens et chargés affectivement. Et chaque fois qu’on est ensemble, on retrouve ces schémas-là, qu’on le veuille ou non. »
Pourquoi ces rapports, tels qu’on les a connus dans l’enfance, reviennent-ils inévitablement ?
« Parce que les premiers que nous avons vécus forment une sorte d’empreinte – comme un patron de couture – sur laquelle se créent les schémas relationnels futurs. Et ils sont chargés d’émotions aussi bien positives que négatives, donc nous avons du mal à les contrôler. »
Journaliste, Agathe* s’est elle aussi fixé trois jours « grand max' ». Il y a quelques années, la jeune adulte trouvait « plutôt cool » l’idée de passer du temps avec sa sœur chez leurs parents. Elle est donc arrivée la « fleur au fusil » dans leur village « au milieu de nulle part ». Mais « il s’est passé deux trucs », se souvient-elle.
Son père lui a d’abord fait une « blague » sur son poids. « En mode, j’étais trop grosse », rapporte-t-elle. La remarque ne passe pas pour Agathe, un peu moins fine que sa sœur ou son frère – qui l’appelait d’ailleurs « jambonneau sur pattes » lorsqu’elle était ado. Devenue depuis mère d’un petit garçon, cette trentenaire raconte :
« J’étais vexée. Je suis adulte : ça m’a gonflée d’être ramenée à cet état d’enfant, de bébé, dont on surveille la courbe de poids. »
Mais c’est une phrase anodine qui a précipité son retour à Paris. Agathe avait laissé traîner son bel appareil photo sur une commode, la lanière tombant dans le vide. Plutôt « du genre à faire gaffe aux affaires », son père lui fait remarquer : « Attention ! C’est un coup à le faire tomber ».
« Je l’ai regardé et j’ai pété un câble. J’ai fait mes bagages et je suis partie en stop jusqu’à la grande ville. Je me suis sentie libre, je reprenais le contrôle de ma vie. »
Et vieux réflexes…
Que ce soit quelques heures à peine ou plusieurs jours, on finit souvent par s’agacer les uns les autres, s’épuiser voire se disputer… Malgré tout l’amour que l’on se porte. Auteure du Que-sais-je ? « Les conflits relationnels« , Dominique Picard explique :
« Au fond, le monde est comme un théâtre : on joue une représentation et on se prépare en coulisses pour celle-ci. Ensuite, comme celle-ci a demandé des efforts, on a besoin de se reposer. »
Cette métaphore, c’est le sociologue canadien Erving Goffman qui l’a conceptualisée dans son ouvrage « La mise en scène de la vie quotidienne ». La psycho-sociologue poursuit :
« Plus la représentation est longue et compliquée, plus elle demande d’investissement. Or, plus elle dure, plus elle est fatigante et difficile à tenir : les vieux réflexes reviennent. »
Est-ce qu’on ne placerait pas aussi la barre un peu trop haut pour ces retrouvailles familiales ? De ce point de vue, la fête de Noël, ses cadeaux, son dîner interminable et fréquemment (trop) alcoolisé – « rillettes, pâté, coup de rouge, poulet froid, coup de rouge, coup de rouge », disait Pierre Desproges au sujet du réveillon –, offrent un terrain de jeu parfaitement glissant.
« Il y a autour de Noël une idéologie sociétale extrêmement forte qui veut que la fête se passe bien, dans la bonne entente et le plaisir d’être ensemble. Mais on arrive après avoir couru les magasins, subi les embouteillages… On est, sinon tendu, au moins excité. Tout comme la personne qui nous reçoit et qui s’est affairée à tout préparer », commente Dominique Picard.
Autant dire qu’on est déjà à bout de course avant que les trois coups de la grande représentation familiale ne sonnent. Et qu’il suffit que notre frère ou sœur reçoive un cadeau que l’on juge plus beau pour qu’une jalousie de l’enfance ressorte, explique la psycho-sociologue. Certes, nous sommes adultes, mais « c’est toujours le chouchou », pensera-t-on.
« On ouvre le gaz et chacun a une allumette »
Issu d’une famille où la « chamaillerie facile » a longtemps eu cours, Julien résume la situation :
« On ouvre le gaz et chacun a une allumette. Qui va craquer la première ? »
Pour éviter les clashs entre frères et sœurs, certains sujets sont à peine abordés : l’éducation des enfants, les niveaux de vie de chacun…
Des vacances tous ensemble ? « Jamais », éclate-t-il de rire à l’autre bout du fil. Pour Noël, le temps du réveillon s’avère suffisant. « A la maison, on s’apprécie tous. Mais, pendant longtemps, je m’effondrais en pleurs en rentrant chez moi », raconte cet homme de 36 ans, dont le père est décédé 15 ans plus tôt.
« Durant une décennie, ça a été lourd. On avait l’impression que tout le monde en voulait à l’autre, comme si on s’interdisait de s’aimer ou d’être heureux ensemble. »
Du fait de la pression sociale que l’on intègre, quand ça se passe mal, « l’écart ressenti est d’autant plus fort à Noël », dit Dominique Picard.
Depuis que les sœurs de Julien ont eu des enfants, la vie a repris le dessus, l’ambiance s’est allégée au pied du sapin. Cette année, les festivités auront lieu chez lui et son compagnon, ça le rassure. Il n’empêche :
« Ça me paraît toujours long. A minuit, quand la bûche sera servie, je n’aurai qu’une envie : que tout le monde rentre chez soi.
Entre « plaisir et obligation »
Louis*, lui, est parti de la capitale mardi dernier pour se rendre chez ses parents, en Bretagne. C’est la deuxième fois en cinq mois. Lorsque son père est venu le chercher à la gare, le premier truc qu’il lui a demandé, c’est si sa mère avait appelé. Le couple venait de se disputer. Le jeune homme de 28 ans nous écrit :
« En montant dans la voiture, je me suis dit, la semaine va être longue. On a acheté un faux sapin, car avec le poële à bois, on a peur que ça prenne feu.
– Tu es content ?
– Oui, maman, c’est l’apothéose. »
A peine est-il arrivé qu’elle souhaite lui parler. Louis décrit une famille où l’on discute peu « de nous, des sujets sensibles, un peu personnels ».
« Et là, ma mère me confie qu’elle veut être incinérée dans un cercueil en carton. »
Quand il évoque ses parents, âgés de 65 et 70 ans, la tendresse de Louis déborde. Il les voit vieillir, s’attacher désormais à de petits rituels, de nouvelles habitudes. Ne plus rentrer de balade la nuit. Ne pas dîner après 19h30. Tout ce changement a parfois quelque chose d’un peu étouffant.
Alors ces séjours chez les parents, le jeune homme les vit « entre plaisir et obligation » : « Quand j’arrive, je me sens toujours un peu oppressé. Puis, je me détends au fur et à mesure », développe-t-il. Car ce Parisien travaillant beaucoup trouve aussi « agréable d’être chez papa-maman, de se mettre les pieds sous la table » et d’entretenir le lien.
Mais il en convient, « faut pas que ce soit trop ». Sa durée maximale ? « Au-delà d’une semaine, c’est plus possible. »
Maria*, elle, a carrément décidé de ne pas faire le déplacement pour les fêtes. « C’était devenu une vraie contrainte », confie cette quadragénaire, issue d’une famille traditionnelle. Cette CSP+ installée dans le Sud Ouest se justifie :
« On m’a toujours reproché de ne pas m’être mariée, de ne pas avoir eu d’enfant, d’avoir tout donné à ma carrière professionnelle. »
Il y a quelques années, cette Espagnole résidant en France depuis 23 ans pouvait « tenir » jusqu’à quatre ou cinq jours chez ses parents ou ses frères qui vivent en Catalogne. Mais à chaque visite, ça ne loupait pas. Un jour qu’elle joue avec ses neveux, sa mère lui lâche :
« T’as qu’à faire le tien, comme ça tu laisseras tranquille ceux des autres. »
Maria estime que les fêtes de fin d’année doivent rester un temps joyeux. Pour le réveillon, elle retrouvera donc une dizaine d’amis et leurs enfants. Chacun amènera un plat. « Quelque chose de simple », dit-elle entre douceur et impatience.
Source Rue 89 24/12/2017


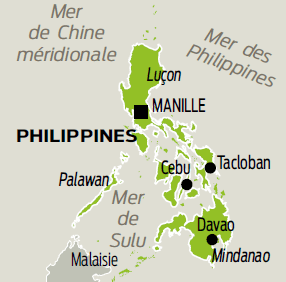 Population : 103 millions
Population : 103 millions
