Le système éducatif a connu des transformations très profondes ces trente dernières années, en lien notamment avec les politiques visant à mener 80 % d’une classe d’âge au niveau du baccalauréat mais aussi avec les transformations du système productif. Les promesses de démocratisation scolaire ont fait long feu. Non seulement la majorité des enfants appartenant aux classes populaires continue d’être orientée, au sortir du collège, vers l’enseignement professionnel, mais ces réformes n’ont en rien remis en cause la division entre filières générales et professionnelles, renforçant au contraire la domination symbolique des premières sur les secondes.
L’enseignement professionnel constitue ainsi un cas privilégié pour étudier l’évolution de l’emprise des hiérarchies scolaires, ainsi que les modalités selon lesquelles les jeunes d’origine populaire s’approprient leurs destins scolaires et sociaux. Comment s’opèrent leur orientation scolaire et leur socialisation aux rôles subalternes qu’ils seront amenés à jouer dans la division sociale du travail ? Comment s’y prennent-ils pour aménager leur condition présente ? Quels clivages internes aux classes populaires l’étude de l’enseignement professionnel permet-elle de révéler ?
Recensé : Ugo Palheta, La domination scolaire, sociologie de l’enseignement professionnel et de son public, Le lien social, PUF, Paris, 2012. 374 p., 27 €.
« La difficulté, lorsqu’on tente d’expliquer pourquoi les enfants de bourgeois obtiennent des boulots de bourgeois, est de savoir pourquoi les autres les laissent faire. La difficulté, lorsque l’on tente d’expliquer pourquoi les enfants de la classe ouvrière obtiennent des boulots d’ouvriers, est de savoir pourquoi ils se laissent faire. » Posées en exergue de l’ouvrage, ces deux phrases du sociologue britannique Paul Willis, plantent le décor théorique et politique des questions que se pose aujourd’hui Ugo Palheta à propos de l’enseignement professionnel en France. Plaçant son étude sous l’égide de la domination, il rappelle à bon droit que ce sont bien des conflits et des concurrences entre groupes sociaux qui se jouent au sein de l’enceinte scolaire, des rapports de force et de sens, qui relèvent de la lutte de classes. Fût-elle symbolique, la domination scolaire reste une forme de violence dont l’exercice ne va pas sans rencontrer des obstacles ou des résistances. Les plus dominés du champ scolaire ne se laissent pas nécessairement imposer l’image d’eux-mêmes que tend à leur assigner le fonctionnement ordinaire de cette grande gare de triage qu’est devenue l’école. L’enjeu final est bien la place qu’on occupera dans la hiérarchie sociale ainsi que le sens que cette place donnera à son existence tout au long de la vie.
Pris en étau entre le champ scolaire et le champ économique, l’enseignement professionnel dispose d’une faible autonomie. L’essentiel de son recrutement est le résultat d’une orientation négative : les élèves qu’il accueille sont là parce qu’on les a jugés incapables de suivre l’enseignement long débouchant sur des baccalauréats, généraux ou technologiques. La sélection scolaire est, aujourd’hui comme hier, une sélection sociale. Ces filières recrutent des élèves majoritairement issus des classes populaires. L’analyse minutieuse de trois cohortes d’élèves respectivement entrés en sixième en 1980, 1989 et 1995 met cruellement en évidence le caractère implacable et constant de cette sélection. Les données sont bonnes et la méthode statistique retenue pour les exploiter est la meilleure possible parce qu’elle neutralise les effets de structure et permet des comparaisons au fil du temps : Le tableau est accablant. Le collège divise et divise durablement. L’étanchéité des ordres d’enseignement tend même à croitre d’un panel à l’autre. La proportion d’élèves orientés dans l’enseignement professionnel court accédant après un Cap ou un Bep aux filières technologiques ou générales au niveau de la seconde ne cesse de diminuer au fil des ans.
Le constat objectif ainsi établi, la question est alors d’identifier les sens qu’attribuent à ces filières, lycée professionnel ou apprentissage, celles et ceux qui les fréquentent. D’analyser le sens que prennent pour les élèves concernés les contraintes sociales et scolaires qu’ils subissent, mais aussi de repérer les tactiques qui leur permettent d’infléchir ces contraintes. Si, vue d’en haut, c’est-à-dire, du point de vue de la logique de fonctionnement du système scolaire, leur présence en ces lieux est bel et bien le produit d’une sélection par l’échec, il s’en faut de beaucoup que tous les élèves adhèrent à cette vision négative d’une relégation. La réalité est plus complexe, elle est aussi contradictoire.
La tradition est longue des sociologues qui depuis les années 60 ont étudié de près ce segment du système scolaire français : Claude Grignon, Lucie Tanguy, Catherine Agulhon, Guy Brucy, Vincent Troger, Henri Eckert, Gilles Moreau aujourd’hui [1] et beaucoup d’autres encore. Leurs travaux, parfaitement connus de l’auteur, sont mobilisés à bon escient pour mesurer des évolutions ou des constantes, apporter des éclairages nouveaux ou complémentaires à l’analyse menée par l’auteur. Cet appel permanent au savoir accumulé par d’autres depuis un demi-siècle confère au livre le statut d’une véritable somme et démontre à qui en douterait encore le caractère cumulatif des connaissances produites dans le cadre de la sociologie des systèmes d’enseignements au sens le plus large du terme. D’autant qu’Ugo Palheta traite dans le même ouvrage des deux branches de l’enseignement professionnel, celle des lycées et celle de l’apprentissage, qui font souvent l’objet d’études séparées. Les envisager ensemble, en soulignant leurs différences et leurs points communs, constitue un apport majeur à l’analyse. Cette dimension historique et comparative présente aussi le grand intérêt de mettre en lumière une transformation majeure des filières de l’enseignement professionnel. Ce dernier a longtemps été structuré par les objectifs qui lui ont été assignés au sortir de la seconde guerre mondiale par les trois acteurs principaux qui ont présidé à sa mise en place, État, organisations ouvrières et patronat : la formation des ouvriers. La désindustrialisation de notre pays, l’effondrement de la classe ouvrière en tant qu’acteur majeur sur la scène politique et syndicale, la montée du tertiaire ont profondément changé l’esprit de cet enseignement tout en le désorganisant. Les débouchés ouvriers qu’assurait l’industrie à cette filière d’enseignement, la socialisation progressive au monde ouvrier et à ses valeurs qu’assurait la présence dans les lycées professionnels d’anciens ouvriers devenus professeurs, ont progressivement disparu du paysage. L’enseignement professionnel s’est ainsi vu arracher l’épine dorsale qui lui donnait son unité et sa cohérence. Il s’est morcelé et segmenté.
Ces mécanismes de différenciation sociale et scolaire des différentes filières professionnelles au début des années 2000 font l’objet d’une analyse fine et percutante. La population issue d’une première sélection à l’issue du collège se révèle, elle aussi, fortement divisée. L’apprentissage d’un côté, les lycées professionnels de l’autre, mais au sein de ces derniers des spécialités qui diffèrent fortement par leur recrutement et les possibilités d’insertion sur le marché du travail. Le niveau général des qualifications s’est élevé mais la structure des écarts entre spécialités s’est maintenue et parfois même creusée. Métiers du bâtiment et de l’alimentation recrutent en apprentissage les garçons qui sont le moins souvent à l’heure à l’entrée en sixième. Ceux de l’électricité et de l’électronique, de la mécanique de l’administration et de la distribution recrutent en revanche, en lycée professionnel, les garçons qui accusent le moins de retard à l’entrée en sixième. Un clivage du même ordre s’observe chez les filles. Les plus en retard d’entre elles entrent en apprentissage dans les services aux collectivités et dans l’hôtellerie-restaurants, les moins en retard dans des lycées professionnels formant aux métiers du secrétariat, de la comptabilité, de soins à la personne et du sanitaire et social. Le niveau scolaire n’ayant cessé de s’élever au cours des trente dernières années, les titulaires d’un Cap ou d’un Bep sont aujourd’hui concurrencés pour les emplois industriels qualifiés par les titulaires de bacs pros et, à un moindre degré, par les BTS.
On comprend alors pourquoi et comment les sens attribués par les élèves concernés aux formations qu’ils suivent sont aussi divers et contradictoires. Il convient, pour les identifier, de se frayer un chemin étroit entre les deux écueils qui menacent une telle démarche : l’hypothèse d’un consentement des élèves à la conscience de leur relégation qui se traduirait par un sentiment d’échec permanent ; mais aussi, écueil inverse, la mise en œuvre par les élèves de stratégies conscientes de résistance aux valeurs et aux règles de fonctionnement du système scolaire, par exemple la manifestation d’une culture anti-école structurée. Loin de succomber aux tentations de ces deux sirènes, Ugo Palheta maintient un cap exigeant en s’appuyant sur plusieurs enquêtes qu’il a menées lui-même auprès de plusieurs catégories d’élèves. C’est la partie la plus originale de l’ouvrage et l’analyse est menée de main de maître.
Se défiant d’une analyse menée, au nom de la relégation, en termes de manques, d’absences et de déficits, l’auteur prend aussi grand soin de ne pas céder à l’illusion d’une homogénéité des classes populaires. Enquêtant par entretiens parmi des élèves suivant une formation de niveau Bep aux « métiers de la production mécanique informatisée » (MPMI), puis chez des apprentis du bâtiment, et enfin auprès d’élèves suivant des formations administratives, Ugo Palheta élabore progressivement l’hypothèse d’une homologie entre l’espace des filières professionnelles et l’espace des habitus populaires. Une fraction non négligeable des jeunes issus des classes populaires se démarquent nettement d’une idéologie du salut social par le mérite scolaire, sans pour autant la contester en tant que telle. De sorte qu’il est préférable de substituer au concept de stratégie celui, plus modeste, de tactique, comme nous y invite Michel de Certeau [2]. Ce concept est plus adapté aux faibles marges de manœuvre laissées par le caractère implacable de l’orientation aux enfants d’origine populaire se retrouvant dans l’une des filières de l’enseignement professionnel. Ils sont ainsi condamnés à jouer sur le terrain de l’adversaire et selon les règles fixées par l’adversaire. Mais ils jouent. Ils peuvent profiter des occasions pour tirer des avantages de leur situation. Leurs marges de liberté ne sont pas nulles. Cette analyse est très convaincante. Elle renouvelle par beaucoup d’aspects la sociologie des classes populaires en ouvrant une voie escarpée mais originale entre le misérabilisme dominant (les classes populaires se définiraient uniquement par des manques et des carences) et l’idéologie d’une contre-culture structurée qui se manifesterait par des résistances organisées à l’inculcation scolaire entendue comme l’imposition de la culture bourgeoise
La dernière partie du livre est consacrée à la façon dont s’articulent les rapports de classe, de genre et de race dans l’enseignement professionnel. Les rapports de domination entre garçons et filles, Blancs et non-Blancs (terminologie discutable mais dûment justifiée dans une note) s’y reproduisent ici comme ailleurs au profit des garçons et des enfants autochtones, mais sous des formes singulières du fait qu’il s’agit déjà d’une filière d’enseignement dominée. Largement dominés dans l’ensemble de la société, les filles d’un côté, et les enfants d’immigrés de l’autre partagent, dans l’enseignement professionnel, un trait qui les distingue fortement des garçons et des « Blancs ». Ils, elle s’orientent — ou sont orienté-e-s — très majoritairement vers des filières tertiaires qui conduisent à des emplois situés dans l’administration ou les services. Cette orientation est souvent vécue comme un moyen d’échapper au statut d’ouvrier et aux pénibilités physiques associées à la condition ouvrière, (les taux de chômage y sont d’ailleurs plus faibles), mais aussi de pouvoir rejoindre, à plus ou moins brève échéance, la filière longue de l’enseignement général. C’est-à-dire de redevenir des élèves « normaux ».
Il s’en faut pourtant de beaucoup que les filles et les enfants d’immigrés aient destins liés, à taux de chômage ou de sous-emploi égal. Soucieux de mettre à distance le stigmate attaché au travail manuel que leurs pères ont vécu sous la forme la plus éprouvante physiquement, les élèves originaires du Maghreb et de l’Afrique sub-saharienne s’engagent vers des filières aux débouchés professionnels plus incertains que leurs camarades autochtones qui visent à exercer des métiers de l’industrie ou de l’artisanat. Lorsqu’ils ne trouvent pas de travail, ils vivent d’autant plus douloureusement la contradiction entre la triste réalité et l’espoir d’une ascension sociale inhérente au fait de suivre des matières plus générales et intellectuelles. Pour les filles, la déception est toujours moindre du fait que, chez les garçons comme chez les filles fréquentant l’enseignement professionnel, le stéréotypes de genre sont profondément intériorisés. Il est normal et naturel que les garçons réussissent mieux que les filles !!!!
Au total, un livre très riche, longuement médité, qui repose sur une base de données considérable. Il ajoute une pierre nouvelle à un édifice qui a commencé à s’édifier dans les années 70. Mais, ce faisant, c’est tout l’édifice qu’il reconstruit dès lors qu’il se place du point de vue du ou des sens que les élèves donnent à leur parcours. Une exigence théorique forte l’anime de bout en bout qui permet de déborder les frontières d’une stricte sociologie de l’enseignement professionnel. Ce dernier a toujours constitué un objet de réflexion particulièrement fécond pour les sociologues parce que situé à mi-chemin entre le monde scolaire et celui de l’entreprise, il informe sur les deux mondes et surtout, sur les conflits de classe qui s’y jouent. La prise en compte de la dimension historique est ici particulièrement éclairante. Les deux mondes ont connu des bouleversements considérables, mais leurs relations se sont peu modifiées. Les rapports de classe ont la peau dure.
Un oubli regrettable
par Vincent Troger
Ce compte-rendu élogieux souligne à juste titre la qualité du travail de Palheta, tant du point de vue méthodologique que du point de vue de l’appareil théorique. L’analyse très fine des hiérarchies internes de l’enseignement professionnel, et donc des mécanismes de distinction qui clivent ses publics en fonction des spécialités plus ou moins scolairement et socialement rentables qu’ils réussissent à investir est notamment tout à fait pertinente.
 Il est cependant regrettable que Palheta ne se réfère jamais, ni au fil de son texte, ni dans sa bibliographie, au travail antérieur d’Aziz Jellab, publié en 2008 aux presses universitaires du Mirail et intitulé Sociologie de l’enseignement professionnel. Même si le livre de Jellab ne s’inscrit pas aussi rigoureusement que celui de Palheta dans l’héritage de la sociologie de la reproduction, il n’en est pas moins tout à fait sérieux. Il s’appuie sur un mise en perspective historique tout aussi complète que celle de Palheta, et surtout il met déjà bien en évidence les clivages internes propres au public des LP, notamment en termes de stéréotypes de genre, ce qui constitue un des passages forts du livre de Palheta.
Il est cependant regrettable que Palheta ne se réfère jamais, ni au fil de son texte, ni dans sa bibliographie, au travail antérieur d’Aziz Jellab, publié en 2008 aux presses universitaires du Mirail et intitulé Sociologie de l’enseignement professionnel. Même si le livre de Jellab ne s’inscrit pas aussi rigoureusement que celui de Palheta dans l’héritage de la sociologie de la reproduction, il n’en est pas moins tout à fait sérieux. Il s’appuie sur un mise en perspective historique tout aussi complète que celle de Palheta, et surtout il met déjà bien en évidence les clivages internes propres au public des LP, notamment en termes de stéréotypes de genre, ce qui constitue un des passages forts du livre de Palheta.
On peut sans doute objecter à Jellab un corpus statistique et un appareil théorique moins puissant que celui de Palheta, mais cela ne justifie en rien une occultation aussi totale d’un travail tout à fait respectable, qui offre des pistes d’interprétation sans doute en partie différentes, mais également pertinentes. Compte tenu de l’exhaustivité de la bibliographie mobilisée par Ugo Palheta, il est difficile d’imaginer qu’il ait pu ignorer le travail d’Aziz Jellab.
Vincent Troger est maître de conférences, IUFM de l’université de Nantes.
Voir aussi : Rubrique Livre, Essais, rubrique Education, Politique de l’éducation, rubrique Science humaines,
 L’objet de votre ouvrage réhabilite la pensée libertaire de Camus Pourquoi a-t-elle été sous-estimée ?
L’objet de votre ouvrage réhabilite la pensée libertaire de Camus Pourquoi a-t-elle été sous-estimée ?
![boris_cyrulnik_leader[1]](http://jmdinh.net/wp-content/uploads/2013/09/boris_cyrulnik_leader1.jpg)


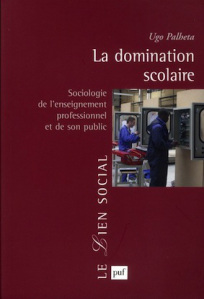
 Il est cependant regrettable que Palheta ne se réfère jamais, ni au fil de son texte, ni dans sa bibliographie, au travail antérieur d’Aziz Jellab, publié en 2008 aux presses universitaires du Mirail et intitulé Sociologie de l’enseignement professionnel. Même si le livre de Jellab ne s’inscrit pas aussi rigoureusement que celui de Palheta dans l’héritage de la sociologie de la reproduction, il n’en est pas moins tout à fait sérieux. Il s’appuie sur un mise en perspective historique tout aussi complète que celle de Palheta, et surtout il met déjà bien en évidence les clivages internes propres au public des LP, notamment en termes de stéréotypes de genre, ce qui constitue un des passages forts du livre de Palheta.
Il est cependant regrettable que Palheta ne se réfère jamais, ni au fil de son texte, ni dans sa bibliographie, au travail antérieur d’Aziz Jellab, publié en 2008 aux presses universitaires du Mirail et intitulé Sociologie de l’enseignement professionnel. Même si le livre de Jellab ne s’inscrit pas aussi rigoureusement que celui de Palheta dans l’héritage de la sociologie de la reproduction, il n’en est pas moins tout à fait sérieux. Il s’appuie sur un mise en perspective historique tout aussi complète que celle de Palheta, et surtout il met déjà bien en évidence les clivages internes propres au public des LP, notamment en termes de stéréotypes de genre, ce qui constitue un des passages forts du livre de Palheta.