 Pour l’idéologie ultra-libérale dominante, ce sont les dépenses publiques qui seraient responsables de la dette, passant sous silence la place prépondérante des marchés financiers. Décryptage…
Pour l’idéologie ultra-libérale dominante, ce sont les dépenses publiques qui seraient responsables de la dette, passant sous silence la place prépondérante des marchés financiers. Décryptage…
Tout le monde s’accorde à reconnaître la place prépondérante qu’ont pris les « marchés financiers » dans nos économies.
Cependant, la place inconsidérée prise par les puissances d’argent n’est pas le fruit d’une volonté divine. Elle est la conséquence de décisions politiques prises dans les années 1970. C’est ainsi qu’en 1973, le statut de la Banque de France a été modifié. Ce changement consistait à interdire à la Banque de France de financer l’Etat à un taux d’intérêt nul, disposition qui existait jusque là. Dorénavant, les finances publiques devaient chercher des ressources auprès des banques privées
La France ruinée par les exigences de la Finance
Résultat : depuis 1974, la France a payé en intérêts 1200 milliards d’euros (à comparer avec les 1641 milliards de dette publique actuelle). C’est depuis cette date que les budgets connaissent des déséquilibres. Si l’on y ajoute l’incidence de la baisse des recettes publiques due aux baisses d’impôts – 100 milliards d’euros en 10 ans selon un rapport parlementaire – et les exonérations de cotisations sociales (30 milliards d’euros par an), on ne peut s’étonner de la montée de la dette. Pour mesurer la baisse des rentrées fiscales, il est nécessaire de comparer la part des recettes de l’Etat par rapport au PIB. Celles-ci ont culminé à 22,5% du PIB en 1982, elles n’étaient plus que 15,1% en 2009.
Dans un rapport de mai 2010, Jean-Philippe Cotis, directeur de l’INSEE et Paul Champsaur, président de l’Autorité de la statistique publique, estimaient que sans les multiples baisses de prélèvements consenties par les gouvernements successifs depuis le début des années 2000, le niveau de la dette publique serait inférieur de 20 points du PIB à ce qu’il est aujourd’hui soit la bagatelle de 400 milliards d’Euros !
Récemment, la Cour des Comptes a mis le doigt sur l’explosion des « niches fiscales ». A partir de 2004, ces dernières ont connu une progression incontrôlée pour atteindre 73 milliards d’euros en 2009. Parmi elles, la niche « Copé » qui exonère d’impôts les plus values provenant des cessations des filiales détenues au moins depuis deux ans par la maison mère. Son coût : 22 milliards d’euros entre 2007 et 2009.
La Cour des comptes a mis le doigt sur le régime de l’ « intégration fiscale » qui consiste pour la société mère de décider du périmètre fiscal en y intégrant les résultats de ses filiales. Ce dispositif aurait coûté à l’Etat près de 20 milliards en 2009. Autrement dit, le gouvernement prétend s’en prendre à quelques niches fiscales mais ne comptabilisent plus comme telles des cadeaux royaux fait aux patrons et qui coûtent plusieurs milliards d’euros aux finances publiques.
La prise de pouvoir des marchés a permis aux grandes entreprises d’imposer des taux de rendement des capitaux s’élevant à 15, voire 25%. Ces exigences de profitabilité inhibent fortement l’investissement, qui se tourne vers les placements juteux.
La dette privée transfigurée en dette publique
D’autre part, ces exigences ont entraîné une constante pression à la baisses sur les salaires avec une consommation en panne et une hausse du chômage, avec comme conséquences une croissance en berne. Cette demande insuffisante a été contrecarrée par le développement de l’endettement des ménages, créant ainsi une richesse fictive, permettant une croissance de la consommation sans augmentation de salaires. Ce qui a entraîné une bulle financière se terminant par des krachs (voir la crise des subprimes).
Volant alors au secours des banques, les gouvernements ont métamorphosé une dette privée en dette publique. C’est ainsi qu’en 2007, avant la crise, le déficit public moyen dans la zone euro était de 0,6% du PIB, mais la crise l’a fait passer à 7% en 2010. Quant à la dette publique elle est passée dans la même période de 66 à 84 % du PIB. Ainsi, la mainmise des marchés financiers s’est imposée en plusieurs actes.
Acte I : Les pouvoirs décrètent la liberté totale de circulation des capitaux.
Acte II : des réglementations plus laxistes en matière d’impôts pour les sociétés et les couches aisées entraînent un assèchement des budgets des Etats et une liquidité importante entre les mains des possesseurs de capitaux.
Acte III : Une somme énorme de capitaux sont ainsi disponibles et peuvent ainsi financer les dettes avec des taux d’intérêts rémunérateurs.
Acte IV : devant les déficits publics qui grimpent, les Etats imposent à leurs peuples des sacrifices. Ces politique d’austérité doivent être inscrites, telles les tables de la lois dans la Constitution. Cette règle d’or dépossède les peuples de leur légitime souveraineté.
La morale de l’histoire est claire : nos maux ne parviennent pas d’une dépense publique dispendieuse. Par rapport au PIB (richesses créées), celles-ci ont baissé. Elles représentaient 55% en 1993 et 53% en 2008. La place prépondérante prise par les marchés financiers doit être remise en cause. il faut les désarmer. Pour cela il appartient aux peuples d’écrire le dernier acte.
Acte V et fin : les peuples reprennent le pouvoir sur les marchés financiers. Ils s’émancipent d’eux en retrouvant au niveau national et européen la maîtrise publique de la finance et du crédit, en taxant les banques et les profits financiers, en changeant le rôle et la mission de la Banque centrale européenne, en relevant les salaires, en développant les services publics,.
La France pourrait agir au sien de l’Europe pour remplacer le fonds européen de stabilité financière qui soutient les marchés par un fonds européen de soutien au développement social. Il s’agit de créer un pôle public bancaire avec un crédit sélectif favorable aux investissements porteurs d’emplois, de salaires, de formation et de recherche.
On le voit, il s’agit de mettre en oeuvre une autre politique. Celle qui consiste à reprendre le pouvoir à la Finance.
Henri Génard (La Marseillaise)
Voir aussi : Rubrique Politique, La « règle d’Or », ou les rois de l’esbroufe, rubrique Economie, Pifomètre, rubrique UE, Extension du domaine de la régression, La crise de la zone euro, mode d’emploi, Les dirigeants de gauche valets des conservateurs, rubrique Finance, Comment l’injustice fiscale a creusé la dette greque, Livre : Susan Georges de l’évaporation à la régulation, Aux éditions la Découverte La monnaie et ses mécanismes, Les taux de change,




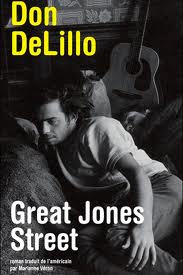 Great Jones Street n’est pas plus un livre rock qu’Americana* serait une histoire de l’Amérique. Scalpel en main l’auteur américain coupe sa matière en tranches. Il se tape le boulot du légiste, et le cadavre parle, découvrant les excroissances d’une civilisation en mal de revival. Au passage DeLillo restitue le climat dans lequel s’inscrit l’hallucinante histoire de la pop culture américaine. « Tout le monde connaît l’histoire du nombre infini de singe, dit Fenig. On place un nombre infini de singes devant une machine à écrire, et à la longue, l’un d’entre eux reproduira une grande œuvre littéraire. » Près de 40 ans plus tard Don DeLillo est devenu l’auteur incontournable de la littérature postmoderne. Mais cela n’a rien d’un coup de dé.
Great Jones Street n’est pas plus un livre rock qu’Americana* serait une histoire de l’Amérique. Scalpel en main l’auteur américain coupe sa matière en tranches. Il se tape le boulot du légiste, et le cadavre parle, découvrant les excroissances d’une civilisation en mal de revival. Au passage DeLillo restitue le climat dans lequel s’inscrit l’hallucinante histoire de la pop culture américaine. « Tout le monde connaît l’histoire du nombre infini de singe, dit Fenig. On place un nombre infini de singes devant une machine à écrire, et à la longue, l’un d’entre eux reproduira une grande œuvre littéraire. » Près de 40 ans plus tard Don DeLillo est devenu l’auteur incontournable de la littérature postmoderne. Mais cela n’a rien d’un coup de dé.