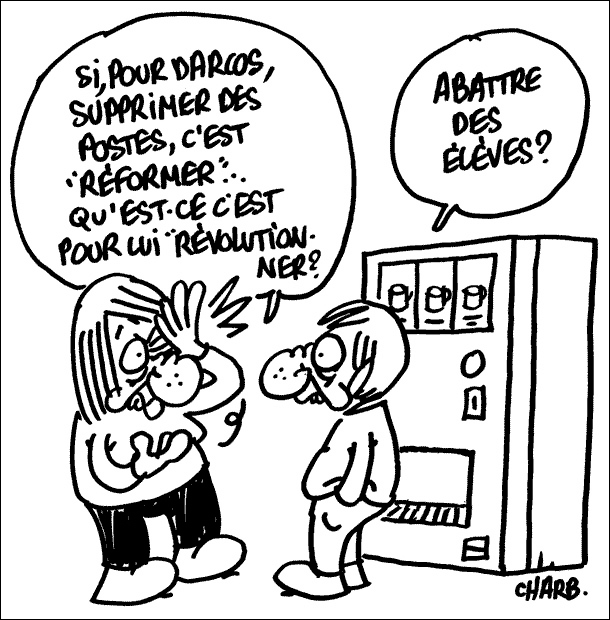C’est le tube de l’été des discothèques politiques. Du président de la République au moindre responsable de la majorité, tous reprennent en choeur, matin, midi et soir, le refrain de « La règle d’or ».
Le 26 juillet, Nicolas Sarkozy a donné le ton en écrivant à tous les parlementaires : « La France doit être exemplaire dans la remise en ordre de ses comptes publics. Nous avons besoin de nous rassembler sur ces questions essentielles, au-delà des intérêts partisans. » Mieux, depuis le sommet franco-allemand de l’Elysée, le 16 août, ce sont les dix-sept pays de la zone euro qui sont invités à adopter, d’ici à l’été 2012, une « règle d’or » pour équilibrer leurs finances.
Hier encore, le premier ministre a remis ça d’une voix solennelle, dans Le Figaro : pour mettre un terme à « la gestion trop complaisante » de nos finances publiques, il faut inscrire dans la Constitution une règle « d’équilibre des finances publiques » qui impose une vertueuse discipline aux budgets annuels du pays. Et François Fillon d’invoquer « l’intérêt national » et d’appeler les socialistes au « sens des responsabilités ».
Sans les socialistes, en effet, pas de « règle d’or ». Le projet de loi constitutionnel adopté par l’Assemblée nationale et le Sénat en juillet restera lettre morte s’il n’est pas validé par les trois cinquièmes des parlementaires réunis en Congrès à Versailles. De deux choses l’une, martèle donc la majorité : ou bien la gauche apporte son soutien à l’initiative lucide et courageuse du chef de l’Etat ; ou bien elle fait la déplorable démonstration de son laxisme et de son irresponsabilité. Comme on dit familièrement, plus c’est gros, plus ça a des chances de marcher !
Car il faut à la majorité actuelle un culot exceptionnel pour jouer, subitement, les professeurs de vertu budgétaire. Les chiffres sont impitoyables. En 2007, la dette de la France représentait 63,8 % du PIB ; elle dépassera 86 % en 2011. Soit pas loin de 500 milliards d’euros supplémentaires en quarante-huit mois, et une dette globale dont la seule charge des intérêts absorbe la quasi-totalité de l’impôt sur le revenu.
La faute à la crise, plaide le gouvernement depuis 2008. En partie, oui. Mais mineure, comme le souligne la Cour des comptes, dans son rapport, fin juin, sur la situation des finances publiques : « La crise explique, au plus, 38 % du déficit, qui est surtout de nature structurelle et résulte largement de mesures discrétionnaires. »
C’est une façon pudique de qualifier les avantages fiscaux – les fameuses « niches » – consentis ces dernières années : par exemple, la suppression de la taxe professionnelle, qui représente pour l’Etat un manque à gagner de 7,9 milliards, la baisse de la TVA dans la restauration (2,5 milliards), la réforme récente de l’impôt sur la fortune (pas loin de 2 milliards), ou encore la « niche Copé » (habilement transformée en modalité particulière de calcul de l’impôt sur les sociétés), qui coûte de 4 à 6 milliards par an. Soit, depuis quatre ans, de l’ordre de 22 milliards de « cadeaux » fiscaux, entièrement financés par l’emprunt !
Mais le chef de l’Etat et son premier ministre ne sont pas seulement formidablement culottés. Ils sont également les rois de l’esbroufe. On serait prêt à croire qu’en bons chrétiens, ils ont admis leurs fautes passées et sont décidés à les expier : il faudrait pour cela que la « règle d’or » brandie comme un talisman impose vraiment une discipline rigoureuse.
Or le plus extraordinaire est qu’il n’en est rien. Pour le comprendre, le plus simple est de citer l’article voté par le Parlement : « Les lois-cadres d’équilibre des finances publiques déterminent, pour au moins trois années, les orientations pluriannuelles, les normes d’évolution et les règles de gestion des finances publiques, en vue d’assurer l’équilibre des comptes des administrations publiques. Elles fixent, pour chaque année, un plafond de dépenses et un minimum de mesures nouvelles afférentes aux recettes qui s’imposent globalement aux lois de finances et aux lois de financement de la Sécurité sociale ».
Cette rédaction alambiquée en atteste : contrairement à la loi fondamentale allemande, qui est supposée servir de modèle, la « règle d’or » ne fixe aucune contrainte rigoureuse, adossée par exemple à la notion de solde budgétaire.
Au-delà de cette définition déjà très floue, toutes les modalités d’application de ces nouvelles lois-cadres sont renvoyées à une loi organique. Ainsi, elles pourraient être « modifiées en cours d’exécution ». Comment ? Par la loi organique. Quelles dispositions précises s’imposeraient aux lois de finances et aux lois de financement de la Sécurité sociale ? Encore la loi organique. Comment seraient compensés d’éventuels écarts entre les lois-cadres et l’exécution budgétaire ? Toujours la loi organique. Le gouvernement en a-t-il précisé le contenu ? A aucun moment, malgré deux lectures dans chaque Assemblée.
Or les parlementaires savent bien que ce qu’une loi organique peut faire, une autre peut le défaire, comme on l’a vu avec la Caisse d’amortissement de la dette sociale, destinée à accueillir les déficits de la Sécurité sociale. En 2005, ils avaient fixé à 2021, de façon impérative, le terme de la durée de vie de la Cades pour stopper le report sans fin des déficits. Cinq ans plus tard, les dérives perdurant, ils ont tout simplement reporté à 2025 le terme de la Cades…
Enfin, il va sans dire que, même si la réforme constitutionnelle était, par miracle, adoptée rapidement, elle ne pourrait être mise en oeuvre avant le budget 2013… donc après l’élection présidentielle. C’est au point que l’on se demande si le gouvernement ne fait pas tout ce cirque sur la « règle d’or » pour mieux se dispenser d’en appliquer dès maintenant les vertueux principes. Il est à craindre que cela ne trompe personne, les marchés moins que quiconque.
Gérard Courtois (Le Monde)