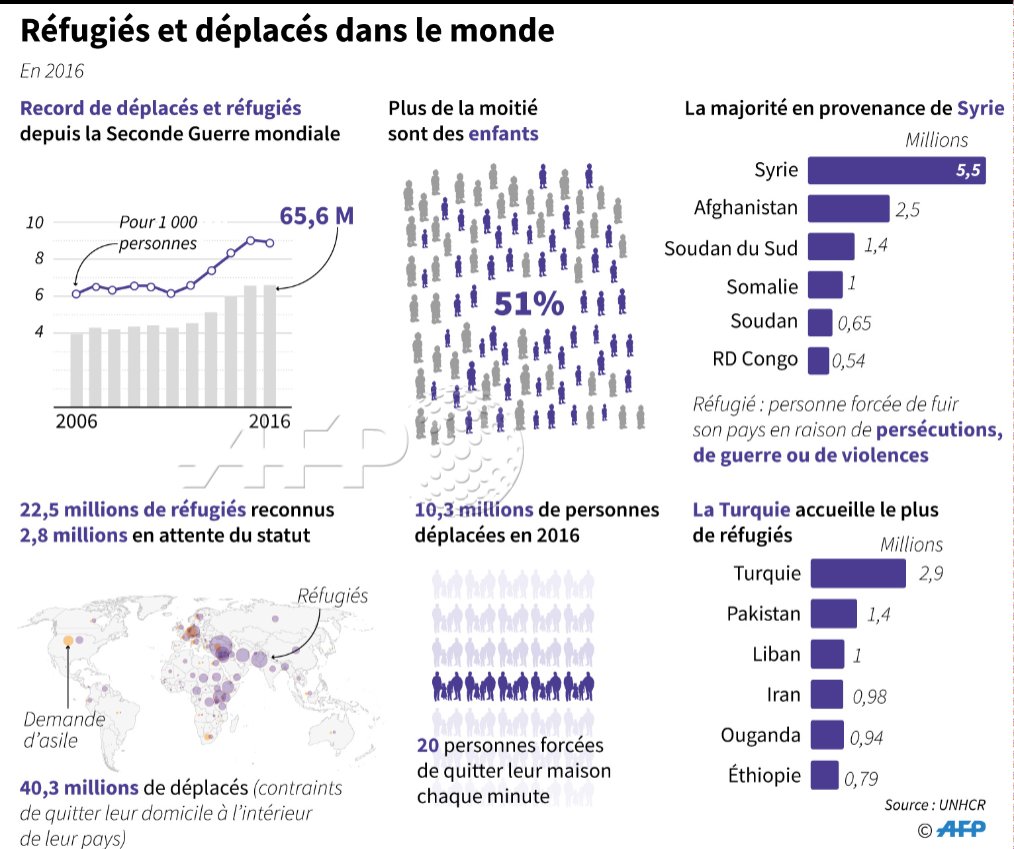Les peuples veulent la chute des régimes
Nous, qui avons connu la révolution syrienne, sur place et en exil, nous sommes réjouies d’assister au soulèvement du peuple français. Nous sommes, par contre, interpellés par les “mesures de sécurité” et de “maintien de l’ordre” exercés contre les Gilets Jaunes dans ce pays dit des “droits de l’homme”. Pourtant, nous n’étions pas dupes de la vitrine démocratique de la république française, nous souhaitons seulement faire constater que c’est l’État lui-même qui est en train de la briser.
Le nombre hallucinant d’interpellations qui a eu lieu ces dernières semaines, les motifs et jugements en comparutions immédiates qui visent les personnes du fait de leurs convictions politiques sans qu’il n’y ait de preuves de délit, les appels à l’intervention de l’armée, les arrestations préventives, les vidéos de la répression policière qu’on voit partout en France, la propagande gouvernementale et médiatique et ses tentatives ridicules pour apaiser la situation, tout ça nous renvoie à ce que nous avons vécu lors du déclenchement de la révolution syrienne.
La violence des forces de l’ordre françaises est, bien entendu, encore loin des balles réelles du régime syrien. Cependant, nous le comprenons comme une marque de prudence plutôt que comme un manque de volonté d’intensifier les moyens employés. Dans les déclarations et comportements du président, des policiers et bien souvent des médias, nous reconnaissons la réaction d’un régime prêt à garder son pouvoir coute que coute.
La scène de rafle à Mantes-La-Jolie nous a donné des frissons. A nous syriens, ca nous rappelle les élèves à Daraa, en 2011, qui à cause de tags (“ton tour arrive docteur” et “liberté”) sur les murs de leur école ont été interpellés, et pour certains, ont eu les ongles arrachés. Les deux scènes, bien que différentes par l’ampleur de la violence, attestent de la même aptitude des gouvernements contestés à humilier celles et ceux qui le déstabilisent. La révolution en Syrie s’est de facto déclenchée après le refus du maire de Deraa de libérer les enfants détenus avec comme réponse : ’Oubliez vos enfants, vos femmes vous en donneront d’autres. Sinon, amenez-nous vos femmes. On le fera pour vous.’
Mais revenons en arrière ; la place de la Contrescarpe le 1re Mai dernier. Car là, c’était quelque chose dont nous pensions avoir l’exclusivité. Des Benallas on en a plein ! Nous les appelons shabiha ; les milices du régime, un peu comme la BAC, sauf qu’ils ne sont ni l’armée ni la police, mais des bandes en civil. En plus des pillages et des confiscations encouragées par le régime auparavant, pendant la révolution les shabiha se sont surtout spécialisés dans le matraquage, la torture, et le meurtre de manifestants qu’ils soient armés ou non.
À vrai dire, le tashbih est devenu une manière de normaliser la violence du régime, de la rendre patriotique. C’est tout un dispositif discursif et matériel qui s’est ainsi étendu au fur et à mesure aux personnes non liées au gouvernement mais qui sont toutefois décidées à défendre le régime jusqu’au bout. Le commentaire (d’un policier ? d’un civil ?) qu’on entend dans le vidéo du rafle à Mantes-la-jolie : “Voilà une classe qui se tient sage”, est un exemple du tashbih par excellence. Au fond, toute répression est sadique.
Certes, la répression ne se manifeste pas de la même manière ici – il y a plusieurs manières de dominer une population. Dans le cas français aujourd’hui, les miettes que ce régime accepte de concéder à contrecoeur ne sont que des prétextes auprès de l’opinion pour mieux justifier les coups portés à celles et ceux qui ne veulent toujours pas rentrer chez eux.
Il y a quelques années, on avait félicité les peuples arabes de s’être révoltés. Le printemps arabe était cette belle surprise car enfin, ils n’acceptaient plus d’être soumis au joug de la dictature. Quant au peuple français qui aurait, soi-disant, la liberté d’expression et de rassemblement et qui peut voter dans des elections “libres” (bien que mise en scène par les riches, leur argent et leurs médias), il se soulèverait pour des “enjeux sociaux”, comme disent les experts et les spécialistes. Pour leur répondre, il faut rappeler que les gens en Syrie ne se sont pas soulevés que pour utiliser leur cartes électorales ou écrire des articles d’opinion dans un journal. Il s’agissait de dignité. Nous nous sommes donc soulevés contre la dictature en Syrie. Aujourd’hui en France, nous côtoyons des manifestants qui luttent pour une meilleure répartition des richesses et contre une minorité qui abuse du pouvoir. Nous ne pouvons pas rester neutres. La dignité est à arracher ici comme ailleurs.
Alors, on nous parle de radicalisation. Ce que nous voyons : c’est d’un côté, une violence contre des choses, des vitrines de magasins de luxe, des banques. Des choses bien (in)signifiantes. En face, c’est une violence contre des personnes, une violence, qui, pour défendre ces “choses” met des vies en péril. L’État, lui il tue. Partout et pas seulement dans des pays comme le nôtre.
Le vocabulaire nous est très familier. Vos casseurs et perturbateurs sont nos “malfaiteurs” “agitateurs”, vos ultra-gauche et extrême droite sont nos “infiltrés” et “agents extérieurs”. Le régime syrien a créé tout un lexique. Or, le gommage de la colère et de la contestation, en les disqualifiant, en les rendant étrangères – et ainsi extrémistes – nous montre que dès que le pouvoir est remis en question, il se met à parler le même langage. Ne les laissons jamais instaurer la confusion.
Enfin, concernant l’immigration et le racisme, nous avons entendu l’allocution de Macron. Le glissement qu’il a opéré en répondant à “la crise de fiscalité et de représentation” par ce qui serait un “malaise face aux changements de notre société, une laïcité bousculée et des modes de vie qui créent des barrières, de la distance” est grave et dangereux. Ce discours n’est pas différent de celui de Le Pen et d’autres. Il n’est pas nouveau non plus, et se traduit par des effets concrets et systématiques ; enfermement, humiliation, déportation. Pour ceux et celles qui rechignent à rejoindre les Gilets Jaunes, une chose est certaine : c’est d’abord l’état raciste, qu’il faut contrecarrer.
Quant aux propos anti-migrants de certains Gilets Jaunes, le combat est différent. Ici, la rencontre, le dialogue peuvent être une occasion. Un thé sur un rond point, des bavardages sur les barricades, permettent d’enfin parler loin des bouches institutionnelles et gouvernementales, qui sont elles, les vraies barrières. Pour dire que nous pensons que ceux qui privent les français d’une vie digne, ne sont ni les immigrés ni les exilés mais bien l’insolente richesse de certains.
Pour cela, nous appelons les exilés en France à se manifester, à avoir le courage d’assumer notre présence, à ne jamais nous sentir redevables d’un état colonial qui nous aurait accordé par grâce le droit de vivre. Il n’y a plus de non-concernés.
Nous ne voulions pas faire une comparaison. Il nous a semblé, cependant, important de dessiner quelques parallèles. De faire croiser des chemins. Alimentons des circulations révolutionnaires qui vont au-delà de la solidarité unilatérale (souvent blanche bourgeoise humanitaire et charitable). Pour notre part, nous choisissons de mettre nos forces à disposition pour essayer de construire un réel partage d’outils, d’idées et de soucis. Au fond, nous voulons dire – ce qu’on aurait aimé entendre au long ces dernières années – que notre lutte est commune.
La volonté de destitution n’est ni morcelable ni restreinte à l’échelle nationale : on ne peut pas être pour la révolution en Syrie tout en se rangeant du côté de Macron. Le combattre, lui et son monde, est pour nous un pas pour en terminer avec Assad et son enfer.
Il est encore trop tôt pour rentrer chez soi mais il n’est pas trop tard pour en sortir. Il sera toujours l’heure de dégager quelques têtes. Dans tous les cas, les choses ne seront plus comme avant. Les peuples ne veulent plus d’un monde pourri. Mais les renversements des régimes ne suffiront pas, c’est dans la suite ou il nous faut gagner nos batailles… C’est la chute d’un système qui engendre des Macron et des Assad qui nous satisfera.
A très bientôt.
Des révolutionnaires syriens et syriennes en exil.
Source Lundi Matin 14/12/2018