
Le philosophe Henri Pena-Ruiz
Philosophe de la laïcité mais aussi militant progressiste, Henri Pena-Ruiz rappelle quelques fondamentaux. Philosophe, écrivain, professeur, ancien membre de la Commission Stasi pour l’application du principe de laïcité dans la République, Henri Pena-Ruiz répond à nos questions.
La demande d’une journée de la laïcité est portée à droite comme à gauche. Comment se décline le clivage politique sur cette question ?
Cela devrait être une valeur commune à tous les partis puisqu’elle relève de la définition du cadre démocratique qui permet à tous les citoyens de vivre ensemble. En réalité, ce n’est pas toujours ainsi. Le clivage gauche-droite a longtemps été perçu comme partisan et adversaire de la laïcité. C’était vrai du temps d’une droite cléricale, nostalgique d’une monarchie où la religion était instrumentalisée pour justifier les privilèges. Puis la droite s’est ralliée à la laïcité, notamment à l’âge du premier capitalisme où des bourgeois ont mené une lutte anti-cléricale. Au 19e siècle apparaît cependant un couplage de capitalisme et de charité chrétienne pour aider les plus démunis, avec une compensation religieuse dans une au-delà réparateur.
Le mouvement ouvrier s’est aguerri de tout cela, montrant que la question sociale relevait d’une restructuration de l’Etat, d’une république sociale et laïque en attendant la république socialiste. Dans ce cadre, la religion était une affaire privée et il ne devait pas y avoir charité mais solidarité redistributive de l’impôt. Dans ce contexte, le clivage gauche-droite correspondant au anti ou pro-laïcité fonctionnait.
Et aujourd’hui, tout ceci est remis en question ?
C’est en tout cas, plus compliqué. Beaucoup de croyants se sont retrouvés dans l’idéologie de gauche, sans vouloir cantonner le religion à la sphère privée. Cela s’appelle la deuxième gauche, très présente au parti socialiste qui a ainsi inventé le concept de laïcité ouverte, pour désigner le maintien des privilèges publics de la religion. La question s’est alors brouillée notamment sur l’idéal de stricte égalité entre athées et croyants.
Le PCF a, lui, toujours été plus favorable à la laïcité et moins affecté par ce processus. Néanmoins contre l’amalgame entre athéisme militant et laïcité et il y a eu ce qu’on appelle une politique de la main tendue. Or, la laïcité n’est pas hostile à la religion, elle est hostile au privilège public de la religion. Marianne n’est ni croyante, ni athée : elle est neutre. Ceci posé, il faut bien constater qu’il y a plus de laïcité à gauche qu’à droite et qu’il est urgent de faire de cette laïcité et de la justice sociale, deux axes de travail fondamentaux. Car le chef du gouvernement a osé dire dans le discours de Latran que la République avait besoin de croyants. Et dans le monde ultralibéral qui est le nôtre, détruisant les services publics, cassant le code du travail, on voit un retour de ce « supplément d’âme dans un monde sans âme » qu’est la religion pour reprendre la formule de Marx.
N’y a t-il pas derrière cette offensive une dimension européenne. Cette Europe a un fonctionnement clientélisme et lobbyistes. Le communautarisme religieux n’en est-il pas une déclinaison ?
Nous sommes effectivement dans une Europe anti-laïque qui se retrouve dans le traité de Lisbonne. Cela a permis au capitalisme de déguiser une politique entièrement au service de ses intérêts en une construction européenne, de se travestir d’idées humanistes et internationalistes. Ce dévoiement de cette belle idée de dépassement des frontières passe aussi, effectivement, par la reconnaissance aux églises d’un statut de lobby : on les met en position d’interlocuteur privilégié de l’institution. Et ce, même si plusieurs figures coexistent en Europe et que l’idée laïque progresse au niveau des peuples.
Revenons au lien entre religion et capitalisme. Est-ce caricatural de dire que le capitalisme a besoin d’une religion qui, via le destin ou la promesse d’un paradis ultérieur, le sert davantage que la prétention au bonheur ici et maintenant ?
C’est une analyse que je partage. Nous sommes dans une société qui ne soucie plus de justice sociale. Le capitalisme se pense comme seul en scène et a cassé toutes les conquêtes sociales. La défaite des idéaux de gauche a conduit une partie de la gauche à reprendre le vocabulaire de la droite, sur les privatisations, sur l’assistanat ou sur les charges sociales en lieu et place de cotisations patronales… On voit bien que l’ultra capitalisme l’a emporté et que la figure caritative a repris le dessus. Sans oublier l’ambiguïté de la société civile qui déploie tant d’efforts, respectables, pour atténuer les effets mais qui pourtant ne pourra jamais pallier les carences de l’Etat et s’y substituer.
Je pense cependant que le Front de Gauche remet tout cela en question, que cette nouvelle alliance autorise des espoirs de reconstruire ce que Jaurès appelait la République sociale et laïque, une république qui n’ait plus besoin de ce » supplément d’âme pour un monde sans âme « .
Recueilli par Angélique Schaller (La Marseillaise)
Voir aussi : : Rubrique Religion, La question religieuse dans l’espace social, rubrique Politique, Sarkozy le discours de Latran, Aubry s’étonne, Laïcité République histoire de la sainte trinité, La difficile émergence d’un islam de France, rubrique Rencontre, Entretien avec Daniel Bensaïd, Jean Rohou,

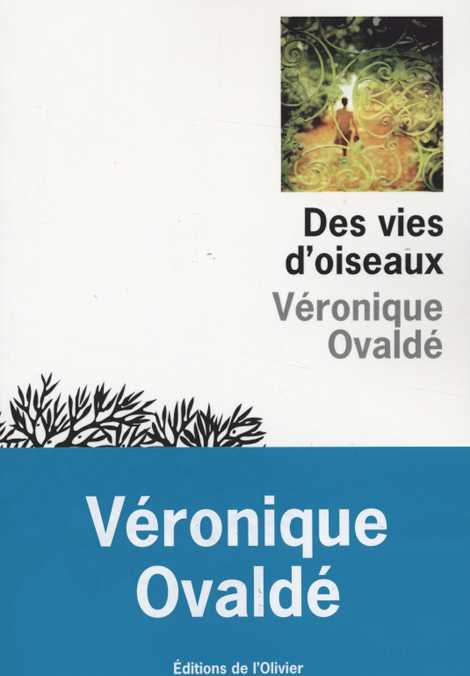 Être à l’affût de l’ordinaire nous permet d’en sortir, pourrait-on se dire en suivant les personnages du dernier roman de Véronique Ovaldé. Dans un pays imaginaire d’Amérique latine, Vida Izzara part à la recherche de Paloma qui a déserté l’étouffant et confortable nid familial, en compagnie du jeune jardinier Adolpho. Cherchant à s’expliquer le comportement de sa fille, la mère croit déceler chez Paloma une volonté d’échapper au quotidien banal et réducteur offert par la bonne société de Villanueva. L’enquête qu’elle entreprend au côté du rassurant lieutenant Taïbo, éclaire le comportement de sa fille, et pousse Vida à poursuivre sur une voie plus incertaine dont elle n’osait jusqu’ici soupçonner l’existence. Véronique Ovaldé tient ces quatre personnages dans une main, avec l’autre, elle jette les dés de leur destin sur le tapis des inconsolables amoureux de la vie.
Être à l’affût de l’ordinaire nous permet d’en sortir, pourrait-on se dire en suivant les personnages du dernier roman de Véronique Ovaldé. Dans un pays imaginaire d’Amérique latine, Vida Izzara part à la recherche de Paloma qui a déserté l’étouffant et confortable nid familial, en compagnie du jeune jardinier Adolpho. Cherchant à s’expliquer le comportement de sa fille, la mère croit déceler chez Paloma une volonté d’échapper au quotidien banal et réducteur offert par la bonne société de Villanueva. L’enquête qu’elle entreprend au côté du rassurant lieutenant Taïbo, éclaire le comportement de sa fille, et pousse Vida à poursuivre sur une voie plus incertaine dont elle n’osait jusqu’ici soupçonner l’existence. Véronique Ovaldé tient ces quatre personnages dans une main, avec l’autre, elle jette les dés de leur destin sur le tapis des inconsolables amoureux de la vie.![CHALANDON2©RobertoFrankenberg2[2]_0](http://jmdinh.net/wp-content/uploads/2011/11/CHALANDON2©RobertoFrankenberg22_0-300x200.jpg)


 Sans les armes, l’IRA ne serait pas parvenu à se faire entendre. Ils disent : « Dieu nous a fait cathos, les flingues nous ont rendu égaux ». C’était aussi une piqûre de rappel à nos portes au moment où nous manifestions contre l’apartheid. Je ne voulais pas éluder tout cela parce que mon personnage était fait de ça, de cet isolement, de cette impossibilité.
Sans les armes, l’IRA ne serait pas parvenu à se faire entendre. Ils disent : « Dieu nous a fait cathos, les flingues nous ont rendu égaux ». C’était aussi une piqûre de rappel à nos portes au moment où nous manifestions contre l’apartheid. Je ne voulais pas éluder tout cela parce que mon personnage était fait de ça, de cet isolement, de cette impossibilité.

