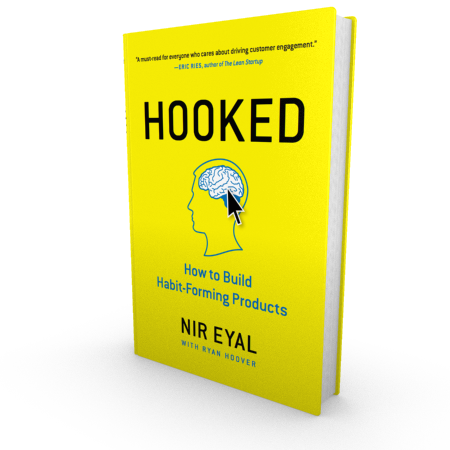Beaucoup de médecins pensent que l’addiction à Internet n’existe pas. Pourtant dans la vie quotidienne, nous sommes nombreux à parler de nos téléphones comme de cuillères de crack.
« Il est complètement accro à Tinder », « j’essaie de décrocher un peu », « quand j’ai pas mon téléphone, je suis super nerveux », « je checke mes mails toutes les 5 minutes ».
Face à ça, nous nous flagellons : trop faibles, trop nuls, trop dispersés, trop déconcentrés : nous nous reprochons sans cesse de nous faire dévorer par nos téléphones. Pourtant, si nous nous sentons dépendants de certaines applis, c’est parce que des gens ont travaillé très dur pour nous y rendre accros.
Designers, chercheurs en architecture réseau, informaticiens, entrepreneurs… dans la Silicon Valley et ailleurs, ils cherchent à inventer des produits dont nous ne pourrons pas nous passer. En exploitant nos faiblesses bien humaines.
Plongée dans une des bibles de « l’addiction par design », pour comprendre d’un peu plus près les mécanismes qui nous enchaînent à nos écrans.
Le labo des technologies persuasives
C’est à l’université de Stanford, au cœur de la Silicon Valley, qu’on trouve un des lieux centraux de la fabrication de l’addiction par les technologies.
C’est un laboratoire de recherche, appelé le Persuasive Technology Lab. Son fondateur, B J Fogg, a inventé dans les années 1990 la « captologie » : l’étude des ordinateurs et des technologies numériques comme outils de persuasion.
Le fondateur d’Instagram, une des applis les plus addictives et l’une des plus grandes réussites de ces dernières années, est passé par ces cours, tout comme plusieurs designers et psychologues aujourd’hui haut placés chez Facebook.
Un ancien élève ayant tourné casaque, Tristan Harris, ancien « philosophe produit » chez Google dénonçant maintenant les « heures volées à la vie des gens », nous décrivait ainsi ce qui y était fait :
« Ma dernière année à Stanford j’ai choisi le cours pour devenir membre du laboratoire de persuasion technologique de Stanford. Qui était assez connu en fait pour enseigner aux étudiants comment entrer dans la psychologie des gens, et rendre les produits plus persuasifs et efficaces.
“ Persuasifs ”, ça semble bizarre comme mot dans ce contexte, mais ça veut dire : comment tu conçois un formulaire pour que les gens le finissent ? Si tu veux que quelqu’un ouvre un mail, comment tu le fabriques pour que ça soit le cas ?
On a appris toutes ces techniques, qui ressemblent à celles des magiciens. (…) J’ai vu sous mes yeux cette connexion entre les étudiants qui s’entrainaient à toutes ces stratégies et ces entreprises, qui utilisent ces principes tout le temps. Parce que c’est la clé du succès économique, faire en sorte que les gens passent le plus de temps possible sur leurs services. »
Et pour ça, il faut les rendre accros.
« Hooked »
« Les technologies qu’on utilise sont devenues des compulsions, quand ce n’est pas des addictions à part entière. Le réflexe de vérifier si on a un nouveau message.
Le désir d’aller sur YouTube, Facebook ou Twitter, juste quelques minutes, pour se retrouver une heure plus tard toujours en train de faire défiler l’écran ou de taper dessus.
Cette urgence que vous ressentez probablement toute la journée, sans nécessairement la remarquer. »
Celui qui écrit ça est un ancien élève du Persuasive Tech Lab. Il s’appelle Nir Eyal, il est « blogueur et consultant », invité chez Instagram ou LinkedIn, et il assume complètement le discours de l’addiction :
« Les innovateurs créent des produits conçus pour persuader les gens de faire ce que nous voulons qu’ils fassent. Nous appelons ces gens des “ usagers ” et même si nous ne le disons pas à voix haute, nous rêvons secrètement de les voir tous jusqu’au dernier, complètement accros à ce que nous fabriquons. »
Après des années passées dans l’industrie, des armes faites dans les mondes du jeu social en ligne et de la pub (deux mondes qui en connaissent un rayon en matière de fabrication de l’addiction) et, dit-il, des heures d’entretiens et d’observations, il a distillé ce qu’il a appris de la formation des addictions dans un livre.
Les 4 étapes de l’addiction
Le livre « Hooked » a une couverture jaune vif. On y voit le dessin d’une tête d’homme, vide. Un pointeur de souris est dirigé vers le cerveau.
Le sous-titre est explicite : « comment créer des produits addictifs » (en anglais le mot est « habit-forming », mais les dictionnaires sont formels : le mot relève du champ de l’addiction).
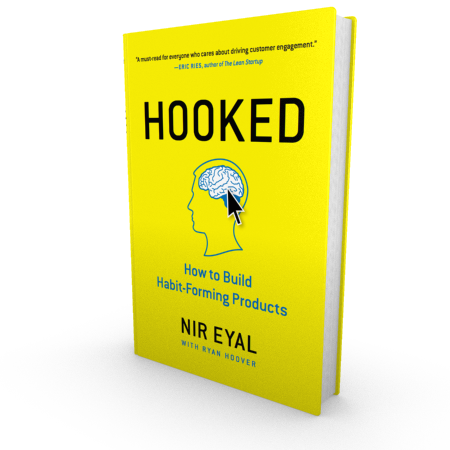
La couverture de « Hooked »
Alors comment fait-on ? C’est très simple, dit-il. Il faut créer des « hooks » : des façons d’accrocher les utilisateurs, suffisamment efficaces pour qu’ils ne décrochent plus jamais.
Le but ultime : que votre produit entre complètement dans les habitudes de l’usager, qu’il n’y pense même plus, qu’il se tourne vers lui sans même y penser, et qu’il s’y abîme sans réaliser que le temps passe.
Pour une appli, c’est le jackpot.
1 Trouver les bons « déclencheurs »
Ce qui va vous faire vibrer, vous émouvoir
Aujourd’hui, annonce Eyal,
« les entreprises doivent comprendre non seulement ce qui fait cliquer leurs usagers, mais aussi ce qui les fait vibrer. »
Le hook commence par un stimulus. Il faut que quelque chose donne envie aux usagers d’utiliser votre produit.
En version simple, ce sera un bouton « Cliquez ici », « S’inscrire », une notification qui provoquera chez l’usager une action.
Mais le Graal c’est le déclencheur interne : un sentiment, une émotion, quelque chose en l’usager, dans sa psyché même – un « itch », une « démangeaison », écrit Eyal, quelque chose qui le dérange, qui le gêne.
On l’a compris, pour ça les émotions négatives servent plus volontiers de déclencheur interne : ennui, tristesse, peur du rejet, frustration… Si un service soulage cette démangeaison (en proposant une distraction, par exemple), alors BANCO : l’usager va associer le service et la recherche de soulagement.
Et comme nous sommes des êtres d’habitude, une fois que nous associons un produit à une sensation, il y a de fortes chances que nous répétions encore et encore le processus. Comme le dit Evan Williams, fondateur de Twitter :
« Internet, c’est une machine géante conçue pour donner aux gens ce qu’ils veulent. (…) On pense souvent qu’Internet permet aux gens de faire des choses nouvelles. Mais les gens veulent juste continuer à faire ce qu’ils ont toujours fait. »
Le lien entre un déclencheur interne (exemple : la peur du temps qui passe) et une réaction (prendre une photo et la poster sur Instagram) va progressivement se renforcer, se sédimenter – « comme les couches de nacre qui se déposent dans une huître » écrit Eyal –, et devenir une habitude, quelque chose de subconscient plus jamais questionné.
C’est alors que l’entreprise aura réussi à établir son « monopole sur l’esprit » : être la réponse instinctive à un sentiment.
Comme aujourd’hui on va sur Google quand on se pose une question. Ou sur Amazon quand on cherche un livre ou un DVD. Sur Twitter ouTinder quand on s’ennuie, sur Facebook quand on se sent seul.
Pas trop de mystère ici : c’est ce qu’on va vous pousser à faire. Vous inscrire sur Facebook, vous abonner sur Twitter, faire des recherches sur Google, faire défiler sur Pinterest, swiper sur Tinder…
Mais la règle d’or, c’est que ces actions doivent être simples et ne pas demander beaucoup d’efforts de la part des usagers.
3 Une récompense variable
Si vous voulez que votre utilisateur revienne encore et encore, il faut lui donner une récompense – qu’il ne vienne pas pour rien.
Mais il ne faut pas lui donner toujours la même chose. Si l’issue de l’action est toujours la même, l’utilisateur se lassera. Mais s’il s’attend à trouver quelque chose de différent, s’il y a la possibilité du nouveau, vous avez de fortes chances de le faire revenir.
Pour Eyal, c’est la clé. Il faut nous habituer à associer une action et une récompense, mais pas de façon systématique. Savoir qu’il y aura quelque chose mais ignorer quoi : c’est le cœur du « hook. »
Eyal, citant une étude sur le comportement des joueurs pathologiques, déclare :
« En introduisant de la variabilité, on démultiplie l’effet et on crée ainsi un état de concentration, qui met en sommeil les zones du cerveau associées au jugement et à la raison, tout en activant les zones associées au désir et à l’exercice de la volonté. »
En d’autres termes, c’est pour ça, parce que vous attendez quelque chose sans trop savoir quoi, que vous vous trouvez, jugement et raison en sommeil, à zoner sur Facebook pendant des heures sans plus savoir ce que vous étiez venus chercher.
Pour rendre un usager bien, bien accro, il faut le garder sur le long terme. Et pour ça, il faut le « faire un peu travailler » : il faut qu’il investisse quelque chose qui lui donne envie de revenir.
Ce peut être des contenus, des abonnés, des données… L’important c’est qu’il ait le sentiment d’avoir tellement investi que ça ne vaut plus la peine de partir (un fonctionnement qui marche aussi sur les vieux couples dysfonctionnels).
Plus vous achetez de chansons sur iTunes, plus vous allez vouloir garder votre librairie de musique là. Plus vous avez d’abonnés sur Twitter, moins vous voudrez changer de plateforme, même pour aller sur des concurrents objectivement meilleurs.
Plus vous avez passé de temps à bâtir une réputation en ligne, comme sur eBay ou Yelp ou AirBnb, moins vous avez intérêt à en partir.
Plus vous avez galéré à apprendre à vous servir d’un produit (mettons Adobe Photoshop), moins il y a de chances que vous vouliez tout reprendre à zéro avec un autre logiciel.
Et la morale dans tout ça ?
Tout ça, donc, repose sur l’exploitation des faiblesses des gens (ce que certains appellent « le design des vulnérabilités »), et la mise en place de tous petits mécanismes presque invisibles (envoyer une notification au bon moment, vous montrer des posts d’amis pour vous inciter à rester dans la communauté). Ce n’est pas très moral et parfois, Nir Eyal semble s’en apercevoir. Il prend alors un ton moral.
Attention, dit-il en substance, il ne faut pas utiliser ces techniques pour faire le Mal mais faire le Bien. Pour savoir où l’on se situe sur le continuum entre ces deux pôles, il propose une « matrice de la manipulation » pour savoir si on est plutôt un « facilitateur » (un gentil qui manipule les gens certes, mais pour leur bien) ou un « dealer » (un méchant qui leur vend du crack dans le seul but de s’enrichir).
Mais sur le fond, la position de Eyal, comme de beaucoup de behavioristes, c’est que manipuler les comportements n’est pas en soi répréhensible, tout dépend de pourquoi on le fait.
C’est la position défendue par les théoriciens du nudge : un « paternalisme libéral » où l’on pousse sans violence les usagers à prendre les « bonnes décisions » pour eux.
Charte éthique ?
D’autres trouvent ces idées hautement problématiques. C’est le cas d’un repenti du Persuasive Tech Lab, Tristan Harris, qui milite avec l’association qu’il a créée, Time Well Spent (« temps bien dépensé »), pour la création d’un « label » décerné aux technologies soucieuses de ne pas trop manipuler leurs clients.
D’autres designers ont avancé l’idée d’une charte éthique pour leurs utilisateurs. Pour l’instant, ces tentatives sont encore bien loin d’avoir abouti à quoi que ce soit.
Mais l’ouverture du débat a pour immense mérite de nous faire comprendre que quand nous sommes accros à nos téléphones, ce n’est pas parce que nous n’avons aucune volonté. Mais parce que nous sommes alors face à toute une industrie invisible qui travaille à nous déconcentrer et à nous rendre accros.
Et tant qu’il n’y aura pas de changements de fond, il est évident que les forces en présence ne sont pas égales.
Claire Richard
Source l’Obs 04/11/2016
Voir aussi : Rubrique Internet, Rendre aux gens le temps gagné, rubrique Médias, rubrique Lecture rubrique Société, Consommation, Loisir, La télé un produit dangereux pour le foyer,