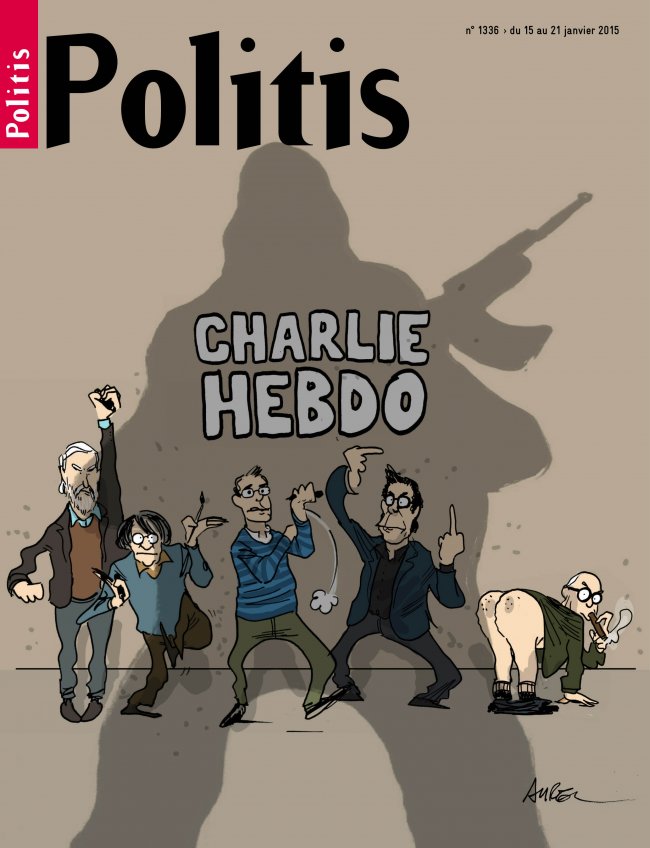Rencontre littéraire. Un débat proposé ce soir à Montpellier par Cœur de Livres autour de l’auteur de Don Quichotte. L’invité Olivier Weber dévoile dans «?Le Barbaresque?» un aspect peu connu de la vie de l’écrivain.
Rencontre littéraire. Un débat proposé ce soir à Montpellier par Cœur de Livres autour de l’auteur de Don Quichotte. L’invité Olivier Weber dévoile dans «?Le Barbaresque?» un aspect peu connu de la vie de l’écrivain.
L’association Coeur de livres initie ce soir, à la salle Pétrarque de Montpellier, un nouveau cycle de rencontres littéraires. Cinq rencontres sont en effet programmées jusqu’à la Comédie du livre en mai qui met cette année à l’honneur les littératures ibériques. Les grands auteurs classiques espagnols – basques, castillans, catalans, galiciens – et portugais seront au coeur des débats. Coeur de livres invite ce soir à 19h l’écrivain et journaliste Olivier Weber, auteur d’une biographie romancée de Miguel de Cervantès (1547-1616).
L’auteur de Don Quichotte de la Mancha, une des œuvres les plus célèbres du patrimoine littéraire mondial, était le fils d’un médecin pauvre soumis aux hasards d’une vie errante. Dans sa jeunesse, Miguel Cervantès mène une vie aventureuse. Il tente d’échapper à sa modeste condition par la carrière des armes. Au service du cardinal Acquaviva, protecteur du royaume d’Espagne, il suit son maître à Rome et parcourt l’Italie. Il assiste à la chute de Nicosie (Chypre) annexé par le sultan ottoman Selim II, participe en 1571 à la bataille de Lépante qui voit la flotte espagnole victorieuse.
Après avoir perdu l’usage de sa main gauche au combat, Cervantès s’embarque pour l’Espagne en 1575 mais sa galère est attaquée par les Turcs. Fait prisonnier, il est amené en captivité à Alger. Il y restera cinq ans. Malgré plusieurs tentatives d’évasion, il ne sera racheté qu’à la fin de 1580.
Roman biographique
C’est précisément cette période qui sert de toile de fond historique au roman d’Olivier Weber Le Barbaresque* dont l’action débute en 1575. L’auteur décrit avec saveur la captivité de Cervantès à Alger en rendant compte du climat cosmopolite et inter-religieux qui régnait alors dans ce royaume de la piraterie. En tant que prisonnier de marque, l’homme de la chrétienté bénéficie d’un traitement de faveur. Guidé par une incontrôlable pulsion amoureuse pour Zorha, la fille du puissant Hadji qui règne sur la ville, Cervantès s’engage dans une mission périlleuse entre chrétiens et mahométans.
Au coeur du siècle d’Or espagnol, la vie de Cervantès se prête au roman. Olivier Weber évoquera ce soir la puissance imaginaire que dégage le personnage. De retour à Madrid après sa captivité à Alger, l’aventurier tentera de vivre de sa plume sans grand succès. Il participe à l’attaque espagnole contre l’Angleterre mais le désastre de l’invincible armada met fin à ses fonctions. En 1589, accusé d’exactions, Cervantès est arrêté et excommunié. Il sera à nouveau incarcéré à plusieurs reprises pour abus de bien sociaux et une affaire d’assassinat dont il sera reconnu innocent. Une vie émaillée de telles aventures fournit une riche réserve de matière littéraire que Cervantès croise avec l’observation de la vie quotidienne dont il tire des ressources tout aussi inépuisables.
En 1605, la publication de la première partie de Don Quichotte rencontre un immense succès. Cervantès peut désormais se consacrer à la littérature et ne cessera de publier. L’auteur faisait grand cas de son oeuvre théâtrale. Dans le prologue Des huit comédies, il indique avoir écrit trente pièces dont la plupart ont disparu. En 1614 paraît Voyage au Parnasse, poème en tercet qui livre une bataille allégorique aux mauvais poètes. Ce n’est qu’en 1616 que Cervantès publie la seconde partie de son oeuvre majeure sans se douter qu’il avait créé le roman moderne.
Jean-Marie Dinh
Olivier Weber, Le Barbaresque, édition Flammarion 2011
 Olivier Weber, un homme engagé
Olivier Weber, un homme engagé
Né en 1958, Olivier Weber, est un écrivain, grand reporter titulaire du Prix Albert Londres (1992) et correspondant de guerre français. Maître de conférences à l’Institut d’études politiques de Paris, président du Prix Joseph-Kessel, membre du Festival international du film des droits de l’homme, il a été nommé ambassadeur de France itinérant, chargé de la lutte contre la traite des êtres humains. Olivier Weber est aussi scénariste. Il présentait hier au cinéma Utopia son documentaire La Fièvre de l’Or qui montre comment l’or peut rendre fou en Guyane. Il évoquera ce soir la puissance du personnage de Cervantès. Ses récits de voyage, essais et romans ont été traduits dans une dizaine de langues.
Voir aussi : Rubrique Littérature, Littérature Espagnole, Rubrique Rencontre, rubrique Montpellier,