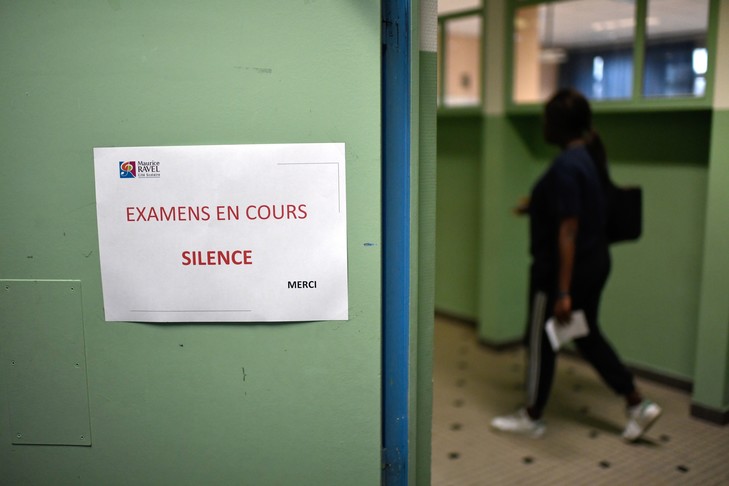Un hélicoptère d’attaque Tigre de l’opération française Barkhane survole le centre du Mali, le 1er novembre 2017. © Photo AFP/Daphne Benoit
Le Conseil de sécurité de l’ONU s’impatiente et tape du poing sur la table. Les protagonistes de la crise malienne sont priés de fumer le calumet de la paix. Le statu quo ne peut plus durer, avertit le chef de la mission des Nations Unies au Mali. Il constate avec regret que l’accord sur le désarmement des combattants signé par les différents groupes est resté lettre morte.
Face à la presse qu’il a reçue à Bamako, Mahamat Saleh Anadif, chef de la mission des Nations Unies au Mali, tire la sonnette d’alarme. Il met en garde les frères ennemis maliens contre les conséquences d’une guerre qui s’éternise dans ce pays sahélien, où la communauté internationale entretient une force de plus de 13.500 hommes qui coûtent la bagatelle d’un milliard de dollars à l’ONU.
«Les membres du Conseil de sécurité ont exprimé de façon claire leur impatience. Ils ont dit: « Nous allons renouveler ce mandat pour un an. Après, ce ne sera plus automatique. Nous allons voir comment vous allez faire dans la mise en œuvre de l’accord »». Une façon de dire que le statu quo ne peut plus continuer, précise le chef de la Minusma.
Gouvernement et groupes armés s’accusent mutuellement
Alors que le Mali est en campagne électorale pour la présidentielle prévue le 29 juillet, le gouvernement et les mouvements armés s’accusent mutuellement de bloquer la mise en application des accords de paix.
Les groupes armés multiplient les attaques contre la force internationale. Tirs de mortiers, voitures piégées, attaques suicides de combattants munis de ceintures d’explosifs, tous les moyens sont bons pour défier la Minusma et l’opération française Barkhane.
«J’avoue que je suis frustré par le fait que depuis deux ans, nous avons construit au moins huit camps pour le cantonnement des combattants des différents mouvements signataires. Mais jusqu’au jour d’aujourd’hui, ces camps demeurent toujours vides», déplore le chef de la mission onusienne.
Les sites de désarmement des combattants restent vides
Quelque 10.000 combattants appartenant à différents mouvements signataires de l’accord d’Alger étaient censés se regrouper dans huit sites pour être désarmés. Il n’en a rien été.
Face aux attaques des groupes djihadistes qui étendent leur rayon d’action bien au-delà du Mali, les experts estiment que le règlement de la crise malienne n’est pas pour demain. Certains n’hésitent pas à faire la comparaison avec l’Afghanistan.
«Les Américains ont tenté l’approche tout sécuritaire en Afghanistan: résultat, les talibans y sont plus forts que jamais», confie à l’AFP Bakary Sambe, directeur du groupe de réflexion Timbuktu Institute à Dakar. Il constate que les Français font de même dans le nord du Mali.
«Non seulement les djihadistes n’ont pas disparu, mais ils se sont multipliés. Comble du comble, le djihadisme a contaminé le Burkina Faso, le Niger et la Mauritanie», observe-t-il.
Dans ces conditions, la marge de manœuvre de la mission de l’ONU au Mali reste très étroite et la mise en garde lancée par le Conseil de sécurité aux belligérants ne devrait pas changer grand-chose.
«Le pouvoir malien n’est pas à la hauteur des enjeux»
A quatre semaines de l’élection présidentielle au Mali, le président Ibrahim Boubacar Keïta a promis de «traquer les terroristes jusque dans leurs derniers retranchements». Mais certains partenaires du Mali ne sont pas du tout rassurés. Ils pointent le manque de volonté politique des responsables maliens.
«Il y a beaucoup de pays qui sont aux côtés du Mali pour sortir de cette instabilité sécuritaire, mais il faut aussi qu’il y ait une visibilité dans la situation politique. Aujourd’hui, ce n’est pas le cas», tranche Jean-Jacques Bridey, président de la commission de la Défense de l’Assemblée nationale française.
Interrogé par RFI, le parlementaire français pense que le pouvoir actuel malien n’est pas du tout à la hauteur des enjeux.
Martin Mateso
Source Géopolis 06/07/2018
Voir aussi : Actualité internationale, Rubrique Afrique, Mali, Cinq ans après, la France est toujours présente au Mali et mal-aimée, rubrique Livre, Géopolitique de l’Afrique,