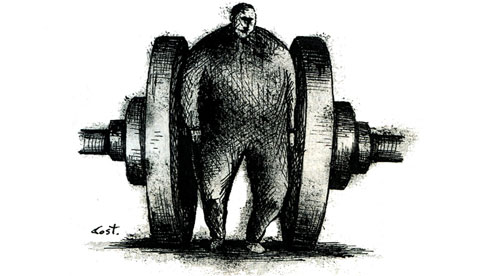Les débats médiatiques et les faits le prouvent : on assiste à une montée des discriminations et de la xénophobie contre les Roms. Le sociologue Jean-Pierre Liégeois décrypte les politiques de la France et de l’Europe à leur égard.
Jean-Pierre Liégeois, sociologue, a fondé en 1979 et dirigé jusqu’en 2003 le Centre de recherches tsiganes de l’Université de Paris Descartes (Paris-V). Depuis 1982, il travaille en étroite collaboration avec le Conseil de l’Europe et la Commission européenne. Il est membre élu du Conseil scientifique du Réseau universitaire européen d’études romani (Conseil de l’Europe et Union européenne) formé actuellement de près de trois cent cinquante chercheurs de trente-sept Etats.
Parmi ses derniers ouvrages : Roms et Tsiganes, dans la Collection Repères (Editions La Découverte, 2009), Roms en Europe, Editions du Conseil de l’Europe, 2007, Le Conseil de l’Europe et les Roms : 40 ans d’action, Editions du Conseil de l’Europe, 2010.
Les Roms sont à nouveau sur le devant de la scène politico-médiatique. Et pourtant on en sait toujours aussi peu sur eux, leur histoire, leurs communautés … Pourquoi ?
Dès que les discours abordent la question des Roms, on est en pleine confusion. Le résultat est qu’on dit tout et son contraire. Dans ces conditions, les propositions faites par les politiques ont peu de chances d’être adaptées, car elle portent sur des présupposés loin de la réalité. A l’analyse de ces discours, on en apprend plus sur ceux qui les prononcent que sur ceux qui en sont l’objet.
Les Roms ne sont pas inconnus, mais méconnus, et l’image qu’on s’en fait passe par des représentations sociales, préjugés et stéréotypes, très difficiles à modifier. Dès l’arrivée de familles dans l’Europe du XIVe et XVe siècles, commencent à se construire des images fondées sur des a priori, sur le fait qu’on ignore l’origine de ces familles, donc on l’invente. On est dans l’imaginaire, et au fil des siècles s’est constitué un réservoir de représentations dans lequel il suffit de puiser pour aller chercher les éléments dont on a besoin, pour justifier une attitude de rejet, un comportement discriminatoire, y compris au niveau politique le plus élevé : il suffit d’analyser les discours politiques pour voir clairement qu’ils s’alimentent à une image souvent fausse, négative ou folklorique, qui vient justifier les décisions qui sont prises. Les Roms ne sont donc pas définis tels qu’ils sont, mais tels qu’ils doivent être pour justifier des orientations politiques.
Alors, qui sont-ils ?
Les Roms, soit douze millions de personnes en Europe, viennent de l’Inde. Ils ont vécu 1 000 ans d’histoire, ils ont une culture, une langue dérivée du sanskrit, et leur présence en France est ancienne. Les Roms qui viennent aujourd’hui de Roumanie ou de Bulgarie ne sont donc pas les premiers. Si l’on évoque des moments intenses de déplacements, on peut citer celui d’avant la Révolution russe de 1917, ou encore dans les années 1970 les familles venant de l’ex-Yougoslavie. Par ailleurs l’usage en France du terme « Gens du voyage » renforce la confusion. C’est un néologisme administratif récent qui ne recouvre aucune réalité sociale ou culturelle. On voit donc que poser comme quasi synonyme Roms = « familles nomades venant de Roumanie depuis l’entrée de la Roumanie dans l’UE » est totalement faux.
Ils n’ont rien à voir avec le nomadisme?
Les familles sont souvent mobiles par obligation, pour s’adapter à des conditions d’existence changeantes, parfois menaçantes. Au cours de l’histoire, on assiste à des déportations, par exemple du Portugal vers l’Afrique et le Brésil, de l’Angleterre vers les colonies d’Amérique et vers l’Australie. Ou, quand des conflits se produisent, les Roms, souvent pris comme boucs émissaires ou bloqués entre les belligérants, doivent partir. Un des exemples récents est le Kosovo à la fin des années 90, d’où la presque totalité des Roms sont partis pour survivre et se sont réfugiés dans d’autres Etats. Ceux-ci veulent maintenant les y renvoyer sans mesurer les risques que les Roms courent.
Les Roms ont ainsi dû intégrer la mobilité dans leur existence, pour s’adapter à un rejet qui reste dominant. La montée actuelle des discriminations et de la xénophobie, dont les Roms, tous les rapports internationaux le montrent, sont les premières cibles en Europe, ne va pas entraîner une stabilisation sereine des familles ; elles seront souvent contraintes à aller voir ailleurs si leur sort peut être meilleur.
Les politiques des Etats européens vis à vis des Roms vont toutes dans le même sens, celui de l’exclusion ?
On peut proposer une typologie de ces politiques :
• des politiques d’exclusion, par le bannissement hors du territoire d’un Royaume, ou d’un Etat. Il s’agit le plus souvent d’une disparition géographique, par le rejet hors du territoire. Il peut aussi s’agir d’une disparition physique que la plupart des familles roms d’Europe ont eu à subir douloureusement sous le régime nazi.
• des politiques de réclusion : la disparition, souhaitée géographiquement par un bannissement, devient souhaitée socialement par l’enfermement et l’éclatement du groupe et des familles, et s’accompagne d’une utilisation de la force de travail que peut représenter la communauté rom. C’est l’envoi aux galères, l’envoi dans les colonies à peupler, la déportation, l’esclavage, etc.
• des politiques d’inclusion : par l’assimilation du Rom par son environnement. La disparition est alors culturelle, et le Rom n’est considéré que comme un marginal posant des problèmes sociaux. Il n’est plus interdit mais contrôlé, il n’est plus rejeté mais assimilé.
Ces trois catégories peuvent être considérées dans une chronologie, mais elles peuvent aussi coexister car la volonté d’assimiler n’a jamais réduit le désir d’exclure, d’où le hiatus qu’on observe entre le discours politique central et l’action des collectivités locales. Mais aujourd’hui, on entre dans une chronologie à rebours : il est davantage question, dans les discours politiques, d’exclusion plutôt que d’assimilation.
Chaque Etat cherche donc à renvoyer les Roms dans l’Etat voisin ?
Comme au temps de la royauté ! La négation des Roms est une des politiques d’Europe les mieux partagées. Là aussi, on peut distinguer trois tendances :
• une réactivation de l’exclusion au niveau national, exacerbée avec la proximité d’élections. Le « Rom » en tant que bouc-émissaire est facile d’accès, il a peu de force politique pour se défendre, et dans ces conditions chacun peut impunément et de façon irrationnelle râcler les fonds de tiroirs des stéréotypes pour y trouver ce qui lui convient. D’ailleurs, le renvoi sous des formes diverses, comme les reconduites à la frontière, est inutile et plus coûteux qu’une politique d’accueil. On sait que les personnes ainsi traitées peuvent légalement revenir, et qu’une reconduite à la frontière coûte 21 000 euros minimum aux finances publiques (un rapport officiel du Sénat qui a fourni ces données en 2008).
• une pression des institutions internationales, qui vise à la reconnaissance des Roms, à leur protection, et à leur mobilité dans l’espace européen. Des stratégies nationales ont été adoptées sous la pression de l’Union européenne, mais le fossé est grand entre les projets et leur réalisation, et le suivi de l’UE reste mou à l’égard des Etats.
• une période d’indécision : on s’est aperçu que les politiques d’exclusion, réclusion ou assimilation, n’ont pas abouti au cours des siècles, et on s’interroge, ce qui ouvre la voie à de nouvelles réponses. Peut-être y a-t-il là une raison d’espérer un changement…
Et la France, comment se situe-t-elle?
Elle entre de façon radicale dans la réactivation de l’exclusion. Les indicateurs sont nombreux : interpellations en France de la Halde puis du Défenseur des Droits, de la Commission nationale consultative des Droits de l’Homme, interpellations européennes de la Commission européenne, notification à la France, par le Comité des ministres du Conseil de l’Europe, de sa violation de la Charte sociale européenne à l’égard des Roms et des « Gens du voyage », etc.
On peut aussi mentionner le fait qu’un texte fondamental comme la Convention-cadre pour la protection des minorités nationales n’a pas été signé par la France : il s’agit d’un texte du Conseil de l’Europe, et sur les quarante-sept Etats membres seuls quatre n’ont pas signé : France, Turquie, Andorre et Monaco.
Et, pourtant vous insistez souvent sur le fait que les Roms sont au cœur de l’intégration européenne ?
Je propose même un renversement de perspective ! Deux faits majeurs marquent l’Europe : la mobilité des populations, et l’émergence de la question des minorités depuis 1990. Or les Roms illustrent les deux. Tous les Etats sont aujourd’hui obligés de gérer des situations complexes de multiculturalité, et les questions concernant les Roms sont exemplaires et peuvent servir de modèle.
Leur situation illustre ce que l’Europe a de plus négatif, en termes de discrimination, de rejet, de racisme, d’impuissance à accepter et à gérer la diversité. Mais par leur présence dans tous les Etats et leurs liens transnationaux, ils sont les pionniers d’une Europe future. Ils sont des passeurs de frontières, et dans une Europe qui se voudrait sans barrières, certains Etats veulent aujourd’hui restreindre la circulation des citoyens roms.
Ce discours peut-il être entendu, aujourd’hui ?
L’Union européenne a porté son attention sur la situation des Roms à partir de 1984, et son activité s’est intensifiée lors de la candidature d’Etats d’Europe centrale, essentiellement avec la mise en place de grands programmes d’aide financière qu’il faudrait aujourd’hui évaluer et coordonner, car on a l’impression qu’on navigue à vue, sans vision à moyen et long termes, et seulement en réaction à des événements auxquels il faut faire face à un moment donné.
Propos recueillis par Weronika Zarachowicz