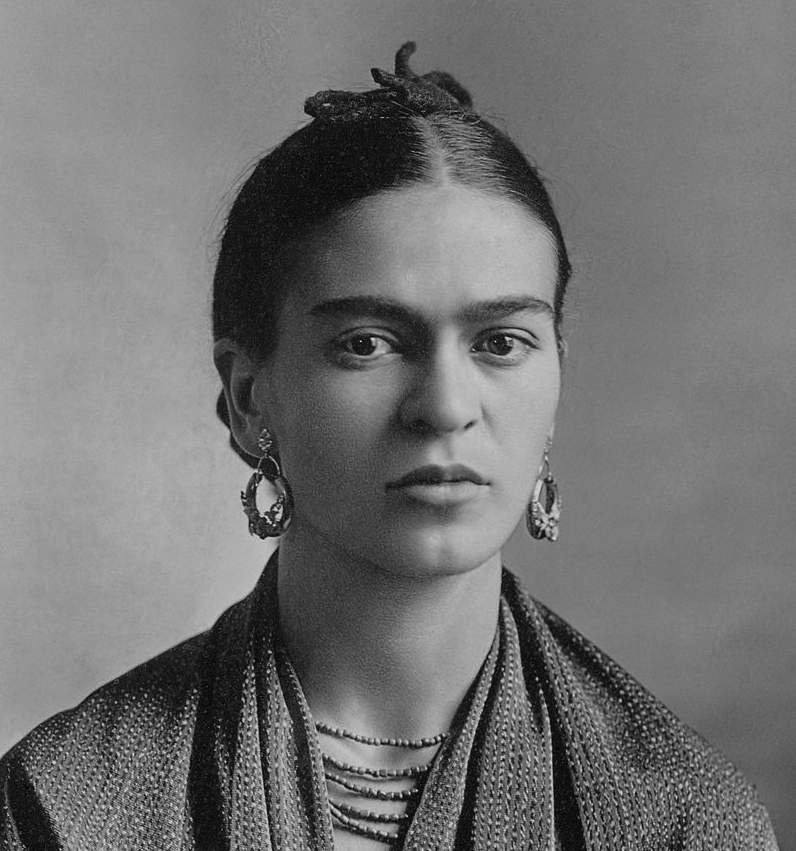Pénuries et corruption minent la société
À mesure que les pénuries s’aggravent, le Venezuela s’enfonce dans le chaos économique. Victorieuse lors des législatives de décembre 2015, la droite tente d’organiser un référendum afin de révoquer le président Nicolás Maduro, successeur d’Hugo Chávez. Une victoire lors d’un tel scrutin suffirait-elle à redonner confiance aux militants de gauche ?
Non ! ça, tu ne le fais pas ! », gronde une femme face à l’homme qui vient de donner un coup de pied dans les cartons remplis de nourriture, exaspéré de devoir attendre le ministre de la jeunesse pour que commence la distribution des aliments. L’impatient quitte le local où sont rassemblés les membres du comité local d’approvisionnement et de production (CLAP), quasi exclusivement des femmes.
Créé en avril 2016, le dispositif vise à lutter contre le détournement de denrées alimentaires et la spéculation qui, selon le gouvernement vénézuélien, vident les magasins du pays. À travers diverses organisations, dont les CLAP, l’État apporte à chaque habitant les produits alimentaires de base (riz, farine, huile…) que l’on ne trouve plus qu’au marché noir à des prix exorbitants. Le kilo de lait en poudre, qui coûte au tarif officiel 70 bolivars (6,36 euros (1)), s’arrache pour trente fois plus dans la rue.
La distribution débute enfin. « Je leur ai dit de commencer sans attendre le ministre, nous confie M. Jesús Guzman, un habitant du quartier. Sinon, les gens l’auraient accueilli avec des noms d’oiseaux. » Les bras chargés, les militantes entament la répartition du précieux butin dans cette tour d’immeuble de la cité Hornos de Cal, au cœur du quartier San Agustín de Caracas.
« Pour quel journal travailles-tu ? Appartiens-tu à une organisation politique dans ton pays ? Quelles sont tes premières impressions de Caracas ? », interroge avec un peu d’insistance un visage caché derrière d’épaisses lunettes. Mme Yurami Quintero, vice-ministre de la jeunesse, semble accorder une confiance mesurée aux journalistes étrangers. Sans véritablement attendre de réponse, elle reprend le travail, au milieu d’un groupe d’une demi-douzaine de personnes. Étage par étage, elles distribuent, liste en main, les sacs de provisions vendus à prix fixe et réduit. Dans les couloirs, laissant ouvertes les portes des appartements d’où jaillissent des têtes d’enfants, les résidents écoutent les interventions des membres du comité.
« Nous affrontons actuellement une guerre économique, tempête Mme Rodbexa Poleo, militante du Parti socialiste unifié du Venezuela (PSUV), qui arbore le maillot de l’équipe nationale de football. Mais nous sommes ici pour vous montrer que la révolution vous défend. Que nous sommes avec le peuple ! » Puis vient le tour de Mme Quintero, qui adopte un ton plus posé : « Les CLAP ne sont pas la solution à tout, mais c’est un début. Grâce à eux, nous sommes en train de frapper durement cette mafia qui nous vole. »
« Mafia » ? Une référence au patronat, dont le gouvernement estime qu’il organise le chaos économique en interrompant la production et, plus problématique encore, les importations, dans un pays qui achète à l’étranger une grande partie de ce qu’il consomme. Le 31 mai 2016, le député PSUV Ricardo Molina a par exemple dénoncé à la télévision la destruction de trois millions d’œufs destinés à la vente par l’entreprise Ovomar. « Et le lait !, ajoute M. Charles Ruiz, militant du PSUV. On a plusieurs fois retrouvé des milliers de litres déversés sur les chemins. Tout ça sur ordre des patrons, dans le but de créer la pénurie. » Dans les commerces, les produits de première nécessité manquent cruellement. Au marché noir, les prix flambent et attisent l’inflation, dont le Fonds monétaire international (FMI) prévoit qu’elle atteindra 700 % en 2016. Les sacs distribués ce matin du 28 mai 2016 contiennent du sucre, du lait, de la farine, de l’huile, du riz et des pâtes, pour un prix total de 475 bolivars, soit moins que celui d’un kilo de lait en poudre au marché noir.
« Une fuite en avant dans l’individualisme »
Dans une petite cour du barrio (quartier) Marin, Mme Martha Gonzalez, travailleuse du secteur culturel, aide des amis à peindre des fresques sur les murs ; une activité destinée à maintenir, espèrent-ils, la mobilisation des jeunes dans le domaine artistique en période de crise. « Les CLAP ne fonctionnent pas partout avec la même efficacité, remarque-t-elle dans un sourire. Le problème du pays, c’est la corruption. Et pas uniquement au sein de la haute administration. Tout le monde est impliqué : les secrétaires, les employés des douanes, le livreur qui détourne des produits pour les revendre à des amis qui, à leur tour, les revendent au marché noir… Bref, la corruption concerne tous ces Vénézuéliens qui volent les Vénézuéliens. » Autour de nous, les couleurs vives des portraits et des dessins servent de toile de fond à un match de basket-ball improvisé par les gamins de la rue. « Et pourtant, le gouvernement ne fait rien ! À cause de la corruption, d’ailleurs ! De fil en aiguille, c’est le sauve-qui-peut général. Tout le monde ici connaît l’histoire du délinquant qui, lorsque le policier l’arrête, lui propose 10 000 bolivars. Le policier refuse et emmène le malfrat au commissariat, avant de le voir ressortir aussi vite. “Tu n’es pas malin : ton chef m’a laissé partir pour 5 000 !” »
Membre du collectif Comando creativo (« commando créatif »), M. Victor P. s’affaire aux côtés de Mme Gonzalez. Il a réalisé bon nombre des fresques que l’on peut voir ici. Coiffé d’une large casquette rouge assortie à un tee-shirt de la même couleur — celle des chavistes —, il s’exprime en brassant l’air, tel un boxeur aux prises avec un adversaire invisible. « Ici, on trouve de tout ! Mais au noir. Et tout le monde s’y met. Une personne fait la queue tôt le matin pour acheter des couches le jour où, d’après son numéro de carte d’identité, c’est son tour d’y avoir droit, alors qu’elle n’a pas d’enfant ! Elle dévalise le stock et le revend sur le trottoir d’en face, dix fois plus cher. » Autre exemple, que nous donne M. Ruiz : « Pénurie oblige, le boulanger doit acheter sa farine aux “bachaqueros” [ceux qui profitent de la spéculation par la vente de produits régulés]. Comme son prix est fixé par les autorités, il ne peut pas la revendre, sauf s’il l’utilise pour faire du pain, qui, lui, peut être vendu très cher. » Désignant une file qui s’allonge devant une boulangerie, il conclut : « Et ceux qui achètent le pain le savent. » « Cela entretient une espèce de fuite en avant dans l’individualisme, reprend M. P. Les gens n’ont pas le sentiment de faire partie d’une communauté politique. » Lorsqu’on lui demande pourquoi l’État ne réprime pas plus sévèrement de telles pratiques, si contraires au projet socialiste défendu par le président Nicolás Maduro et son prédécesseur Hugo Chávez, il lâche, désabusé : « C’est la question à un million… »
D’autres, dont le journaliste de la chaîne TeleSur Eduardo Rothe, avancent quelques éléments de réponse. Parfois glaçants. « Ni la production ni les importations n’ont baissé : les niveaux sont les mêmes depuis des années. Côté distribution, par contre, c’est autre chose. Tout ce que tu ne trouves pas dans les magasins, tu le trouves dehors. » Le passage du commerce traditionnel à l’illégalité a donné naissance à un immense marché, dont beaucoup profitent, ou dépendent. « C’est une affaire collective, conclut Rothe. Et ce gouvernement n’est pas une dictature : il ne veut pas s’aliéner autant de gens. »
À la télévision, un spot financé par l’État passe en boucle. Dans une salle de classe, une enseignante demande à ses élèves ce qu’ils souhaitent faire plus tard. L’un d’eux répond qu’il sera bachaquero, comme son père. Le spot se termine par un rappel du caractère illégal et immoral de la contrebande. Une démarche de sensibilisation dont on peine à croire qu’elle suffira à enrayer le fléau.
Car la vulnérabilité économique de l’État vénézuélien n’est pas un phénomène nouveau. Elle repose principalement sur sa dépendance vis-à-vis de la rente pétrolière (2). « Dès les années 1930, l’économiste Alberto Adriani invitait à développer l’élevage, l’agriculture, l’industrie. Selon lui, il fallait “semer le pétrole”, nous explique M. Carlos Mendoza Potellá, directeur de la revue de la Banque centrale du Venezuela, derrière son bureau où trônent des échantillons de pétrole et de soufre. Nous ne l’avons jamais fait. Comment “semer le pétrole” lorsque les ressources sont aussi gigantesques ? » Le Venezuela abrite les plus importantes réserves pétrolières prouvées du monde, ce qui, paradoxalement, décourage les investissements productifs. Reprenant son analyse de la version caribéenne de la « maladie hollandaise », qui entrave le développement industriel d’un pays doté d’immenses richesses en matières premières, M. Mendoza Potellá résume : « Ce revenu externe accroît notre capacité à importer et, notre monnaie s’appréciant, réduit notre compétitivité pour les exportations. »
Chávez a tenté durant sa présidence (1999-2013) de corriger ce mal structurel ; en vain. M. Mendoza Potellá nous raconte : « Un ami agronome se rendait il y a quelques années dans la zone agricole la plus productive, dans l’État de Barinas, au centre du pays. Il devait effectuer un long trajet en hélicoptère. Du ciel, il voit soudain des taches jaunes et vertes. Il descend pour voir ce que c’est. Il s’agissait de parcs immenses où l’on avait abandonné des tracteurs. Des John Deere pour les verts et des Caterpillar pour les jaunes. Qu’est-ce que cela signifie ? Des crédits agricoles avaient été utilisés, des tracteurs achetés. Mais ça n’a pas fonctionné… » Pour le reste, poursuit notre interlocuteur, « les financements agricoles se sont transformés en spéculation immobilière à Caracas ».
« Au risque de parler comme l’opposition… »
Le charismatique président décédé en 2013 ne porterait-il donc aucune responsabilité ? Notre interlocuteur sourit : « Que fait Chávez à son arrivée au pouvoir, en 1999 ? Il ne s’attaque pas d’abord à l’économie, mais à l’urgence sociale : la malnutrition, le logement. Je ne le lui reproche pas ; c’est ce que commandait la solidarité humaine. Mais ce n’est pas comme cela qu’on développe la production nationale. » Compréhensible, ce choix se révèle lourd de conséquences. À l’image de la consommation de calories, en hausse grâce à la redistribution de richesses, les importations de nourriture n’ont cessé de croître depuis l’arrivée au pouvoir de Chávez. Selon le chercheur Carlos Machado Allison, elles sont passées de 1,4 milliard d’euros en 2000 à 6,5 milliards en 2013 (3). Les besoins de la population n’ont pas diminué depuis, mais la valeur du bolivar s’est effondrée, aggravant encore le problème.
Ni la « guerre économique » ni les priorités sociales du chavisme ne suffisent à expliquer les pénuries, selon M. Mendoza Potellá, qui prend l’exemple du sucre. « Le gouvernement détient toutes les centrales sucrières : il les a nationalisées. Mais la production n’atteint même plus le niveau de la consommation nationale. Tout s’est arrêté, la canne n’est pas récoltée. Est-ce du sabotage, de l’inefficacité ? Je ne sais pas. Vous allez dire que je parle comme un partisan de l’opposition, mais la corruption est partout ! » Selon une étude réalisée par la société Ecoanalítica, « environ 70 milliards de dollars ont été détournés à travers les importations entre 2003 et 2012. Vingt pour cent des importations réalisées par des sociétés privées et 40 % de celles menées par les agences ou les sociétés pilotées par le gouvernement étaient frauduleuses (4). » Et M. Mendoza Potellá de conclure : « Nous n’avons pas remplacé la rationalité capitaliste par une autre, socialiste, mais par celle d’administrateurs corrompus. »
« Corruption » : pas une discussion au cours de notre visite sans que le mot ne soit prononcé. À tel point que beaucoup reprochent au gouvernement sa « mollesse » dans la lutte contre cette calamité. « Il ne veut pas se montrer trop sévère de peur de nuire à la popularité du président, estime M. Fermin Sandoval, qui s’occupe d’une radio de quartier à Petare, dans les faubourgs de Caracas. Qu’il réprime ou non, les médias diront de toute façon que le Venezuela est une dictature. »
« Nous sommes dans une période de radicalisation »
Un 4 x 4 rutilant fait son entrée dans une rue qui borde la place Bolívar, ainsi baptisée en hommage au Libertador, le dirigeant indépendantiste Simón Bolívar (1783-1830), dont Chávez avait fait l’un de ses héros. On interroge deux jeunes femmes vêtues de rouge à la terrasse d’un café : s’agit-il de la voiture d’un membre de ces « élites » dénoncées par les révolutionnaires bolivariens ? Elles lèvent les yeux au ciel : « Plutôt celle d’un ministre, ou d’un dirigeant du PSUV ! » Est-ce le cas ? Impossible à dire. Mais tous les témoignages le confirment : le fossé entre le train de vie de certains dirigeants chavistes et celui de leur base militante en a creusé un autre, politique, celui-là.
On ne l’observe nulle part aussi bien que dans le quartier 23 de Enero. Bastion historique de la gauche vénézuélienne, épicentre de la résistance populaire durant la période insurrectionnelle des années 1960 puis au cours des décennies suivantes, le « 23 » a été remporté par l’opposition lors des législatives du 6 décembre 2015, marquées par une cinglante défaite nationale du chavisme (5). « Avec seulement vingt voix d’écart ! », insiste M. Juan Contreras, figure politique de premier plan dans le quartier. Il nous accueille au siège de la radio communautaire Al son del 23 (« Au son du 23 »), où il travaille pour la Coordination Simón Bolívar. « Nos locaux se trouvent dans un ancien commissariat où on torturait les jeunes de gauche dans les années 1960. C’était important pour nous de reprendre possession de lieux comme celui-là. » Les façades du bâtiment arborent désormais les visages d’Ernesto Che Guevara et de Bolívar, ou des graffitis en faveur de la cause palestinienne. Pour beaucoup, M. Contreras était le candidat naturel du quartier. Il a pourtant été écarté par la direction du PSUV au profit d’une candidate parachutée. Une « erreur », estime humblement le militant.
De tels procédés expliquent le revers de décembre 2015, selon Eduardo Rothe, qui rappelle que le PSUV a davantage souffert d’un effondrement du vote chaviste que d’un raz de marée en faveur de l’opposition. « Les élections ont été régulières, souligne-t-il. Aucune magouille. Mais le parti, trop bureaucratique, s’est tiré une balle dans le pied en refusant les candidats proposés par la base. » Dans le « 23 », beaucoup disent s’être abstenus en signe de protestation.
Dorénavant, le chavisme serre les rangs. Le 1er juin 2016, une manifestation de soutien au gouvernement rassemblait la jeunesse chaviste dans la capitale. Dans une ambiance festive, des centaines de collégiens, de lycéens et d’étudiants défilaient le long des avenues en scandant des mots d’ordre favorables au pouvoir et en agitant des drapeaux du PSUV, du Venezuela ou encore de Cuba. Arrivée au palais de Miraflores, la foule a été accueillie par le président Maduro. Poignées de main, acclamations…
À l’image de Fidel Barbarito, enseignant à l’Université nationale expérimentale des arts (Unearte), certains chavistes en tirent des conclusions encourageantes : en dépit d’importantes manifestations du côté de l’opposition également, une telle mobilisation suggère selon eux que, si un référendum révocatoire avait lieu (6), ils le gagneraient. « Nous sommes dans une période de radicalisation : les masques sont tombés. La droite, désespérée et soucieuse de défendre les priorités des États-Unis, a changé de scénario. C’est une vraie guerre. »
M. Sandoval nous raconte un incident qu’il juge révélateur de la situation actuelle. « Cette semaine, il y a eu une attaque armée contre les forces de l’ordre, ici, à Petare ! Des types masqués tiraient à la mitrailleuse — des paramilitaires. C’était un ballon d’essai. Le but était de voir si, dans le contexte des pénuries, un accrochage pouvait entraîner une explosion sociale. Pour l’instant, la majorité de la population ne suit pas, car elle sait qui provoque tout ça ; mais je crois que les gens vont se fatiguer. » Dissimulant mal son inquiétude, il ajoute : « Dans de tels cas, pourquoi fait-on appel à de jeunes recrues de la police ? Pourquoi le gouvernement n’envoie-t-il pas des unités spécialisées ? »
En guise de réponse, Fidel Barbarito, qui a été ministre de la culture dans le premier cabinet de M. Maduro, évoque les opérations de libération du peuple (OLP), dirigées par les forces armées nationales bolivariennes à l’été 2015. « Ces opérations visent à démanteler les organisations paramilitaires. Nous ne reculons pas devant le combat physique. » Si nul ne souhaite voir le Venezuela tomber aux mains des paramilitaires, la création des OLP ne dessine pas vraiment un horizon paisible pour la révolution.
Militant associatif à Petare, M. Ruben Pereira se montre lui aussi confiant quant à l’issue d’un possible référendum révocatoire. Mais il doute que cette éventuelle victoire suffise : « Un référendum n’arrangerait rien. Nous le gagnerions, et puis quoi ? L’opposition serait toujours là. » La solution qu’il privilégie ? « Une Assemblée constituante. À la place de Maduro, je remettrais mon mandat en jeu, ainsi que celui de cette Assemblée nationale de droite. Il faut tout remettre à plat ! » Selon lui, un nouveau « virage à gauche » devrait viser à renforcer le pouvoir populaire, ces institutions parallèles à l’État traditionnel, censées développer la participation citoyenne (7)… Là encore, un doute demeure : M. Maduro dispose-t-il de l’appui nécessaire à un tel projet au sein du PSUV, dont chacun admet qu’il est largement gangrené par la corruption ?
Moins optimiste quant à l’issue du référendum, Mme Gonzalez refuse toutefois de sombrer dans la morosité. La claque des législatives de 2015 ? « Surtout une défaite de la bolibourgeoisie [les fonctionnaires ayant tiré profit du mouvement révolutionnaire]. Ça ne m’inquiète pas, dans la mesure où ce qui a été acquis, les missions, les programmes sociaux, tout cela reste dans la tête des gens. Ils ne se laisseront pas dépouiller. Et puis, malgré la guerre économique, le chavisme a remporté cinq millions de voix. C’est là son noyau dur ; c’est énorme. »
La question, selon elle, est la suivante : que vont faire ceux qui ont voté pour l’opposition en pensant qu’elle mettrait fin aux pénuries ? À ce propos, les chavistes n’ont pas hésité à ironiser sur le titre du clip de campagne de la Table de l’unité démocratique (MUD, coalition des partis de l’opposition), « La dernière queue », dans lequel des gens patientaient « une dernière fois » pour voter, chasser les chavistes et en finir avec les pénuries.
Boissons gazeuses et mots d’ordre révolutionnaires
« Avec autant de sièges, on aurait pu s’attendre à ce que l’opposition, une fois à l’Assemblée, fasse passer des lois populaires sur l’économie et la sécurité, remarque Rothe. Mais non ! La première chose qu’ils font, c’est voter une loi d’amnistie ! » Ce texte, qui exclut les poursuites judiciaires pour toute la période allant du 1er janvier 1999 à l’entrée en vigueur de la loi, blanchit les auteurs de crimes ou délits tels que les « diffamations et injures » à l’encontre de fonctionnaires ou la participation aux « événements du 11 avril 2002 et des jours suivants ». À cette date, l’opposition, le patronat et les médias avaient orchestré un coup d’État (qui fit long feu) (8). « Menons l’enquête auprès de ceux qui ont voté pour les candidats de l’opposition en pensant qu’ils allaient changer la vie, s’amuse M. Pablo Artiaga, militant de quartier à Petare. Je ne m’attends pas à une vague d’enthousiasme. » Mais l’opposition a-t-elle vraiment eu l’occasion de gouverner ? À peine était-elle installée à l’Assemblée que le président Maduro décrétait l’état d’urgence économique de façon à pouvoir poursuivre sa politique.
Les murs et les façades de Caracas sont à l’image de la situation politique du pays : en lutte constante. Les affiches vantant les mérites de boissons gazeuses ou de chaînes de restauration rapide disputent l’espace aux mots d’ordre révolutionnaires ou aux fresques représentant les yeux de Chávez. Pour le moment, le « seuil minimum de conscience du peuple » dont parlent les chavistes a permis d’éviter une explosion sociale, en grande partie grâce au travail quotidien de la base militante. Tôt le matin, des files de dizaines de personnes se forment sur les trottoirs. Devant les boulangeries, les pharmacies, les magasins, les banques, dans le calme, lisant le journal ou échangeant avec leur voisin, les habitants de Caracas patientent. Jusqu’à quand ?
Loïc Ramirez
(1) La monnaie vénézuélienne circule pour une valeur beaucoup plus faible sur le marché noir. À ce taux de change parallèle, 70 bolivars correspondent à 0,14 euro.
(2) Lire Gregory Wilpert, « Le Venezuela se noie dans son pétrole », Le Monde diplomatique, novembre 2013.
(3) Libération, Paris, 24 juin 2013.
(4) William Neuman et Patricia Torresmay, « Venezuela’s economy suffers as import schemes siphon billions », The New York Times, 5 mai 2015.
(5) L’opposition a obtenu 111 sièges à l’Assemblée nationale, contre 55 pour le PSUV, sur un total de 167. Lire Gregory Wilpert, « Avis de tempête au Venezuela », Le Monde diplomatique, janvier 2016.
(6) Exigé par l’opposition et approuvé en avril 2016 par l’Assemblée nationale, un référendum révocatoire requiert notamment la signature de 20 % du corps électoral. Le 7 juin 2016, le Conseil national électoral (CNE) a validé la majorité des signatures (le gouvernement ayant dénoncé des fraudes). Il s’agit désormais pour le CNE de vérifier 1 % des signatures en demandant aux gens de se déplacer.
(7) Lire Yoletty Bracho et Julien Rebotier, « La révolution bolivarienne par sa base », Le Monde diplomatique, janvier 2016.
(8) Lire Maurice Lemoine, « Hugo Chávez sauvé par le peuple », Le Monde diplomatique, mai 2002.