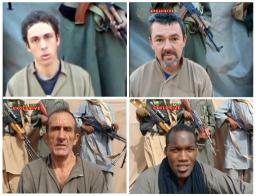Certains États dont les représentants ont manifesté le 11 janvier 2015 à Paris, avec François Hollande, sont loin d’être des défenseurs de la liberté d’expression. Petit rappel non exhaustif de leurs pratiques en 2015.
Il y a tout juste un an, ils étaient « Charlie ». Ou tout du moins le proclamaient-ils. Le 11 janvier 2015, une cinquantaine de représentants d’États étrangers a défilé à Paris aux côtés de François Hollande pour défendre la liberté d’expression. Clic, une photo pour la postérité. Et puis ils sont rentrés. « Charlie », certains de ces politiciens ne l’ont été qu’une journée. Un an après, on ne compte plus les atteintes à la liberté d’expression dans de nombreux pays représentés. Petit tour d’horizon, non exhaustif.
Espagne
![]() Personne présente : Mariano Rajoy, Premier ministre
Personne présente : Mariano Rajoy, Premier ministre
Déjà il y a un an, la présence de Mariano Rajoy à la grande marche du 11 janvier avait fait grincer des dents. Car, en toute discrétion, le pouvoir conservateur ne se privait pas de rogner la liberté d’expression. Poursuites judiciaires contre le journal satirique El Jueves, ou l’humoriste Facu Diaz… Autant de casseroles que le Premier ministre traînait avec lui à Paris. En 2015, la loi « de sécurité citoyenne », votée un an plus tôt, est entrée en vigueur. Une « loi baillon » punissant de lourdes certaines formes de mobilisation sociales développées en Espagne ces dernières années. Au nombre de ces infractions : la résistance pacifique aux forces de l’ordre pour empêcher une expulsion immobilière ou encore l’acte de « perturber la sécurité citoyenne » devant le parlement.
Hongrie
![]() Personne présente : Viktor Orban, Premier ministre
Personne présente : Viktor Orban, Premier ministre
Le chef du gouvernement hongrois a une définition toute particulière de la liberté d’expression. Invoquée en mai 2015 au parlement européen pour justifier ses déclarations sur une réintroduction de la peine de mort dans son pays (« Nous ne devons pas fuir devant la discussion d’un problème […] la Hongrie respecte la liberté d’expression. »), elle est en général une préoccupation secondaire de ce populiste. Régulièrement dénoncé pour des fermetures et censures de médias depuis son arrivée au pouvoir en 2010, le gouvernement de Viktor Orban aurait notamment ordonné à la télévision publique de censurer les images d’enfants dans ses reportages sur les réfugiés. Il ne faudrait pas que les Hongrois soient trop sensibilisés à leur cause… Notons que le parlement européen a voté, mi-décembre, une résolution demandant l’engagement immédiat d’un « processus de surveillance en profondeur concernant la situation de la démocratie, de la primauté du droit et des droits fondamentaux en Hongrie ».
Pologne
![]() Personne présente : Ewa Kopacz, Première ministre
Personne présente : Ewa Kopacz, Première ministre
Depuis le défilé du 11 janvier, la Pologne a changé de gouvernement, troquant la formation de Donald Tusk et Ewa Kopacz, Plateforme civique (centre-droit) pour le parti Droit et Justice, dont les idées conservatrices font écho aux discours de son voisin hongrois, le Fidesz, parti de Viktor Orban. Arrivés au pouvoir en novembre, les conservateurs de Droit et Justice n’ont pas attendu pour remodeler à leur façon la liberté d’expression polonaise. Fin décembre, le parlement a ainsi adopté une loi sur les médias assurant le contrôle de la télévision et de la radio publiques, en accordant au gouvernement le pouvoir de nomination des dirigeants de la télévision et de la radio publiques et assurant ainsi un contrôle de ces médias. Depuis l’automne, en Pologne, l’ambiance n’est pas très « Charlie ». Pour l’anecdote, un prêtre, accompagné de proches de Droit et Justice, a même tenté d’exorciser l’un des principaux journaux du pays, jugé mensonger, en récitant une prière devant le siège du média. La petite manifestation a été accueillie par une pluie de dessins humoristiques et de tracts défendant la liberté d’expression.
Russie
![]() Personne présente : Sergueï Lavrov, ministre des Affaires étrangères
Personne présente : Sergueï Lavrov, ministre des Affaires étrangères
L’autoritaire Vladimir Poutine, père d’une multitude de lois répressives portant gravement atteinte à la liberté d’expression, continue d’instaurer une propagande massive et d’exercer de multiples pressions à l’égard de tous ceux qui pourraient propager des discours dissonants. Depuis le retour de M. Poutine à la présidence, RSF déplore une censure organisée et contrôlée par les autorités de surveillance des télécommunications et le blocage de nombreux sites d’informations. Le Kremlin aurait également embauché des centaines de personnes pour inonder la toile de messages pro-Poutine et anti-Obama. Certaines ONG défendant les droits des médias et la liberté d’expression sont désormais considérées comme « agents de l’étranger ». En 2015, au moins deux journalistes ont été emprisonnés pour avoir critiqué les autorités municipales ou régionales. Afin d’échapper à la répression, de nombreux journalistes et activistes sont contraints à l’exil.
Ukraine
![]() Personne présente : Petro Porochenko, Président de l’État
Personne présente : Petro Porochenko, Président de l’État
Face à des violations de la liberté de la presse de plus en plus nombreuses, et de multiples exactions, RSF a choisi de recenser les incidents majeurs en un fil d’information. De nombreuses agressions ont été signalées, mais aussi des expulsions arbitraires, des arrestations abusives ainsi que des emprisonnements. Le 16 décembre, le parti communiste a été interdit par une décision de justice, portant ainsi atteinte à la liberté d’expression et d’association. Des dizaines de journalistes étrangers ne peuvent plus entrer sur le territoire ukrainien.
Turquie
![]() Personne présente : Premier ministre Ahmet Davutoglu
Personne présente : Premier ministre Ahmet Davutoglu
Le gouvernement turc, défenseur de la liberté d’expression ? Il y a un an, la présence du Premier ministre turc à la manifestation du 11 janvier était déjà dénoncée comme le comble de l’hypocrisie. L’année écoulée n’a fait que le confirmer. Quelques jours à peine après cette grande marche, quatre sites web étaient censurés par un tribunal turc pour avoir publié la Une de Charlie Hebdo, « Tout est pardonné ». « Nous ne pouvons accepter les insultes au prophète », avait commenté M. Davutoglu. Pas question non plus d’accepter qu’on se moque du Président. En mars, deux dessinateurs de presse turcs ont été condamnés à une amende de 7.000 livres (2.500 euros) pour « insulte » au président Erdogan. Perquisitions musclées dans des locaux de médias, censure, emprisonnements de journalistes et multiples condamnations pour « insulte » ou « propagande en faveur d’une organisation terroriste »… On ne compte plus les atteintes à la liberté d’expression en Turquie. Trente journalistes ont passé le dernier réveillon en prison, selon la Fédération européenne des journalistes, nombre d’entre eux pour leur travail sur le conflit qui oppose le gouvernement turc et les rebelles kurdes du PKK. La Turquie a par ailleurs expulsé plusieurs journalistes étrangers qui couvraient ce conflit. À la 149e place du dernier classement mondial de la liberté de la presse de Reporters sans frontières, la Turquie se place juste devant la Russie (152e) et derrière la Birmanie (144e).
Émirats Arabes Unis
![]() Personne présente : Cheikh Abdallah Ben Zayed Al-Nahyane, membre de la famille régnante
Personne présente : Cheikh Abdallah Ben Zayed Al-Nahyane, membre de la famille régnante
Procès inéquitables, tortures, violences, emprisonnements et arrestations arbitraires… La liberté d’expression n’existe pas aux Émirats arabes unis. Au moins huit personnes seraient actuellement détenus pour avoir brisé la loi du silence. Ce chiffre ne représente pas grand chose dans un pays où les décisions de justice sont abusives et les principes démocratiques inexistants. Selon Human Rights Watch, « l’État empiète systématiquement sur la sphère privée de ses citoyen-ne-s et la communication à travers le web est strictement contrôlée ». Parmi ces huit détenus – militants politiques ou défenseurs des droits de l’homme figure Mohammed al Roken, membre d’Amnesty International.
Arabie Saoudite
![]() Personne présente : Abdallah Ben Zayed Al-Nahyane, ministre des Affaires étrangères
Personne présente : Abdallah Ben Zayed Al-Nahyane, ministre des Affaires étrangères
Lorsque tout est interdit, contrôlé et réprimé, il est difficile de parler d’information. Si le journalisme existe, en théorie, la liberté d’expression n’est pas tolérée. Les associations indépendantes et les manifestations sont interdites en Arabie Saoudite. L’apostasie est passible de la peine de mort. Chez les journalistes, l’auto-censure fait des ravages. Pour les autres : emprisonnements, actes de torture, violences… Au moins deux journalistes et huit net-citoyens seraient actuellement incarcérés. Des prisonniers d’opinions muselés et torturés, comme l’est encore le blogueur Raif Badawi, déjà flagellé publiquement, toujours dans l’attente de nouveaux coups de fouet. Si une présence militante et pacifique existe bien sur la toile, elle est contrôlée de très très près par le régime.
Israël
![]() Personne présente : Benyamin Netanyahou, Premier ministre
Personne présente : Benyamin Netanyahou, Premier ministre
Le 25 septembre 2015, deux journalistes de l’AFP en reportage en Cisjordanie ont été sauvagement agressés par des soldats israéliens. Un cas loin d’être isolé, selon Reporters sans frontières qui dénonce la multiplication en 2015 des exactions de l’armée et de la police israéliennes à l’encontre de journalistes. En 2015, Israël a dégringolé de cinq rangs dans le classement mondial de la liberté de la presse de l’ONG, s’installant à la 101e place (sur 180). Au moins trois stations de radios palestiniennes ont été fermées – accusées de « promouvoir et encourager le terrorisme contre les civils et les forces de sécurité israéliennes ». Un tribunal israélien a confirmé en septembre l’assignation à résidence surveillée à Mordechai Vanunu, lanceur d’alerte sur les questions du nucléaire – bien qu’il ait déjà purgé une peine de 18 ans d’emprisonnement. Par ailleurs, un roman traitant d’une histoire d’amour entre une Israélienne et un Palestinien a été retiré des programmes scolaires par le gouvernement conservateur de Netanyahou. Il ne faudrait pas encourager les couples mixtes…
Égypte
![]() Personne présente : Sameh Shoukry, ministre des Affaires étrangères
Personne présente : Sameh Shoukry, ministre des Affaires étrangères
En septembre dernier, le président Abdel Fattah Al-Sissi affirmait sur CNN que l’Égypte jouissait désormais d’une liberté d’expression « sans précédent ». On rit jaune. Pour rappel, l’Égypte plafonnait en 2015 à la 158e place (sur 180) du classement de Reporters sans frontières (RSF). Selon un communiqué du Comité de protection des journalistes, basé à New York, seule la Chine a emprisonné plus de journalistes en 2015 que ce « paradis de la liberté d’expression » autoproclamé. En août, une nouvelle loi est venue entamer un peu plus cette liberté, en imposant une amende particulièrement lourde aux journalistes et médias qui contrediraient les communiqués et bilans officiels en cas d’attentats.
Tunisie
![]() Personne présente : Mehdi Jomâa, ancien chef du gouvernement provisoire
Personne présente : Mehdi Jomâa, ancien chef du gouvernement provisoire
Empêchés de couvrir certains événements, des dizaines de journalistes ont, cette année encore, été agressés par les forces de police. Frappés, insultés et menacés ils sont aussi la cible de procès abusifs, souvent poursuivis sur la base du code pénal, au lieu du code de la presse. De multiples interpellations et jugements ont également été prononcés à l’encontre de blogueurs, d’acteurs de l’information ou de militants. Les organisations dénoncent aussi des ingérences de l’exécutif dans le secteur médiatique.
Togo
![]() Personne présente : Faure Gnassingbé, président de la République
Personne présente : Faure Gnassingbé, président de la République
Le très contesté Faure Gnassingbé ne fait pas de la liberté d’expression une priorité, malgré sa présence à la marche républicaine du 11 janvier 2015. Cette année encore, des sites d’information indépendants ont été suspendus par le gouvernement, bloquant les activités de l’opposition et la parole des contestataires remettant en question les dernières élections présidentielles. Le journaliste Bonéro Lawson-Betum a également été arrêté en mai dernier, son matériel saisi et son domicile perquisitionné.
Sénégal
![]() Personne présente : Macky Sall, président de la République
Personne présente : Macky Sall, président de la République
Alors que le Sénégal était l’un des pays de la région où la liberté de la presse était la mieux établie selon RSF, le contexte sécuritaire et la menace terroriste servirait de prétexte à un contrôle accru sur le secteur. Les organisations de défense des médias ont également dénoncé dans l’année l’utilisation « récurrente du délit d’offense au Chef de l’État, la criminalisation des expressions critiques et l’emprisonnement systématique d’opposants politiques ».
Gabon
![]() Personne présente : Ali Bongo Ondimba, président de la République
Personne présente : Ali Bongo Ondimba, président de la République
« Depuis l’arrivée au pouvoir du président Ali Bongo Ondimba en 2009, la liberté d’expression et la liberté de la presse n’ont jamais été aussi importantes au Gabon », clame le site Stop Kongossa, lancé en juillet 2015 par l’équipe du président pour contrer les rumeurs et « rétablir la réalité des faits ». Alors certes, le Gabon, 95e sur 180 au classement 2015 de Reporters sans frontières, respecte la liberté d’expression bien plus que son voisin camerounais (133e), mais y a-t-il vraiment de quoi se rengorger ? En 2015, un journaliste a fui le pays, affirmant être victime de menaces de mort, un autre a été détenu par la police militaire et le ministre de la communication a été critiqué pour des velléités d’ingérences médiatiques.
Niger
![]() Personne présente : Mahamadou Issoufou, président de la République
Personne présente : Mahamadou Issoufou, président de la République
Si la Constitution donne le droit aux citoyens d’user de leur liberté d’expression et que les délits de presse ont été dépénalisés, cette liberté reste soumise à conditions. La société civile et les journalistes dénoncent des arrestations arbitraires et l’utilisation de nombreuses mesures d’intimidation visant à faire taire les voix qui s’élèvent. Tour à tour accusés de « démoraliser les troupes », ou assimilés à des terroristes, les membres d’organisations citoyennes peuvent être inculpés grâce à une loi liberticide sous couvert d’anti-terrorisme. Moussa Tchangari, secrétaire général d’une l’ONG, a été arrêté, accusé « d’association de malfaiteurs en relation avec une entreprise terroriste », libéré, puis inculpé pour « atteinte à la défense nationale ». Ces procédures ont été engagées après que le militant ait dénoncé les conditions d’évacuation des réfugiés du lac Tchad, zone infiltrée par Boko Haram, où de nombreuses personnes ont trouvé la mort. Les médias sont eux aussi la cible de violences. Au moins cinq journalistes ont été emprisonnés tandis que d’autres ont été inculpés et empêchés de couvrir des événements.
Tchad
![]() Personne présente : Idriss Deby Itno, président de la République
Personne présente : Idriss Deby Itno, président de la République
Lorsque la famille présidentielle est visée par les médias, elle prend des mesures. La présidence tchadienne est ainsi accusée par RSF d’instrumentaliser la justice afin de censurer les journalistes. Certaines décisions vont jusqu’à la fermeture de l’organe de presse concerné, comme ce fut le cas de l’hebdomadaire Abba Garde. Les journalistes sont également harcelés à titre personnel, poursuivis pour diffamation, ou mis en garde à vue – bien que les restrictions de liberté ne soient pas légales en cas de délit de presse. Pour avoir critiqué le gouvernement, le directeur de la publication du Haut Parleur a plusieurs fois été poursuivi par la famille Déby, notamment Salay, le frère du président qui occupe le poste de directeur général des douanes. Le journaliste Stéphane Mbaïrabé Ouaye a lui été tabassé dans un commissariat en octobre afin qu’il révèle ses sources.
Actualisation à 18h02 :
« Et la France ? » Cette question revenant dans les commentaires et sur les réseaux sociaux, nous ajoutons ce lien, résumant la situation française :
Retrouvez les articles de Rue 89 sur les libertés publiques en France