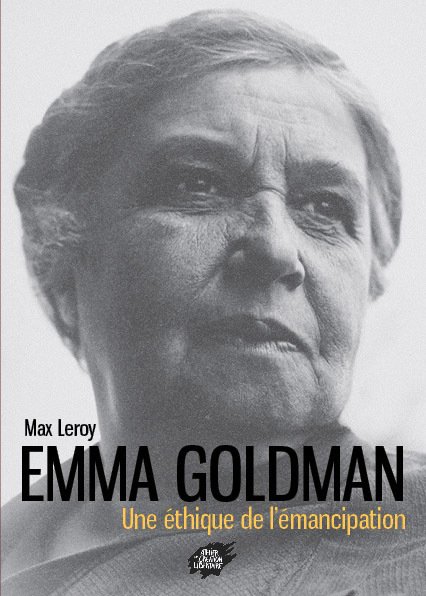Si je prends la parole, ce n’est pas pour me défendre des actes dont on m’accuse, car seule la société, qui par son organisation met les hommes en lutte continuelle les uns contre les autres, est responsable.
En effet, ne voit-on pas aujourd’hui dans toutes les classes et dans toutes les fonctions des personnes qui désirent, je ne dirai pas la mort, parce que cela sonne mal à l’oreille, mais le malheur de leurs semblables, si cela peut leur procurer des avantages. Exemple : un patron ne fait-il pas des vœux pour voir un concurrent disparaître ; tous les commerçants en général ne voudraient-ils pas, et cela réciproquement, être seuls à jouir des avantages que peut rapporter ce genre d’occupations ?
L’ouvrier sans emploi ne souhaite-t-il pas, pour obtenir du travail, que pour un motif quelconque celui qui est occupé soit rejeté de l’atelier ? Eh bien, dans une société où de pareils faits se produisent on n’a pas à être surpris des actes dans le genre de ceux qu’on me reproche, qui ne sont que la conséquence logique de la lutte pour l’existence que se font les hommes qui, pour vivre, sont obligés d’employer toute espèce de moyen.
Et, puisque chacun est pour soi, celui qui est dans la nécessité n’en est-il pas réduit a penser :
« Eh bien, puisqu’il en est ainsi, je n’ai pas à hésiter, lorsque j’ai faim, à employer les moyens qui sont à ma disposition, au risque de faire des victimes ! Les patrons, lorsqu’ils renvoient des ouvriers, s’inquiètent-ils s’ils vont mourir de faim ? Tous ceux qui ont du superflu s’occupent-ils s’il y a des gens qui manquent des choses nécessaires ? »
Il y en a bien quelques-uns qui donnent des secours, mais ils sont impuissants à soulager tous ceux qui sont dans la nécessité et qui mourront prématurément par suite des privations de toutes sortes, ou volontairement par les suicides de tous genres pour mettre fin à une existence misérable et ne pas avoir à supporter les rigueurs de la faim, les hontes et les humiliations sans nombre, et sans espoir de les voir finir.
Ainsi ils ont la famille Hayem et le femme Souhain qui a donné la mort à ses enfants pour ne pas les voir plus longtemps souffrir, et toutes les femmes qui, dans la crainte de ne pas pouvoir nourrir un enfant, n’hésitent pas à compromettre leur santé et leur vie en détruisant dans leur sein le fruit de leurs amours. Et toutes ces choses se passent au milieu de l’abondance de toutes espèces de produits ! On comprendrait que cela ait lieu dans un pays où les produits sont rares, où il y a la famine.
Mais en France, où règne l’abondance, où les boucheries sont bondées de viande, les boulangeries de pain, où les vêtements, la chaussure sont entassés dans les magasins, où il y a des logements inoccupés !
Comment admettre que tout est bien dans la société, quand le contraire se voit d’une façon aussi claire ?
Il y a bien des gens qui plaindront toutes ces victimes, mais qui vous diront qu’ils n’y peuvent rien.
Que chacun se débrouille comme il peut !
Que peut-il faire celui qui manque du nécessaire en travaillant, s’il vient à chômer ? Il n’a qu’à se laisser mourir de faim. Alors on jettera quelques paroles de pitié sur son cadavre.
C’est ce que j’ai voulu laisser à d’autres. J’ai préféré me faire contrebandier, faux monnayeur, voleur, meurtrier et assassin. J’aurais pu mendier : c’est dégradant et lâche et c’est même puni par vos lois qui font un délit de la misère. Si tous les nécessiteux, au lieu d’attendre, prenaient où il y a et par n’importe quel moyen, les satisfaits comprendraient peut-être plus vite qu’il y a danger à vouloir consacrer l’état social actuel, où l’inquiétude est permanente et la vie menacée à chaque instant.
On finira sans doute plus vite par comprendre que les anarchistes ont raison lorsqu’ils disent que pour avoir la tranquillité morale et physique, il faut détruire les causes qui engendrent les crimes et les criminels : ce n’est pas en supprimant celui qui, plutôt que de mourir d’une mort lente par suite des privations qu’il a eues et aurait à supporter, sans espoir de les voir finir, préfère, s’il a un peu d’énergie, prendre violemment ce qui peut lui assurer le bien-être, même au risque de sa mort qui ne peut être qu’un terme à ses souffrances.
Voilà pourquoi j’ai commis les actes que l’on me reproche et qui ne sont que la conséquence logique de l’état barbare d’une société qui ne fait qu’augmenter le nombre de ses victimes par la rigueur de ses lois qui sévissent contre les effets sans jamais toucher aux causes ; on dit qu’il faut être cruel pour donner la mort à son semblable, mais ceux qui parlent ainsi ne voient pas qu’on ne s’y résout que pour l’éviter soi-même.
De même, vous, messieurs les jurés, qui, sans doute, allez me condamner à la peine de mort, parce que vous croirez que c’est une nécessité et que ma disparition sera une satisfaction pour vous qui avez horreur de voir couler le sang humain, mais qui, lorsque vous croirez qu’il sera utile de le verser pour assurer la sécurité de votre existence, n’hésiterez pas plus que moi à le faire, avec cette différence que vous le ferez sans courir aucun danger, tandis que, au contraire, moi j’agissais aux risque et péril de ma liberté et de ma vie.

Eh bien, messieurs, il n’y a plus de criminels à juger, mais les causes du crime a détruire. En créant les articles du Code, les législateurs ont oublié qu’ils n’attaquaient pas les causes mais simplement les effets, et qu’alors ils ne détruisaient aucunement le crime ; en vérité, les causes existant, toujours les effets en découleront. Toujours il y aura des criminels, car aujourd’hui vous en détruisez un, demain il y en aura dix qui naîtront.
Que faut-il alors ? Détruire la misère, ce germe de crime, en assurant à chacun la satisfaction de tous les besoins ! Et combien cela est facile à réaliser ! Il suffirait d’établir la société sur de nouvelles bases où tout serait en commun, et où chacun, produisant selon ses aptitudes et ses forces, pourrait consommer selon ses besoins.
Alors on ne verra plus des gens comme l’ermite de Notre-Dame-de-Grâce et autres mendier un métal dont ils deviennent les esclaves et les victimes ! On ne verra plus les femmes céder leurs appas, comme une vulgaire marchandise, en échange de ce même métal qui nous empêche bien souvent de reconnaître si l’affection est vraiment sincère. On ne verra plus des hommes comme Pranzini, Prado, Berland, Anastay et autres qui, toujours pour avoir de ce métal, en arrivent à donner la mort ! Cela démontre clairement que la cause de tous les crimes est toujours la même et qu’il faut vraiment être insensé pour ne pas la voir.
Oui, je le répète : c’est la société qui fait les criminels, et vous jurés, au lieu de les frapper, vous devriez employer votre intelligence et vos forces à transformer la société. Du coup, vous supprimeriez tous les crimes ; et votre œuvre, en s’attaquant aux causes, serait plus grande et plus féconde que n’est votre justice qui s’amoindrit à punir les effets.
Je ne suis qu’un ouvrier sans instruction ; mais parce que j’ai vécu l’existence des miséreux, je sens mieux qu’un riche bourgeois l’iniquité de vos lois répressives. Où prenez-vous le droit de tuer ou d’enfermer un homme qui, mis sur terre avec la nécessité de vivre, s’est vu dans la nécessité de prendre ce dont il manquait pour se nourrir ? J’ai travaillé pour vivre et faire vivre les miens ; tant que ni moi ni les miens n’avons pas trop souffert, je suis resté ce que vous appelez honnête. Puis le travail a manqué, et avec le chômage est venue la faim. C’est alors que cette grande loi de la nature, cette voix impérieuse qui n’admet pas de réplique, l’instinct de la conservation, me poussa à commettre certains des crimes et délits que vous me reprochez et dont je reconnais être l’auteur.
Jugez-moi, messieurs les jurés, mais si vous m’avez compris, en me jugeant jugez tous les malheureux dont la misère, alliée à la fierté naturelle, a fait des criminels, et dont la richesse, dont l’aisance même aurait fait des honnêtes gens !
Une société intelligente en aurait fait des gens comme tout le monde !
Ravachol
Mort guillotiné le 11 juillet 1892
1] Cette déclaration qui parut dans La Révolte n°40 (1-7 juillet 1892) et Le Père Peinard n°172 du 3-10 juillet 1892, a été reprise par Zanzara athée sur le site Infokiosques.net
Source : Rebellyon Info 11/07/2016
Voir aussi : Actualité France, Rubrique Histoire, rubrique Politique, rubrique Société,