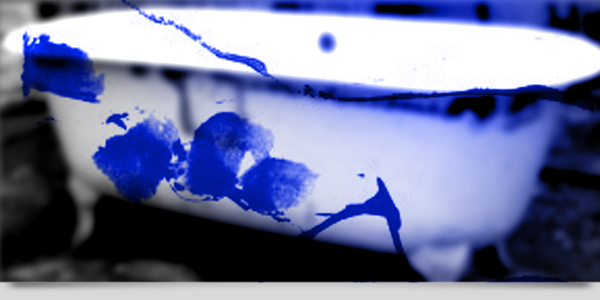Par Jean-Marie Dinh
Petites collisions entre têtes chercheuses
Jean-Paul Montanari qui va bientôt fêter ses 70 ans, est directeur du festival international Montpellier Danse dont il assume la responsabilité depuis 1983 avec puis sans ses fondateurs, Georges Frêche pour le politique, et Dominique Bagouet pour l’artistique. Depuis l’éclosion de la danse contemporaine en France, au début des années 1980, il traque les évolutions de l’art chorégraphique. Son nom est indissociable du développement culturel de Montpellier. Il a toujours soutenu la création.
Né à Buenos Aires en 1964, Rodrigo Garcia est un artiste de la désacralisation dans la lignée de Heiner Müller. Il consacre son écriture au théâtre qu’il met à l’épreuve du temps présent en faisant exploser les codes traditionnels de l’espace théâtral. Sa réflexion n’est pas cynique, elle déroule le scénario de tous nos renoncements. Sa langue et sa pratique du plateau le portent comme une des voix qui renouvellent la scène européenne.
Rodrigo Garcia a été nommé directeur du CDN de Montpellier qu’il a rebaptisé «hTh», pour la référence nietzschéenne à Humain trop humain. Il quittera Montpellier à la fin de l’année au terme d’une mandature unique boudée par les enseignants, les élus et les médias locaux.
Simple présence
Cet entretien croisé et informel avec deux figures de la culture montpelliéraine qui n’ont plus rien à prouver, apparaît comme une forme de préavis au désordre ambiant. Jean-Paul Montanari et Rodrigo Garcia s’expriment dans le bureau où il se sont rencontrés la première fois il y a quatre ans pour évoquer un bout de chemin parcouru ensemble, et confronter leur regard sur la danse et le théâtre d’aujourd’hui.
Tout deux s’émancipent de la culture au sens où l’entend Jean-Luc Godard : « La culture c’est la règle, l’art c’est l’exception.» Ce que l’on apprend parfois à nos dépens lors d’un spectacle vivant mais qui offre aussi la garantie d’un égal accès à tous, par la simple présence corporelle.
» LES CHOSES QUE NOUS AVONS A FAIRE…SOUTENIR LA CREATION SAUVAGE «
Entretien
La rencontre entre Rodrigo Garcia et Jean-Paul Montanari a lieu la veille de la pièce de Boris Charmatz «Danser la nuit» donnée dans la rue à Montpellier. Rodrigo arrive de Madrid, où il a vu avec inquiétude des drapeaux flotter aux fenêtres, il est en pleine phase de création...
Dans quelles circonstances vous êtes vous rencontrés pour la première fois ?
R.G. Je m’en souviens parfaitement. C’était lorsque je me suis retrouvé sur la short list au moment des nominations. J’ai pris ma voiture depuis les Asturies, je suis arrivé jusqu’ici. Il fallait que je rencontre plusieurs personnes parmi lesquelles ce monsieur. Je me souviens aussi de la rencontre avec François Duval (conseiller DRAC). Après coup, ça s’est très bien passé avec lui, il m’a beaucoup épaulé, mais au début il m’a dit: «Toi, tu vas venir au CDN, c’est une blague ou quoi ! » A l’inverse, Jean Paul m’a dit : cela serait merveilleux si tu étais là.
J.-P.M. Il y avait ces deux visions. D’un côté la vision politique et sociale, avec la difficulté, croyait-on, d’absorber un artiste pareil, et de l’autre, le moment jouissif d’apprendre qu’un tel artiste pouvait venir dans la ville. Deux aspects que Rodrigo incarne à travers son travail et sa personnalité.
Et aujourd’hui quel regard portez-vous mutuellement l’un sur l’autre ?
R.G. Au moment de notre rencontre il y a eu une tornade. J’ai appris dans le journal que le maire pouvait écarter Jean-Paul.
J.-P.M. Tu as raison (Rires). C’est la pure vérité. Entre temps, de l’eau a coulé sous les ponts et aujourd’hui la situation n’est heureusement plus la même. Les choses que nous avons à faire ensemble ont toujours été claires, c’est le soutien à la créativité, la plus sauvage…pourrait-on dire. C’est-à-dire, la moins convenue, la plus vraie possible. Il existe une complicité entre lui et moi qui fait que par exemple, j’ai follement envie de programmer des gens comme Steven Cohen, ce genre d’artistes, les plus pointus… Ceux qui vont le plus loin dans leur expérience personnelle.
Et qui sont, la plupart du temps, les plus destructeurs de liens. Nous avons ce point là en commun. J’ai appris il y a longtemps l’opposition profonde qui existe entre l’art et la culture. La fonction de l’artiste dissout le lien social, elle renvoie l’individu à lui-même, alors que la culture fait exactement le contraire. Elle relie les gens les uns aux autres, le monde aux individus… C’est dans cette tension que notre histoire se fabrique. Si un des deux pôles est abandonné on est foutu, mais si l’on sait tenir les deux pôles en même temps, alors on arrive peut-être à construire quelque chose.
R.G. L’important c’est de soutenir des artistes qui développent un langage personnel. Il ne s’agit pas simplement de radicalité ou de trash. Il ne faut pas confondre. Moi je n’aime pas la violence. Dans ce domaine de l’art révolutionnaire, nous avons tous deux soutenu des artistes confirmés comme Jan Fabre et des nouveaux, la jeune génération, comme Luis Garay.
Peut-on parler d’enrichissement réciproque à propos de votre relation ?
J.-P. On est plus dans la complicité. J’ai toujours accepté ce qu’il pouvait dire, parce que c’est lui l’artiste. Moi je ne suis là que pour faire marcher la machine. Je suis le plus ancien dans cette relation aussi, le plus solide parce que je m’appuie sur une expérience, une longue présence dans la ville, sur des budgets consolidés, Alors que quand Rodrigo est arrivé, il ne connaissait pas la ville. C’était à moi d’aller vers lui, de l’accueillir, à moi de lui dire : viens, on va faire un bout de chemin ensemble, tu peux compter sur moi dans tes expériences les plus folles, les plus radicales.
Pour les propositions qui sont assez avancées, c’est bien d’être deux, pour additionner nos puissances de communication, nos publics et nos financements. On est plus fort ensemble. Cette année, nous co-accueillons Boris Charmatz pour un spectacle de rue, la dernière création de Jan Fabre et celle de Raimund Hoghe.
On vous qualifie d’écrivain de plateau, en rupture avec la tradition française très texto-centrée. Travailler le plateau comme vous le faites englobe à la fois la fonction d’auteur et de metteur en scène…
R.G. La question tombe à pic parce que j’ai passé la matinée à me battre contre mon texte. Je travaille beaucoup sur mon matériel textuel et le problème de ma vie, celui de tous les jours, est de savoir ce que je fais de ce texte. Il peut, éventuellement être bien écrit, mais qu’en faire sur scène ? (soupirs renouvellés)…
A un moment, je te jure que je me suis même dit : je vais faire la pièce que je veux sur la scène et puis j’écrirai un petit texte que je photocopierai pour le distribuer au public. Parce que je ne suis pas capable de porter mon propre texte à la scène. Mais ce n’est pas un problème nouveau, cela fait trente ans que c’est comme ça. Le théâtre, ce n’est pas la littérature.
Silence…
J.-P.M. J’aurai passé plus de cinquante ans de ma vie à écouter ce silence là. Je suis très très ému d’entendre un artiste parler de sa matière comme ça… Pour moi, il n’y a que ça qui compte. Dans ma vie, il n’y a rien d’autre. Ni les budgets, ni rien du tout. Il n’y a que la question de cet acte irrépressible qu’est l’acte artistique…
Après on est plus ou moins malin, on cherche des budgets, on séduit les politiques, on dit des choses intelligentes aux journalistes etc… Mais tout ça, c’est juste pour le reste. Il n’y a que ça. Donc, si on est complice, vous entendez ce silence ..? Et bien, c’est ce silence qui est plus important que tout.
Au moment où les genres artistiques s’affranchissent pour rejoindre la scène, le décloisonnement semble profiter davantage au théâtre qu’à la danse…
J.-P.M. Lorsque le festival de danse a été créé, il y a un peu plus de trente ans, c’était la danse qui était porteuse de modernité sur les arts de la scène. Les Américains avaient défriché un énorme champ, une nouvelle génération se levait en France… Bref, c’était une période où les idéologies étaient très en retrait. Durant les années post 68, elles ont reculé au profit de choses plus individuelles, plus axées sur des questions autours du corps.
Et je pense sincèrement que depuis quelques années, qui correspondent à un retour radical du politique, le balancier est reparti dans l’autre sens. C’est dorénavant sur les scènes de théâtre que se règlent les choses de la modernité. De Rodrigo à Castellucci en passant par Ostermeier et d’autres, le théâtre est redevenu porteur de la réalité comme il avait pu l’être à une certaine époque.
La danse est plus consensuelle, elle est devenue grand public. Aujourd’hui, c’est au théâtre que les formes se mêlent. Rodrigo en est un exemple, il évoque sans arrêt la question du corps du désir. C’est pour cela qu’il est très intéressé par la danse tout en continuant à écrire et en faisant du théâtre à partir de ces matériau-là.
Comment appréhendez-vous la place du corps sur la scène ?
R.G. Mon rapport à la place du corps sur scène a à voir avec mes souvenirs d’enfance. J’ai grandi dans une banlieue de merde. Du coup, les corps que je voyais. C’était des corps avec des cicatrices, parce que les enfants ne mettaient pas de protection pour faire du vélo. Des corps forts aussi, des corps qui doivent charger des poids lourds, ou des corps déformés par la mauvaise qualité de la nourriture. Les gens mangeaient du riz, des patates, des choses grasses. Et quand je vois un corps sur scène, j’aime voir quelque chose qui me rappelle tout ça.
Où avez-vous grandi ?
R.G. Dans une petite banlieue en Argentine, presque une favela qui s’appelait Grand bourg, un nom français qui laissait entendre que c’était chic. En réalité c’était une forme de favela horrible avec des maisons en carton. A 45 minutes en train de Buenos aires dans la grande banlieue. J’habitais là c’était hyper dur. J’évoque des choses négatives mais je peux aussi parler des corps quand on jouait au foot sous la pluie. On aimait jouer dans la boue, ça aussi j’aime toujours, ce sont des choses qui apparaissent dans mes pièces. Je n’ai pas un rapport intellectuel au corps. Je fais appel à ma mémoire.
Le corps artistique dans l’espace public prend-t-il une autre dimension notamment parce qu’il peut contraster en tant que corps singulier avec le corps social ?
J.-P.M. C’est une question qu’il faut poser à Boris Charmatz. Moi, je reste attaché au travail sur le plateau, aux gens assis dans la salle avec la lumière qui baisse pour monter sur le plateau. Ce sont des rites ancestraux et archaïques auxquels je tiens beaucoup. Mais d’autres en ont décidé autrement et notamment Boris. Il pose un certain nombre de questions autour de la notion d’oeuvre, la notion d’espace y compris la nuit tombée. Ce sont les danseurs qui portent la lumière et qui se déplacent dans les espaces urbains suivis par les « spectateurs » qui eux-mêmes font partie de l’image du spectacle puisqu’ils sont dans le champ et pas à l’extérieur.
R.G. Je partage en partie ce que vient de dire Jean-Paul parce que moi en tant qu’artiste j’ai besoin de la salle et dans ce sens là, je suis classique. Je pense que pour Boris, le fait de sortir dans la rue est quelque chose de très important. Du point de vue de sa propre trajectoire artistique.
Qu’est ce qui fait la pertinence d’une création dans notre société aujourd’hui ?
J.-P.M. Quand à un certain moment devant une œuvre, on ne regarde plus le monde de la même manière. Lorsqu’on constate en sortant que le monde a changé. Cela veut dire que l’oeuvre était exactement au bon endroit pour produire une modification du regard sur le réel.
R.G. Je n’ai jamais pensé aux conséquences que pouvait avoir mon œuvre. J’ai simplement la nécessité de faire. J’éprouve beaucoup de plaisir à faire ça. Ensuite ce qui se passe, je ne sais pas. Chacun cherche une façon de vivre. Une façon de continuer à être vivant. Si je ne trouve pas quelque chose qui m’enthousiasme, je ne veux pas vivre. Il y a un moment pour faire la pièce, pour la créer. C’est ce moment qui me fait vivre.
Source : La Marseillaise 07 octobre 2017
Voir aussi : Rubrique Théâtre, rubrique Danse,rubrique Rencontre,