En se fédérant, les syndicats de différents pays européens tentent de contraindre Orpea, groupe français leader du service aux personnes âgées, d’améliorer les salaires et des conditions de travail souvent désastreuses. Illustration en France et à Berlin, alors que les salariés belges ont annoncé une grève à partir du 8 novembre.
La France peut fanfaronner, elle héberge les sièges des « leaders européens » de la prise en charge de la dépendance des personnes âgées et, parmi eux, le groupe Orpea. Avec plus de 850 établissements, Ehpad ou cliniques, implantés dans treize pays d’Europe, Orpea est l’un des deux champions bleu, blanc, rouge des maisons de retraite et des centres de rééducation, presque à égalité avec le groupe Korian, lui aussi français.
Le groupe au taux de croissance à deux chiffres a cependant sa part d’ombre, accusé en 2015 d’avoir espionné ses salariés, en particulier ses représentants syndicaux (une affaire que Mediapart a révélée ici), ou encore de tirer sur les coûts, avec des conséquences parfois dramatiques pour les résidents ou les personnels. L’entreprise a même tenté récemment de faire interdire la diffusion d’une enquête de l’émission « Envoyé spécial » sur les Ehpad, dans laquelle son image est sévèrement écornée. Partout en Europe, le groupe est aujourd’hui contesté, et des mouvements de salariés se multiplient dans la jachère syndicale que constitue le secteur des services à la personne.

Une atmosphère de fête à la résidence ORPEA Château Notre Dame
En France, Orpea s’est encore récemment illustré par sa conception toute particulière du dialogue social. Le 4 septembre, une partie du personnel de la clinique La Pinède, à Saint-Estève, dans les Pyrénées-Orientales, propriété de la filiale Clinea du groupe Orpea, s’est mise en grève pour protester contre le manque d’effectifs et de matériel. Leurs collègues de la clinique Clinea de Collioure leur ont emboîté le pas une semaine plus tard, pour les mêmes motifs.
Devant les deux établissements se sont rassemblés des aides-soignantes, des kinésithérapeutes, des secrétaires, des cuisiniers, pour un mouvement rassemblant les syndicats CGT et CDFT. Mais dès le début du conflit, les grévistes ont déchanté : « Nous avons vu, passant devant nous, des gens d’Auxerre, de Marseille, Paris, venus pour nous remplacer, raconte, encore ahurie, Magali Martinez, aide-soignante et déléguée syndicale CGT de la clinique La Pinède. Ces salariés arrivaient tous frais payés pour le déplacement, l’hôtel, et étaient rémunérés en heures supplémentaires… » Une pratique confirmée par cet article de L’Humanité.
À Collioure, même méthode pendant les quinze jours que va durer le conflit. « Ce n’est pas totalement illégal puisqu’il s’agit des salariés du même groupe, mais complètement amoral, remarque Philippe Gallais, ancien délégué central sur la branche Clinea du groupe Orpea. En clair, ça veut dire casser la grève. » De fait, au bout de deux semaines, les salariés cessent leur mouvement, sans rien avoir obtenu ni même signé un protocole d’accord. Orpea n’a répondu à aucune de nos questions sur ce conflit.
« Financièrement, vu le montant de nos salaires, ce n’est pas tenable plus longtemps, les gens ont commencé à rentrer petit à petit au boulot », explique Magali Martinez qui, avec 25 ans d’ancienneté et travaillant la nuit et deux dimanches par mois, gagne 1 400 euros mensuels. Depuis le mouvement et malgré son mandat, elle est désormais interdite d’accès au comité d’établissement de la clinique, ce qu’elle conteste devant le tribunal administratif.
En Allemagne, des grévistes interdits de remettre les pieds dans l’établissement
L’entreprise est bousculée bien au-delà des frontières du pays de son fondateur, le multimillionnaire français Jean-Claude Marian. Outre-Rhin, dans la clinique de réhabilitation de Bad Langensalza, en Thuringe, gérée par la société allemande Celenus, propriété du groupe Orpea, le conflit social sur les salaires est permanent depuis 2015, mais s’est enflammé ce printemps, avec une succession de grèves et de débrayages.
La physiothérapeute employée dans l’établissement Jacqueline Althaus, gréviste, n’a pas l’intention de baisser les bras. Mais le mutisme récurrent de la direction de la clinique commence à lui peser. « Cette semaine, nous leur avons encore proposé, comme preuve de notre bonne volonté, de reprendre le travail en échange de la reprise des négociations sur les salaires. Leur réponse a été d’exiger des entretiens individuels, tout en refusant une négociation collective. Et cinq d’entre nous se sont vu renouveler l’interdiction de mettre les pieds dans l’enceinte de l’établissement. »
Le problème des salaires existe presque depuis la création de la clinique, en 1998. La situation s’améliore en 2013 quand le gouvernement fédéral vote l’introduction d’un salaire minimum universel de 8,80 euros de l’heure. La clinique de Bad Langensalza est rachetée en 2015 par le groupe Celenus, constitué depuis 2010 à partir de multiples rachats par des investisseurs financiers allemands et internationaux, et qui compte alors une vingtaine d’établissements.
Mais à peine la clinique thuringienne a-t-elle intégré Celenus que celui-ci est vendu à son tour au français Orpea, qui détient aujourd’hui 124 établissements en Allemagne : « À part un accord-cadre sur les conditions de travail signé au niveau de Celenus en 2016, nous n’avons jamais rien pu obtenir sur les salaires », explique Jacqueline Althaus, également présidente du comité d’entreprise de la clinique et membre de Verdi, le syndicat des services.
Et les autres « chicaneries » ne manquent pas, à rebours de l’image du dialogue social à l’allemande, censément apaisé : « D’abord, l’employeur a essayé de faire interdire à plusieurs reprises nos mouvements de grève. Mais les tribunaux nous ont donné raison. Par ailleurs, deux collègues membres du CE ont été licenciés sans préavis au printemps dernier pour avoir distribué, en dehors de leurs heures de travail, des prospectus qui avertissaient nos patients qu’une grève allait avoir lieu et pourrait gêner certains services. Finalement, le tribunal régional du travail a décidé, le 17 octobre dernier, que ces licenciements étaient abusifs. Ils vont donc être réintégrés », raconte-t-elle.
« Nous connaissons ce type de réactions contre les salariés et les syndicats dans d’autres établissements et filiales du groupe Orpea. Mais il est difficile de mener un recensement systématique, d’abord parce que le nom même d’Orpea n’est pas toujours connu par les collègues eux-mêmes, mais aussi parce que ce sont souvent des conflits au niveau des établissements et que l’information ne remonte pas toujours », rapporte Astrid Sauermann, porte-parole du syndicat Verdi pour le domaine des cliniques et maisons de retraite.
Dans ce secteur où 70 % des coûts de fonctionnement sont des coûts de personnel, « la seule possibilité de faire monter la rentabilité est de réduire sérieusement ces coûts », explique Wilfried von Eiff, directeur du Centre pour le management des hôpitaux de l’université de Münster : « C’est donc ce que font les investisseurs financiers du secteur. Ils réduisent les salaires mais aussi l’offre de certains services à des niveaux rudimentaires, comme le soin des blessures, la prise quotidienne de médicaments ou le nombre des visites médicales. Il y a une multitude de possibilités, qui aboutissent toutes au même résultat : elles se font au détriment des salariés et de la santé des patients », explique-t-il.
Sur les quatre premiers opérateurs du marché allemand, qui affiche une croissance annuelle moyenne de 5 % avec un chiffre d’affaires d’environ 50 milliards d’euros, un seul groupe est allemand. C’est le numéro 3, Pro Seniore. Pour le reste, le leader est le groupe français Korian, suivi du Alloheim-Gruppe, détenu par le fonds d’investissement américain Carlyle et enfin, en quatrième position… le groupe Orpea. Actuellement, l’Agence fédérale des statistiques recense environ 2,9 millions de personnes âgées demandeuses de soins. Mais à l’horizon de 2030, ce groupe devrait grimper à 3,6 millions de personnes. D’où le calcul des statisticiens d’un besoin minimum d’environ 350 000 aides-soignants supplémentaires d’ici à 2030.
« Toutes les pièces du puzzle se mettent en place » pour une mobilisation européenne
Le problème est connu depuis des années en Allemagne. Avec le vieillissement démographique, les besoins en personnel ne cessent d’augmenter cependant que le salaire et les conditions de travail des aides-soignants stagnent ou régressent. Le nouveau ministre de la santé Jens Spahn a donc décidé de prendre le taureau par les cornes et de lutter contre le dumping salarial, en lançant un grand plan de revalorisation des conditions de travail et de rémunération des aides-soignants.
Pour les salaires, la méthode prévue est de négocier et d’imposer des minima salariaux pour toutes les entreprises du secteur. Mais dans un pays où la définition des salaires est uniquement du ressort des syndicats et des employeurs, la chose ne va pas de soi. Ainsi, pour appliquer la procédure souhaitée par Jens Spahn, encore faudrait-il que les principaux syndicats et fédérations du secteur participent à la discussion. Hélas, la Fédération des opérateurs privés de services sociaux (BPA) a annoncé qu’elle n’avait pas l’intention de s’asseoir à la table des négociations.
En Belgique, même méthode, même réponse : un préavis de grève a été déposé pour le 8 novembre 2018 au sein de trois résidences des trois plus grands groupes exerçant en Belgique, où Orpea et Korian font également office de leaders. Dès le 12 novembre, des grèves tournantes pourraient affecter l’ensemble des maisons de retraite bruxelloises, avertissent les syndicats.
Pour éviter le piège du face-à-face, des syndicalistes de plusieurs pays défendant les salariés d’Orpea commencent donc à s’organiser en tentant de subvertir l’échelon national. « En France, nous sommes totalement bloqués, d’où l’idée de passer par-dessus, souligne Guillaume Gobet, délégué syndical central CGT. Car Orpea a pour politique de ne pas répondre à qui que ce soit. Sur les mouvements de grève récents, j’ai voulu remettre une lettre à la direction des ressources humaines. Il a fallu envahir le siège pour aller dans le bureau de la DRH, pour voir quelqu’un qui a refusé de prendre mon document. Il n’y a aucun dialogue. »
Le 25 septembre, les Allemands et les Belges sont venus soutenir leurs collègues français devant le siège social du groupe, à Paris. Trois jours plus tard, c’est au tour des Français de la CGT de voyager jusqu’à Berlin pour protester contre le sort réservé aux salariés de Celenus et pour soutenir le syndicat Verdi devant le “Medef allemand”. Vendredi 26 octobre 2018, tout ce petit monde – mais aussi des syndicalistes italiens et espagnols – s’est retrouvé pour préparer la création d’un comité d’établissement européen, sorte de CE supranational. Si la négociation aboutit, tout comme le processus identique qui se déroule au sein du groupe Korian, ce serait une grande première pour le secteur, peu syndiqué, employant un important volant de personnel féminin à temps partiel et bas salaire.
L’enjeu ? « Avoir des liens avec les organisations syndicales d’un groupe désormais mondial, insiste Guillaume Gobet, en France. Et avoir une vision globale du groupe, des informations sur l’organigramme, le patrimoine immobilier, les données financières, sur lesquels nous, élus français, nous n’arrivons à avoir aucun regard. » En clair, s’associer pour peser.
Pablo Sànchez, attaché de presse de la European Federation of Public Service Unions (EPSU), assez circonspect sur les velléités de transparence des géants de la dépendance, y voit surtout une manière de se doter de structures représentatives pour ensuite peser sur les législations européennes : « On doit pouvoir créer une ligne minimum décente sur les conditions de travail, le ratio personnel/patient, une sorte d’harmonisation du secteur. Sinon, c’est la concurrence effrénée entre les pays qui s’applique, même au sein d’un même groupe. »
Les mobilisations, spectaculaires comme au printemps dernier en France dans les Ehpad, cet automne dans les cliniques lucratives, en Espagne, l’an dernier, en Italie, en Allemagne ou en Belgique, « montrent que c’est un secteur où les gens sont en train de dire basta ! », ce qui est « remarquable », souligne le représentant de l’EPSU. « Ces mouvements, un peu partout en Europe, en parallèle de la construction d’un comité d’établissement européen, font que toutes les pièces du puzzle se mettent en place sur le sens qu’il y a à lutter ensemble pour les mêmes droits en Europe », insiste Pablo Sànchez.
La dépendance, financée pour une large part par l’argent public mais soumise pour partie à la recherche de croissance des géants de l’or gris, est donc une sorte de laboratoire à ciel ouvert de l’Europe sociale. « À Orpea par exemple, sur le ratio, nous estimons être à 0,47 personnel pour un résident, quand les Ehpad publics sont à 0,6 [personnel], ce qui n’est déjà pas très haut, rappelle Philippe Gallais, ancien délégué central dans la branche Clinea d’Orpea. En Belgique, ils ont des normes ! Une mobilisation collective, à l’échelle européenne, c’est aussi pouvoir mettre en place des minima. Parce que aujourd’hui, la dépendance est devenue un commerce, donc il faut des règles communes pour l’encadrer. »
Mathilde Goanec et Thomas Schnee
Source Médiapart 07/11.2018
voir aussi : VIDEO. Maisons de retraite : derrière la façade
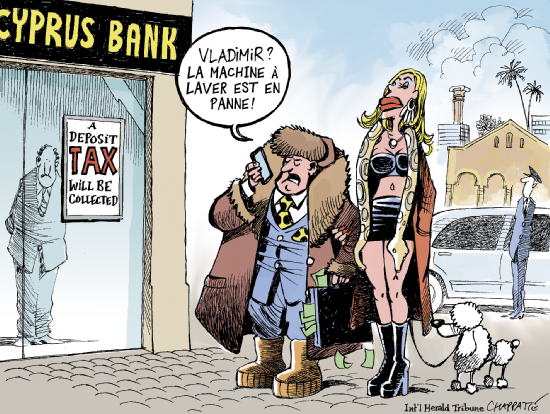
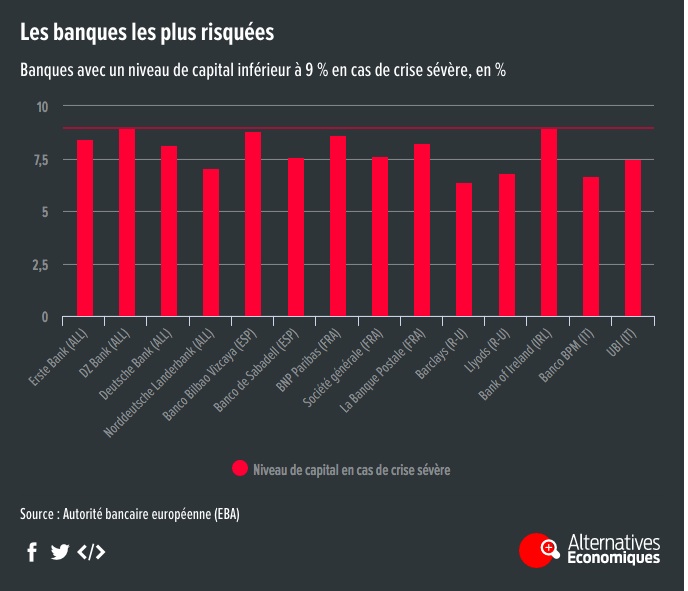

 Avouons-le : c’est
Avouons-le : c’est 
