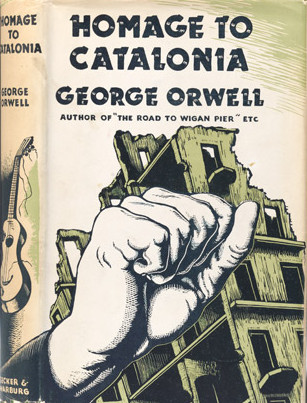Comédie du livre rencontre littéraire. Le cycle de l’association Coeur de livres consacré aux grandes figures littéraires ibériques se conclut avec Serge Mestre autour de Garcia Lorca.
Comédie du livre rencontre littéraire. Le cycle de l’association Coeur de livres consacré aux grandes figures littéraires ibériques se conclut avec Serge Mestre autour de Garcia Lorca.
L’ombre massive du poète dramaturge Gabriel Garcia Lorca n’a pas fini de hanter l’imaginaire collectif. Si l’artiste espagnol fut pour les contemporains du XXe siècle l’emblème de l’écrivain antifasciste – il a signé dès 1933 un manifeste contre l’Allemagne de Hitler et salué l’avènement du Front populaire en 1936 – il est perçu aujourd’hui comme un des grands écrivains de la littérature mondiale. Son oeuvre protéiforme et tumultueuse exprime toujours l’angoisse de l’homme moderne. Au-delà de la légende, la rencontre littéraire organisée ce soir à 19h salle Pétraque avec l’écrivain Serge Mestre par l’association Coeur de livre permettra d’approcher, la vie et la réalité qui transparaît dans son oeuvre notamment politique.
Federico García Lorca naît à Fuente Vaqueros près de Grenade le 5 juin 1898 ; son père s’emploie à faire fructifier ses terres, sa mère est institutrice. La famille s’installe à Grenade où il fait des études de droit, mais surtout de la musique. Ses parents lui interdisant de poursuivre dans cette voie, il bifurque vers la littérature et plus particulièrement la poésie. Durant ses années d’études, Garcia Lorca découvre l’Espagne et commence à écrire Impressions et paysages qu’il publie en 1918. L’année suivante, il écrit et met en scène sa première pièce en vers, El maleficio de la mariposa (Le Maléfice du papillon). Contrairement à ses recueils de poèmes, le texte sera assez mal reçu. Il met en scène l’amour impossible entre un cafard et un papillon et annonce un goût certain pour le fantastique.
A la Résidence des étudiants à Madrid, le jeune Lorca fait des rencontres décisives, comme le futur cinéaste Luis Buñuel… Il compose chansons, romances et poèmes qu’il récite en musique à ses amis. En février 1923, Salvador Dalí intègre la résidence des étudiants. Lorca entretient avec lui une amitié amoureuse. Lorca conquiert sa célébrité grâce à l’accueil triomphal fait à son recueil de chansons et aux représentations de sa pièce Mariana Pineda.
« Lorca est souvent traité comme un poète qui n’aurait pas pris position politique, explique l’écrivain et traducteur Serge Mestre.* « Pourtant, dès l’arrivée de la seconde République espagnole en 1931, Il monte La Barraca, une troupe de théâtre qui tourne dans tout le pays avec la volonté de porter la culture au peuple. Lorca se sert de l’imprégnation populaire de son enfance, reprend des contes et des classiques comme Cervantès ou Calderon pour les rendre accessibles. Il a dans l’idée que c’est à travers l’éducation du peuple, en grande partie analphabète à l’époque, qu’on fera la révolution.»
Artiste complet, le poète engagé se lance aussi des défis artistiques. Il publie Romancero Gitano, un recueil qui tente la transposition en littérature de la méthode musicale de Manuel de Falla et la synthèse entre la poésie populaire de Lope de Vega et le lyrisme précieux de Gongora. En 1930 souffrant d’un mal-être en partie liée à son homosexualité il part pour les Etats-Unis. Il enseigne à la Colombia University, découvre Whitman, et se trouve déconcerté par Harlem et le jazz.
« Il était de tous les combats, indique Serge Mestre qui prépare un livre sur Lorca notamment celui des noirs dont il prend conscience aux Etats-Unis. Il fait d’ailleurs un rapprochement entre celui-ci et le traitement des gitans en Espagne. Lorca est un des premiers morts de la guerre d’Espagne. Il est arrêté par la garde civile franquiste et fusillé juste un mois après le 19 juillet 36 qui marque l’entrée en guerre. Il n’avait que 38 ans. C’est un peu le Rimbaud espagnol.»
L’échec des excavations menées par des archéologues près de Grenade dans le but de retrouver les restes du poète dans une fosse commune coïncide avec le combat mené par l’association espagnole pour la récupération de la mémoire historique. Et valide aussi quelque part, la démarche politique de l’artiste.
Jean-Marie Dinh
* Serge Mestre naît à Castres de parents républicains espagnols et réfugiés en France. Ses premiers livres sont publiés chez Flammarion, dans la collection Textes, au début des années 1980. Puis il se consacre à la traduction de l’espagnol et du catalan. Il a traduit de nombreux auteurs dont Manuel Rivas, Mayra Montero, Fernando Savater, Jorge Semprún, Alejandro Rossi… Il est l’auteur de La Lumière et l’Oubli sélectionné pour le Goncourt (Denoël, 2009 ; Folio, 2011). Les Plages du silence, édition Sabine Wespieser. Serge Mestre travaille actuellement à un livre sur l’engagement de Gabriel Garcia Lorca à paraître chez Sabine Wespieser début 2016.
Source La Marseillaise 29/05.2015
Voir aussi : rubrique Edition, rubrique Lecture, rubrique Littérature, Les grands auteurs classiques ibériques, Littérature Espagnol, rubrique Livres, rubrique Montpellier,