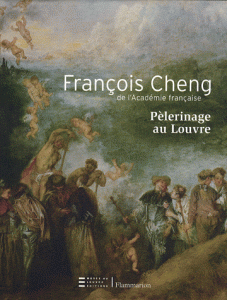En amont de la Comédie du Livre où l’Espagne sera à l’honneur du 22 au 24 mai, le Pavillon Populaire propose un voyage photographique en terre hispanique. Une occasion de découvrir l’Espagne à travers les figures particulières de quinze photographes espagnols.
L’espace de l’exposition se divise en trois parties. En entrant dans la pièce centrale, on accède à l’Espagne contemporaine. Emprunts d’une force émancipatrice, les personnages du Barcelonais Miguel Trillo collent à l’attitude posée, moderne, parfois surjouée, de la movida. A quelques pas de là, Ricky Davila capte l’intégralité de son pays à travers dix portraits que l’on entend respirer. Cette partie de l’exposition provient du Musée d’art moderne de Madrid.
Riche et diversifiée, la matière de l’exposition ouvre sur d’autres perspectives. Certains travaux ayant été spécialement produits pour Montpellier. C’est le cas du travail de Juan Salido dont a été tirée l’affiche. Présent lors du vernissage, le photographe dispose d’une salle où il présente des grands formats consacrés aux mouvements entêtant du flamenco.
En contrepoint de l’Espagne d’aujourd’hui, les côtés du Pavillon offrent un accès aux représentations plus anciennes. Les compositions minutieuses et contrastées de Koldo Chamoro révèlent une certaine inquiétude face à la disparition gokautomaat online de la mémoire. La démarche de l’artiste évoque une volonté ultime de transmission dans une société qui pousse vers l’effacement de la tradition.
A l’étage on découvre le travail hors du commun de Jose Ortiz Echagüe (1886-1980) tant par la forme que dans les représentations. Ingénieur, industriel, et pilote, Jose Ortiz Echagüe échappe à son métier grâce à sa passion pour la photographie. Son travail de picturaliste se distingue par le procédé utilisé basé sur le charbon. On s’attarde volontiers sur les nuances de ses compositions très travaillées et parfaitement distribués dans l’espace.
L’exposition prend en considération les représentations les plus significatives de l’Espagne à la fois urbaine et rurale. Le travail de Fernando Herraez qui s’intéresse aux ferias locales ou celui de Benito Roman sur les nains toréadors pénètre en profondeur la culture hispanique marquée par le génie goyesque.
On s’attarde volontiers sur les nuances et la composition du travail de Jose Ortiz Echagüe