
Bradley Manning à son arrivée sur la base militaire de Fort Meade pour une audition devant une cour militaire, le 18 décembre.
A l’issue d’une année particulièrement riche en agitation médiatique, la liste des cent personnes les plus influentes de 2011 établie par [l’hebdomadaire américain] Time peut paraître un peu bizarre. Pour ne pas dire complètement délirante. Pour des raisons qui m’échappent, les lecteurs du magazine ont fait de Rain, chanteur et acteur sud-coréen, leur numéro un. [La chanteuse] Susan Boyle est troisième, à seulement 43 places devant Barack Obama.
Toutes les listes de ce genre ne sont que de l’esbrouffe divertissante, et celle-là plus encore que les autres. Malgré tout, une charmante juxtaposition la sauve en partie. Le numéro huit est attribué à Bradley Manning, l’homme par qui le scandale est arrivé dans l’armée américaine, aujourd’hui devant ses juges dans le Maryland pour savoir s’il doit passer ou non en cour martiale. Quant à Christopher Hitchens [un journaliste de renom, décédé le 16 décembre], il hérite d’une neuvième place posthume.
Il est certain que « Hitch » s’en serait mieux tiré s’il avait eu la finesse de mourir une semaine plus tôt. Mais de son balcon céleste, peut-être apprécie-t-il la symétrie, et l’asymétrie de son positionnement, juste derrière l’homme dont les fuites militaires et diplomatiques ont été la plus grande gloire de WikiLeaks. Si Hitchens était un fervent partisan de l’aventurisme impérialiste américain alors que Manning en est peut-être le détracteur le plus efficace, beaucoup de choses les rapprochaient. Tous deux fils de pères inaccessibles, ils ont nourri une formidable antipathie pour toute incarnation de l’autorité, jusqu’au Créateur lui-même. Longtemps avant que Hitchens ne rédige Dieu n’est pas Grand [traduit par Ana Nessun, Belfond, 2009], Manning, un athée brillant et convaincu, refusait déjà de faire ses devoirs en instruction religieuse.
Tous deux ont souvent été décrits comme des anticonformistes, capables du meilleur dans leur haine de l’injustice. Et l’un et l’autre avaient une connaissance intime de la torture. Si Hitchens avait choisi de se soumettre au « waterboarding » [pour en faire un article pour Vanity Fair], Manning a pour sa part été involontairement exposé à des formes de torture moins flagrantes mais pas moins répugnantes. Avant qu’il n’en soit libéré sous la pression de l’opinion publique, il avait été enfermé dans une prison brutale, sur la base des Marines de Quantico, en Virginie, condamné à l’isolement 23 heures par jour, privé de sommeil, obligé de se tenir debout et nu pendant les inspections, et sans ses lunettes, autrement dit, littéralement aveugle. Il aurait suffi de lui rajouter un collier pour chien, et il aurait aussi bien pu être une victime de sa collègue Lindie England à Abou Ghraib.
Il n’est pas nécessaire d’avoir été professeur de droit constitutionnel, comme l’était le numéro 46 de la liste du Time [Obama] avant qu’il ne se retrouve dans le Bureau Ovale grâce à sa promesse de mettre un terme aux mauvais traitements infligés aux détenus de la guerre en Irak, pour comprendre que les délicatesses de ce genre tombent sous le coup du passage sur les « peines cruelles et inhabituelles » dans le huitième amendement de la Constitution. Le reconnaître n’est pas le plus difficile.
Le plus difficile, c’est de décider si, en dévoilant certains des aspects les moins reluisants des entreprises militaires américaines, Manning a été un héros, un traître, ou un super-hacker paumé, solitaire et errant, souffrant d’un complexe d’Œdipe et d’une tendance à un narcissisme version « sauveur du monde » à la Julian Assange. Manning avait manifestement des problèmes psychiatriques, comme le savaient ses supérieurs avant qu’il ne commette ce que la cour martiale considèrera inévitablement comme des crimes, ce qui lui vaudra de rester encore longtemps à l’ombre (ce n’est pas parce que personne à la Maison-Blanche, au Pentagone ou au Département d’Etat n’est en mesure de citer ne serait-ce qu’un soupçon de véritable tort porté aux intérêts américains par ces fuites qu’ils vont se priver des joies d’une sentence dissuasive).
Avant que ce soldat du renseignement ne fasse des copies des documents, il avait adressé un courriel à son supérieur immédiat en Irak pour lui signaler que ses problèmes d’identité sexuelle, et la détresse émotionnelle qui en résultait, avaient une influence négative sur sa capacité à analyser les attaques menées par des militants chiites. Il avait même joint à son message une photo de lui habillé en femme. Que, dans ces conditions, Manning ait eu accès à des documents secrets paraît incroyable – cela pourrait même ressembler à un piège.
De toute façon, on ne reviendra jamais assez sur l’incompétence crasse de l’armée américaine qui, après des décennies de guerres catastrophiquement contre-productives, n’est plus à démontrer. Le geste le plus ostensiblement héroïque de Manning, outre les révélations sur la corruption qui ont contribué à balayer le régime tunisien, a été de dévoiler la banalisation de la brutalité à laquelle il a été depuis lui-même soumis, sous une forme moins violente. Si le monde n’avait pas le droit de voir les vidéos de pilotes d’hélicoptères américains en train de mitrailler des civils à Bagdad en gloussant comme des adolescents devant leur console de jeu, qu’a-t-il donc le droit de savoir ? Comme dans tout empire, l’hypocrisie américaine, qui consiste à perpétrer des crimes abominables au nom de la liberté, est trop profondément ancrée dans les mentalités pour que l’on y renonce.
Quel chagrin, pour quiconque éprouve encore une vague admiration pour lui, de constater qu’Obama – qui, osera-t-on penser, a sans doute plus d’influence sur ce genre d’affaires que Susan Boyle – s’est contenté de ne pas lever le petit doigt tandis qu’un jeune homme fragile et chétif se retrouvait couvert de chaînes les rares fois où on le sortait de sa cellule, où il était enfermé sans ses lunettes pour avoir fait la lumière sur une guerre dont l’esprit méphitique continuera de planer longtemps après sa fin officielle, et ce tant que Bradley Manning restera un prisonnier politique.
Matthew Norman (The Independent)
Voir aussi : Rubrique Internet, rubrique Etats-Unis,



 Les Palestiniens ont enregistré lundi 31 octobre à Paris une victoire diplomatique aussi symbolique que significative sur la voie de la reconnaissance de leur Etat, en obtenant le statut de membre à part entière de l’Unesco, l’une des principales agences de l’ONU.
Les Palestiniens ont enregistré lundi 31 octobre à Paris une victoire diplomatique aussi symbolique que significative sur la voie de la reconnaissance de leur Etat, en obtenant le statut de membre à part entière de l’Unesco, l’une des principales agences de l’ONU.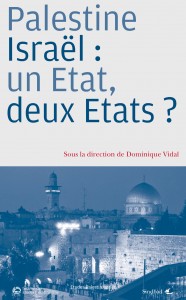 Israël et la Palestine doivent-ils former un, ou deux Etats ? Soulevé dès le début du XXe siècle, ce vieux débat revient au premier plan de l’actualité. Et pour cause : plus de six décennies après le plan de partage de la Palestine (1947), plus de quatre après l’occupation de la Cisjordanie et de Gaza (1967), et près de vingt ans après les accords d’Oslo (1993), Israël continue de coloniser la Palestine mandataire. Autrement dit, ni la lutte armée ni le combat politico-diplomatique n’ont réussi à réaliser l’autodétermination du peuple palestinien.
Israël et la Palestine doivent-ils former un, ou deux Etats ? Soulevé dès le début du XXe siècle, ce vieux débat revient au premier plan de l’actualité. Et pour cause : plus de six décennies après le plan de partage de la Palestine (1947), plus de quatre après l’occupation de la Cisjordanie et de Gaza (1967), et près de vingt ans après les accords d’Oslo (1993), Israël continue de coloniser la Palestine mandataire. Autrement dit, ni la lutte armée ni le combat politico-diplomatique n’ont réussi à réaliser l’autodétermination du peuple palestinien.
 L’Europe sous pression
L’Europe sous pression