Pacte pour l’euro, impact sur les salaires
Le Portugal va payer…
La crise politique portugaise s’est payée cash: hier soir, le premier ministre démissionnaire a dû se résoudre à appeler à l’aide la zone euro, son pays étant incapable de se financer à des taux supportables.
Jeudi 7 avril 2011
Voir aussi : Rubrique Portugal Crise de la dette crise politique
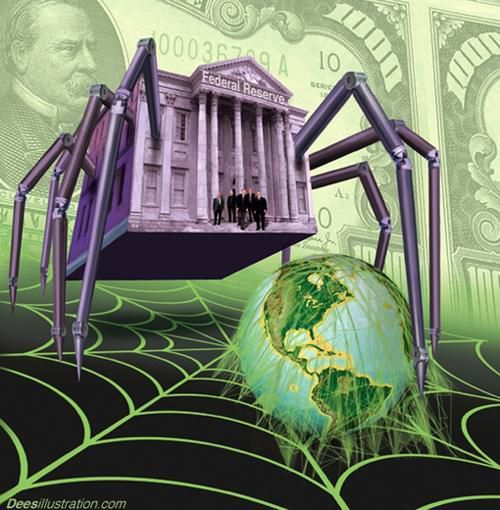
Attaque de l'Euro. Artimage
Extension du domaine de la régression
A la veille d’un Conseil européen consacré à la crise de la dette, le Parlement portugais rejetait, le 23 mars, un plan destiné à réduire le déficit en rognant sur les dépenses sociales. Inébranlables, les gouvernements de la zone euro continuent à prescrire la pilule amère de la rigueur.
Comme dans un rêve de Naomi Klein qui rattraperait les malfaçons de sa thèse initiale, le néolibéralisme européen met un soin particulier à se conformer à la « stratégie du choc » — mais d’un choc qu’il a lui-même largement contribué à produire.
On croyait déjà avoir vu du pays avec la « réponse » à la crise (financière privée) sous la forme de plans d’austérité (publique) sans précédent. Mais le prolongement du « pacte de compétitivité » nous emmène pour un autre voyage dont on ne voit même plus le terme. Jusqu’où le paradoxe de l’acharnement néolibéral en réponse à la crise néolibérale peut-il aller ?, c’est une question dont la profondeur devient insondable.
Dans cet invraisemblable enchaînement où un choc séculaire n’entraîne aucune révision doctrinale mais bien la réaffirmation étendue de ce qui a si parfaitement échoué, la case « réduction des déficits » a logiquement donné lieu à une de ces « déductions » bizarres conduisant de l’échec prévisible des politiques d’austérité à l’impérieuse nécessité de les constitutionnaliser.
En dépit du matraquage qui répète ad nauseam que la rigueur est une stratégie de retour à la croissance et quoiqu’il nous ait valu quelques épisodes savoureux comme la « rilance » de Mme Christine Lagarde, on voit mal comment les politiques économiques européennes — coordonnées pour la première fois, mais hélas pour le pire — pourraient ne pas produire l’exact contraire de ce qu’elles prétendent rechercher.
Car si des épisodes d’ajustement budgétaire, dans le passé, ont pu rencontrer quelque succès, c’était à la condition impérative d’être accompagnés d’une baisse de taux d’intérêt, d’une dévaluation ou d’un environnement en croissance, toutes choses dont on est d’ores et déjà bien certain qu’elles feront défaut. Reste la terrible synergie négative qui conjugue des efforts de restriction budgétaire d’une intensité inédite à une extension (l’Europe entière) jamais vue — et promet plutôt la « richute ».
Frédéric Lordon (Le Monde Diplo)
Frédéric Lordon économiste, auteur de La Crise de trop. Reconstruction d’un monde failli, éditions Fayard, 2009.
Voir aussi : Rubrique Finance Traders en fête, Barnier rassure les fonds spéculatifs, Les banquiers reprennent leurs mauvaises habitudes, Rubrique Crise , Le grand Krach automatique , entretien avec Frédéric Lordon, rubrique UE La spéculation attaque l’Europe par le Sud, l’UE répond aux marchés, Grèce Grève générale,
A qui appartient la dette des états européens ?
Pourquoi seuls certains pays de la zone euro sont-ils touchés par la crise de la dette souveraine ?
Existe-t-il un lien entre cette crise et le fait que la dette publique soit possédée par des investisseurs « non résidents » ? Il est en effet curieux que la Grèce, l’Espagne et le Portugal soient sous pression des marchés et absolument pas l’Italie, le Royaume-Uni, l’Irlande ou encore, hors Union européenne, les États-Unis ou le Japon.
Reprenons, à partir des chiffres de 2009 d’Eurostat (publiés le 5 mai) : si la dette grecque représente 115,1 % du PIB, ce qui peut expliquer la défiance des investisseurs, en revanche celles de l’Espagne et du Portugal, ne dépassent pas respectivement 53,2 % et 76,8 %. Soit, en dessous de la moyenne de la zone euro qui est pour l’instant de 78,7 %. Certes le poids des dettes publiques augmente, mais c’est le cas partout dans le monde.
Prenons maintenant le cas de l’Italie : sa dette est de 115,8 % du PIB, soit au même niveau que la Grèce. De même, l’Irlande (64 %) est plus endettée que l’Espagne (sans compter le Nama, structure de défaisance des actifs toxiques des banques irlandaises qui pèse plus d’un quart du PIB irlandais). La France, elle, se situe au niveau du Portugal avec 77,6 % du PIB. Hors UE, la dette américaine représente 80 % et celle du Japon… 200 % de son PIB.
Pourtant, seuls, dans le monde, trois pays du sud de l’Union sont sous la menace des marchés. Certes, dira-t-on, la Grèce est un cas particulier, ce pays ayant dissimulé deux fois l’ampleur de son déficit, brisant ainsi la confiance des marchés. Mais elle a des capacités de rebonds (marine marchande, services, économie souterraine, etc.). Quoi qu’il en soit, l’Espagne et même le Portugal ne sont absolument pas dans le même cas qu’Athènes et sont pourtant bousculés par les marchés. Et si on juge ces pays fragiles, c’est aussi le cas de l’Irlande, de l’Italie, du Royaume-Uni et bien sûr de la France.
C’est là que les choses deviennent intéressantes. Si l’on regarde la proportion de la dette souveraine (celle des États par opposition à la dette privée, celle des ménages) détenue par des « non-résidents » (c’est-à-dire des personnes physiques ou morales domiciliées hors du pays) on constate que ce sont les pays qui ont le plus diversifié leur dette sur les marchés internationaux qui sont les plus attaqués ou, à tout le moins, menacés. Ainsi, la dette grecque est possédée à 75 % par des non-résidents, la dette portugaise à 72 %, la dette espagnole, à 60 %. Il y a, pour l’instant, des exceptions : ainsi, la dette irlandaise est possédée par des non-résidents à hauteur de 86 % et la dette française à hauteur de 68 % et ces deux pays ne sont pas – encore ? — attaqués.
En revanche, on peut noter que la dette britannique n’est possédée par des non-résidents qu’à hauteur de 28 %, la dette allemande, à moins de 50 %, la dette italienne à moins de 55 %, la dette américaine à 50 % et la dette japonaise à moins de 5 %… Et là, curieusement, pas de mouvements, ou si peu. Pourquoi ? Car la dette reste d’abord sous contrôle étatique. Ainsi, « la dette italienne est massivement possédée par des banques italiennes qui, par l’intermédiaire de fondations, sont contrôlées par l’État. Elles font donc ce qu’on leur dit de faire d’où la tranquillité du gouvernement italien », m’expliquait récemment le patron italien d’une entreprise de télécommunications.
La France, il y a quinze ans, était dans le même cas. Mais les autorités publiques ont fait le choix délibéré de diversifier la dette et d’emprunter d’abord sur les marchés internationaux. Interloqué par ce choix, j’ai plusieurs fois interrogé des responsables français qui m’ont répondu avec une
arrogance pas croyable que 1/je n’y comprenais rien (ce qui est possible) et 2/une diversification montre la confiance du monde dans l’économie française. C’était avant la crise de la dette souveraine et ce choix apparaît aujourd’hui pour ce qu’il est : catastrophique puisqu’un pays qui a massivement externalisé sa dette renonce de facto à la contrôler. Si le gouvernement français peut faire pression sur BNP-Paribas, il n’a aucun levier sur Lehman Brothers, par exemple.
Ce n’est pas un hasard si, en avril 2006, le Danemark a fièrement annoncé avoir soldé sa dette extérieure. Sa dette – désormais uniquement possédée par des intérêts danois – n’était plus que de 30 % (41,6 % en 2009). Un choix malin, très malin qui montre que Copenhague a vu venir le coup et compris que l’indépendance a un prix.
Reste à savoir qui sont ces fameux « non-résidents ». Il n’est pas facile de le savoir, les obligations d’État changeant souvent de mains. Mais, selon des estimations fiables, cette dette est massivement possédée par des banques et des assurances de l’Union européenne et non par des banques d’investissement et des Hedge funds américains, japonais ou chinois… Autrement dit, ceux qui ont amplifié la crise de la dette souveraine grecque et déstabilisé la zone euro sont sans aucun doute des banques françaises ou allemandes, qui possèdent à elles seules un bon tiers de cette dette. Je ne dis pas qu’elles sont à l’origine de la crise, mais ce sont elles qui, en étant incapables de contrôler leurs nerfs, ont suivi comme des moutons ce qui ont déclenché la panique par intérêt bien compris.
Autant dire qu’il faut rapidement inverser la tendance afin que l’État emprunte d’abord en interne. Une méthode qui présente un autre avantage : elle permet une restructuration (rééchelonnement des remboursements ou annulation partielle) entre soi, sans vague. On pourrait aussi mettre en place, solution plus européenne, une « agence européenne de la dette » qui gérerait la plus grande partie des dettes nationales des pays de la zone euro et pourrait émettre des emprunts. Ainsi, la spéculation contre la dette souveraine de la zone euro deviendrait impossible. Mais, cette seconde solution, qui a ma préférence, n’est pas à l’ordre du jour. Pour l’instant.
Réflexions d’un militant (Sin)
Voir aussi : Rubrique Finance, Voir aussi : UE sous pression, L’europe répond au marché, crise de la zone euro mode d’emploi , rubrique Portugal, rubrique Grèce Plan d’austérité inefficace et dangereux, rubrique Livre Kerviel dénonce sa banque , Susan Georges de l’évaporation à la régulation, Aux éditions la Découverte La monnaie et ses mécanismes, Les taux de change, On line Comment l’injustice fiscale a creusé la dette greque,

