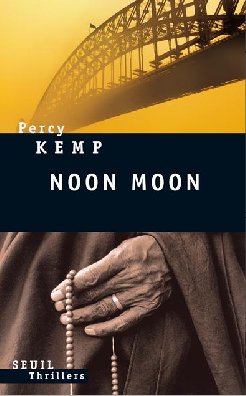Ce n’est pas tapi au fond d’une caverne des zones tribales que Ben Laden a été retrouvé, mais dans une demeure sécurisée d’un quartier peuplé de militaires à Abbottabad, à moins de 100 km d’Islamabad. De quelles complicités l’homme le plus recherché au monde a-t-il bénéficié ? Jean-Luc Racine, directeur de recherches au CNRS, au centre d’études de l’Inde et de l’Asie du Sud, analyse le rôle et les motivations du Pakistan dans l’attaque contre le leader d’Al Qaeda.
Lorsqu’il a été attaqué, Ben Laden se trouvait dans une maison protégée par une grande enceinte dans une ville qui abrite une base militaire de l’armée pakistanaise. Cela relance les suspicions sur les liens entre le Pakistan et Al Qaeda…

Le chercheur Jean-Luc Racine
La situation est très opaque. Nous sommes depuis des années dans un jeu d’ombres qui bien sûr posait problème aux autorités américaines. Celles-ci ont fait part récemment de leur « impatience stratégique » aux responsables de l’armée pakistanaise, avec qui les contacts sont très réguliers. On ne sait pas encore exactement ce qui s’est passé. Mais difficile de croire que Ben Laden ait pu vivre à quelque 60 kilomètres d’Islamabad sans que personne de l’Inter-services intelligence (ISI), – les services secrets pakistanais, qui dépendent de l’armée – n’en sache rien.
Comme toujours avec les services pakistanais, cet état de fait traduit des manœuvres très complexes, qui restent en partie sujettes à interprétation : d’un côté, Ben Laden échappe aux traques américaines pendant près de dix ans ; de l’autre, le Pakistan, sous Pervez Musharraf, au pouvoir de 1999 à 2008, a livré beaucoup de responsables importants d’Al Qaeda, dont Khalid Sheikh Mohammad, le « cerveau » du 11 Septembre. Il faut aussi rappeler qu’Al Qaeda a plusieurs fois condamné les responsables pakistanais comme traîtres à l’islam, tout cela dans un contexte où les talibans pakistanais, retournés contre le pouvoir d’Etat, ont mené dans le pays des vagues très meurtrières d’attentats terroristes depuis des années.
On peut imaginer que les services pakistanais aient en quelque sorte gardé en réserve la carte Ben Laden, non parce qu’ils soutiennent sa ligne, mais pour peser dans leurs relations compliquées avec les Etats-Unis. Le véritable enjeu pour eux étant la relation à l’Inde et à l’Afghanistan, un Afghanistan où ils entendent retrouver une influence amoindrie depuis le 11 Septembre et la chute des talibans afghans.
Pourquoi avoir alors permis aux Etats-Unis d’attaquer le lieu où se trouvait Ben Laden ?
Il paraît peu vraisemblable que les services secrets pakistanais n’aient pas été au courant de l’attaque commanditée par les Etats-Unis (d’autant que le commando est venu d’Afghanistan). A tout le moins, ils savaient que les Américains étaient sur la piste de Ben Laden. Et le président Obama s’est félicité, sans précision, de la coopération pakistanaise à cet égard. Bien sûr, vu le degré d’anti-américanisme au Pakistan, il est difficile pour le pouvoir, civil ou militaire, de s’afficher en première ligne dans cette affaire. Mais d’un autre côté, une partie de l’opinion va crier à la violation de la souveraineté nationale si les Américains y sont allés seuls.
Il est possible que le Pakistan ait décidé de livrer Ben Laden aux Américains, non seulement en raison des pressions accrues de Washington, mais aussi parce qu’une part décisive de la stratégie d’Obama en Afghanistan est de dissocier les talibans afghans, avec qui les négociations sont envisageables, d’Al Qaeda. Ce groupe terroriste étant bien la cible-clé d’Obama, comme il l’a encore récemment rappelé.
En affaiblissant Al Qaeda, le Pakistan gagne ainsi sur deux fronts : d’une part, il amoindrit une menace pesant sur la sécurité pakistanaise, de l’autre il renforce sa position sur le grand échiquier discret sur lequel se joue en coulisses le futur de l’Afghanistan, et donc le futur de l’influence pakistanaise en Afghanistan, à l’heure où l’on discute du calendrier de retrait des forces de l’Otan.
Or, pour Islamabad, la carte afghane est essentielle, afin d’éviter la prise en tenaille entre l’Inde et un Afghanistan où les Indiens seraient influents – et leur influence s’est accrue sous la présidence d’Hamid Karzai…
En 2008, David Petraeus, commandant des forces internationales en Afghanistan, avait déclaré pour la première fois qu’un lien étroit existait entre les talibans pakistanais, afghans et Al Qaeda. La même année, un nouveau responsable des services secrets pakistanais était nommé, Ahmad Shuja Pasha. Quelle a été l’influence de Washington sur cette nomination ?
Il semble bien que la nomination du général Pasha en 2008 s’inscrive dans les consultations qui ont eu lieu en 2007 avec Washington quand le général président Musharraf a dû abandonner ses responsabilités à la tête de l’armée, au bénéfice du général Kayani (lui même ancien directeur de l’ISI) et qui ont eu lieu de nouveau en 2008, après que Musharraf fut contraint par l’opinion d’abandonner la présidence de la République. Le général Nag, successeur de Ashfaq Pervez Kayani à la tête d’ISI, aura donc été en poste peu de temps, pour laisser la place à Ahmed Shuja Pasha. A chaque fois, Washington a, semble-t-il, été consulté discrètement, au nom de la coordination américano-pakistanaise dans la lutte contre le terrorisme.
On pose parfois par ailleurs la question de savoir si une part de l’armée est tentée par l’islamisme radical. Mais cette crainte, assez peu crédible, peut être aussi instrumentalisée par l’armée pour légitimer la difficulté qu’elle a à lutter contre l’extrémisme. Le vrai problème étant du reste plutôt celui posé par les talibans pakistanais, des enfants du pays, que par Al Qaeda proprement dit.
Est-ce-que la mort de Ben Laden peut modifier les relations entre le Pakistan et les Etats-Unis et si oui, dans quel sens ?
Pour l’opinion pakistanaise, il faudra en savoir plus sur les conditions de sa mort, et sur ce qu’il est advenu de son corps ensuite. En termes de relations bilatérales, il faut attendre de voir ce qui va suivre. La disparition de Ben Laden va-t-elle être suivie ou non par d’autres disparitions, son second Ayman al-Zawahiri par exemple ?
Si Al Qaeda – la maison mère, pas ses succursales au Sahel ou ailleurs – est réellement affaiblie, si le mouvement est décapité, les relations entre Islamabad et Washington peuvent s’améliorer de façon significative, d’autant que les Etats-Unis ont besoin du Pakistan pour négocier avec les talibans afghans.
Encore faut-il voir comment le pouvoir, civil et militaire, va gérer les conditions de l’intervention américaine contre Ben Laden vis-à-vis de l’opinion, au nom de la souveraineté nationale d’un pays de 180 millions d’habitants, nucléarisé de surcroît.
Recueilli par Marie Kostrz (Rue89)
Voir aussi : Rubrique Afghanistan, L’enlisement total, L’exemple russe pour la sortie, rubrique Pakistan, La frontière source de guerre, clef de la paix, rubrique Méditerranée, Al-Quaida totalement dépassée par la lame de fond arabe,