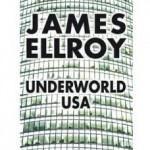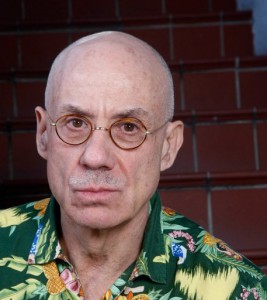Invité par l’association Regards sur le cinéma algérien, le réalisateur Ali Mouzaoui* évoque son dernier documentaire sur la vie et l’œuvre de l’écrivain Mouloud Feraoun*.
« Dans le film, l’identité kabyle de Feraoun est au cœur de votre propos ?
Comment pourrait-il en être autrement ? Feraoun est le fruit de cette culture et la culture n’est pas quelque chose que l’on garde pour soi. Il était viscéralement attaché à ce territoire qui a maintenu son fonctionnement malgré toutes les tentatives de soumission. Ce fut notamment le cas face à l’empire Ottoman. Feraoun a résisté à la colonisation française, mais il émettait aussi des critiques sur le journal officiel du FLN. Basée sur la tradition orale, la société kabyle est fondée sur un système d’organisation démocratique. Dans le clan, les décisions concernant le village étaient prises en commun, les femmes étaient concernées et respectées. Dans ce cadre, où la pauvreté peut être acceptée sans souffrance, la vie se déroulait paisiblement.
Vous soulignez l’ambiguïté de la politique de Jules Ferry qui introduit la langue française en Kabylie en envoyant des instituteurs dans les villages à partir de 1895…
Je ne m’oppose pas à la transmission du savoir. Ni a la langue française que je porte dans mon cœur. L’écrit a permis de sauvegarder notre tradition orale. Je mentionne qu’à l’époque le certificat d’étude n’était pas une escale sur le chemin du savoir mais une étape finale pour les Algériens. La France souhaitait mettre en place une école adaptée à un peuple de cultivateur. Un atout pour la transformation qui n’hypothéquerait pas la colonisation. Lors du recrutement dans les villages, chaque famille devait fournir un enfant à l’école française. Elle choisissait le plus chétif car cela venait soustraire un berger à la famille. Dans une société précaire, l’école était un élément de déstabilisation. Feraoun a bénéficié de l’école française. Il a beaucoup travaillé tout en restant dans le juste. Il avait une vision sur la société dans laquelle il vivait et en parlait avec un maximum de lucidité
A qui s’ adresse votre documentaire ?
Ma conception répond à une double dynamique. Donner une représentation de la culture kabyle et montrer la vie et le combat de Feraoun aux siens. Je ne fais pas référence à la torture, j’évite de montrer les morts, y compris pour évoquer son assassinat. J’ai d’abord voulu refléter le désespoir culturel et la ténacité de son combat. Il est de mon devoir d’être assez didactique. Le legs de Feraoun c’est un message humain et le sens de l’effort. Avec le temps, j’ai compris que je poursuivais la même mission avec bonheur.
Dans sa période algéroise, Feraoun a fréquenté Camus. Les deux auteurs avaient-ils des différents politiques ?
Après avoir lu La Peste, Feraoun envoie une lettre à Camus dans laquelle il lui reproche de situer son roman à Oran sans que l’on n’y croise une seule silhouette d’arabe. Dans sa réponse Camus lui répond en substance : Monsieur Feraoun, il est de votre devoir de le faire. Ce dont ne se privera pas Feraoun, même si on lui a reproché par la suite de n’écrire que sur la Kabylie. Je pense que l’on écrit pour les siens. Mais pour moi les deux auteurs font partie du même univers. Je revendique Camus comme un des miens. Sa mère était femme de ménage, et le père de Roblès, maçon. Si la société avait pu taire ses violences, on aurait pu aller vers une société merveilleuse de convivialité et de tolérance. »
Recueilli par Jean-Marie Dinh
 * Mouloud Feraoun est un écrivain kabyle algérien d’expression française né le 8 mars 1913 à Tizi Hibel en haute Kabylie. Élève de l’école normale de la Bouzareah (Alger), il enseigne durant plusieurs années comme instituteur, directeur d’école et de cours complémentaire, avant d’être nommé inspecteur des centres sociaux. Feraoun commence à écrire en 1934 son premier roman, Le fils du pauvre. L’ouvrage, salué par la critique obtient le Grand prix de la ville d’Alger. L’écrivain est abattu le 15 mars 1962 à Alger, à quatre jours seulement du cessez-le-feu, par un commando de l’OAS.
* Mouloud Feraoun est un écrivain kabyle algérien d’expression française né le 8 mars 1913 à Tizi Hibel en haute Kabylie. Élève de l’école normale de la Bouzareah (Alger), il enseigne durant plusieurs années comme instituteur, directeur d’école et de cours complémentaire, avant d’être nommé inspecteur des centres sociaux. Feraoun commence à écrire en 1934 son premier roman, Le fils du pauvre. L’ouvrage, salué par la critique obtient le Grand prix de la ville d’Alger. L’écrivain est abattu le 15 mars 1962 à Alger, à quatre jours seulement du cessez-le-feu, par un commando de l’OAS.
*Ali Mouzaoui, réalisateur algérien, est titulaire d’un diplôme de metteur en scène de films d’arts obtenu à l’Institut supérieur du cinéma de l’ex-URSS en 1980. De retour au bercail en 1987, il se consacre à son métier. Il a réalisé plusieurs films documentaires dont Dda L’Mouloud (film consacré à Mouloud Mammeri) et Le Bijou d’Ath Yenni. Il a aussi produit des films de fiction comme Début de saison, Les bandits d’honneur de Kabylie, Les Piments rouges, Portrait de paysagiste et Mimezrane. Le docu-fiction sur Mouloud Feraoun réalisé en 2009 est présenté dans la région en avant-première internationale dans le cadre de Regards sur le cinéma algérien. Ali Mouzaoui est aussi l’auteur de Thirga au bout du monde, son premier roman paru aux éditions l’Harmattan.
Voir aussi : rubrique cinéma autour du film de Bouchareb, livre Laurent Mauvignier Des hommes, Todorov la signature humaine, rubrique politique locale le musée de la France en Algérie,