Judith Cahen : Le Monde Diplomatique, novembre 2002
Quel sera l’objectif américain après l’Irak ? La question hante les dirigeants de Damas, qui craignent de faire les frais de la politique des Etats-Unis, des tensions nées entre le Liban et Israël sur les questions de l’eau et des risques d’embrasement à la frontière des deux pays. Cette instabilité de l’ordre régional a permis aux caciques du régime baasiste de mettre un terme au « printemps de Damas », qui avait suivi la mort du président Hafez El Assad et son remplacement par son fils, M. Bachar El Assad.

A la mort d’Hafez El Assad le 13 juin 2000, après trente années de pouvoir sans partage, la société civile, les opposants au régime, et même certains baasistes, ont cru à la démocratisation du système politique. La personnalité et la jeunesse de son fils Bachar, successeur désigné du qaïd, sa volonté de modernisation et de lutte contre la corruption ont suscité un grand espoir. Certes, nombre de gens furent choqués par la rapidité avec laquelle la succession fut bouclée (1) et refusèrent la manière dont le nouveau pouvoir insistait sur l’« exception syrienne » qui empêcherait le pays de pratiquer la démocratie des autres. Mais l’insistance du jeune président sur le respect de l’opinion publique accéléra le mouvement de contestation réclamant plus de démocratie et de respect pour le droit des personnes.
« Il faut redonner la parole au peuple. Que le Parlement ait à nouveau le pouvoir de contrôler l’Etat. Sans ce retour aux principes républicains, la Syrie restera ce qu’elle est aujourd’hui : un régime totalitaire, une République héréditaire. » Par cette déclaration de juin 2000, M. Riyad Turk, chef du Parti communiste – Bureau politique, libéré après plus de quinze ans de prison, s’affirme comme la figure emblématique du « printemps de Damas 2) ». Pendant un an, des pétitions – émanant de groupes aussi différents qu’un collectif de « 99 intellectuels », d’avocats, de Syriens de l’étranger ou des Frères musulmans basés à Londres – paraissent dans la presse arabe non syrienne pour réclamer la fin de l’état d’urgence – maintenu depuis l’arrivée du Baas au pouvoir en 1963 -, le retour à l’Etat de droit, le pluripartisme et la libération de tous les prisonniers politiques.
Parallèlement, des muntadayat (forums de discussions organisés en appartement) s’ouvrent à Damas et dans la plupart des grandes villes du pays, recueillant un large succès. Des personnalités politiques indépendantes, des universitaires, mais aussi nombre de citoyens commencent à y exprimer, en public et sous l’oeil attentif de membres du Baas, leurs critiques contre la corruption, l’accaparement du pouvoir par les dignitaires du régime et leurs enfants ou appellent au multipartisme, au respect du droit d’expression et à la libération des prisonniers politiques.
Puis, en septembre 2001, le régime, après avoir lancé un premier avertissement sur les lignes rouges à ne pas franchir (3), jette en prison dix militants pour la démocratie, dont M. Riyad Seif, député indépendant, et M. Turk. A la fin d’août 2002, tous les militants sont condamnés à des peines allant de deux à dix ans de prison pour avoir « porté atteinte à la Constitution, incité à la sédition armée et aux dissensions confessionnelles, sapé le sentiment patriotique et propagé de fausses nouvelles ».
Certains observateurs étrangers soutiennent que M. Seif a été emprisonné à la suite d’un rapport au Parlement dans lequel il dénonçait des irrégularités entourant la création de deux monopoles de téléphonie mobile, SyriaTel et Investcom, dont M. Rami Makhlouf, cousin de M. Bachar El Assad, est le principal actionnaire. En réalité, M. Seif n’avait même pas cité ce dernier, mais il avait attiré l’attention sur le fait que la Syrie était l’un des rares pays dans le monde où l’Etat n’avait rien gagné par la vente des licences de téléphonie mobile et où les opérateurs n’étaient même pas soumis à l’impôt sur les sociétés…
Pour Me Haïssam Maleh, président de l’Association des droits de l’homme en Syrie (ADHS), contre lequel un mandat d’arrêt a été émis récemment, « le pouvoir a voulu, avec ces arrestations, envoyer un message clair à la société civile. Il n’avait pourtant rien à craindre de ce mouvement – et d’ailleurs personne ne croit en Syrie que le régime sera renversé par la force. Mais la peur est double : il y a celle du peuple, et celle du régime, qui craint pour ses privilèges ».
Une presse sous contrôle
Les forces ayant porté le « printemps de Damas » avaient d’ailleurs des contours flous et manquaient singulièrement d’assise populaire. Y… regarde, sceptique, le marc de son café ; il a préféré une rencontre dans un lieu public, les appartements des opposants étant trop souvent surveillés. Après avoir passé de longues années en prison, cet ancien membre du Parti communiste de M. Turk porte un regard amer : « Les jeunes sont formatés par le Baas de la maternelle à l’université. La nouvelle génération ne pense au mieux qu’à faire de bonnes études, au pire qu’à s’enrichir par tous les moyens. En Syrie, on ne peut pas vraiment parler d’opposition, mais plutôt d' »attitude oppositionnelle » consistant à en appeler à la « glasnost » et à la modernisation. Ses différents courants sont comme des tribus qui se côtoient, mais ne proposent pas de projet fédérateur. Et elle a échoué à conquérir la jeunesse, peut-être parce qu’elle continue à utiliser un vocabulaire politique qui n’a pas changé depuis les années 1950-1960. »
Cette jeunesse urbaine ressemble à celle des grandes villes européennes : portables et street wear sont l’apanage des Damascènes, qui ont depuis peu investi la traditionnelle medina, désormais remplie de cafés Internet, de restaurants implantés dans d’anciens palais et de discothèques pleines à craquer le jeudi soir, veille du week-end musulman. Les copines sortent en groupe, les lycéennes enlacent leur petit copain dans les lieux publics, et on aperçoit çà et là des femmes voilées fumer en pleine rue.
Du côté du pouvoir, les choses sont retournées à la situation initiale, confie un diplomate : « Le style présidentiel n’a pas changé, même s’il y a moins de portraits du président dans les rues. Avant son accession au pouvoir, on voyait Bachar El Assad partout, en toute simplicité. Aujourd’hui, non seulement on ne le voit plus, mais il reste totalement opaque pour son peuple sur les questions internes : aucune interview aux médias syriens, pas de discours télévisés… »
D’ailleurs, l’ancien système politique n’a jamais disparu. Plus que jamais, il s’apparente à une joumloukia (4). Pour confirmer son intronisation, M. Bachar El Assad a dû réunir le Congrès du parti, qui ne s’était plus tenu depuis 1985. Le Baas, un moment tenté par le « printemps », s’est soudé autour des dignitaires, de peur de perdre ses privilèges de parti « guide » de la Syrie. Seule nouveauté, quelques proches du nouveau président (huit sur trente-six ministres) détiennent des postes importants du point de vue économique, mais pas du point de vue politique.
M. Assad fils a permis l’introduction d’une nouvelle loi sur la presse (inchangée depuis 1949), qui autorise la publication de nouveaux titres, mais reste très restrictive : les journaux mettant en cause l’« unité » ou la « sécurité » nationale peuvent être interdits, la publication de fausses nouvelles est punie de un à trois ans de prison et d’une amende pouvant aller jusqu’à 18 000 dollars. Pour cet universitaire damascène, « la nouvelle loi institutionnalise la censure. Les fils des caciques du régime, par leurs liens avec le pouvoir et leur poids économique, sont les seuls à en profiter ». De fait, les nouveaux titres sont tous dirigés soit par des formations politiques inféodées au Baas, soit par des amis ou familiers de Bachar, soit par des fils de dignitaires du régime. Cette nouvelle presse s’est même montrée bien plus dure vis-à-vis du dossier Seif et des autres prisonniers d’opinion que la presse officielle.
Sur la corruption, ce diplomate européen constate, non sans une pointe de cynisme, que « derrière chaque homme d’affaires il y a un général qui veille au grain. Ici, la corruption est endémique. Par exemple, chaque colonel a droit à une dotation de diesel. Qu’en fait-il ? Il la revend à bon prix aux chauffeurs de taxi… La plupart des puissants ne pensent qu’à se faire de l’argent ; peu leur importe que ce soit dans une économie socialiste ou capitaliste. Mais, lorsqu’ils auront compris qu’il y en a plus à se faire dans un système capitaliste, alors peut-être ils songeront à la démocratie ».
Dans un pays où le chômage frappe au moins 20 % de la population active, où les 15-35 ans représenteront dans deux ans un peu plus de 8 millions de personnes, soit près de la moitié de la population, et où le produit national brut par habitant se situe en deçà de 1 000 dollars (5), le gouvernement mise surtout sur le thème de la réforme économique pour faire oublier l’absence de démocratie. Mais de quelles réformes s’agit-il et à quelle vitesse se réalisent-elles ?
Ainsi, malgré la loi no 28 sur la création de banques privées, votée en 2001, l’ouverture du premier établissement privé, prévue pour 2002, a été reportée. Le Conseil suprême de la monnaie et du crédit, qui gérera la Banque centrale et les activités bancaires publiques et privées, n’est toujours pas créé, et il faudra encore que les banques candidates passent par deux étapes préliminaires, dont une seule prend trois mois. L’investissement privé, autorisé en 1991, ne décolle pas, et les étrangers, eux, n’en représentent qu’à peine 1 %. Comment, il est vrai, s’engager dans un pays dans lequel la justice semble si inféodée au régime, même dans le domaine des affaires (6) ? Réputé proche de M. Bachar El Assad, ancien membre du Parti communiste, M. Issam Al-Zaïm, ministre de l’industrie, a affirmé, le 11 juillet 2002, que les réformes économiques peuvent tout à fait avancer sans qu’on touche au domaine politique, le modèle à suivre étant celui de la Chine…
D’autre part, et malgré le contrôle qu’exerce sur lui la Syrie, le Liban est devenu, surtout depuis deux ans, un terrain de relative liberté d’expression pour l’opposition syrienne. Le quotidien libanais An-Nahar (interdit en Syrie) et surtout Al-Moulhaq, son supplément culturel, dirigé par l’écrivain et homme de théâtre Elias Khoury, ouvrent régulièrement leurs pages à l’opposition syrienne. Pour M. Khoury, « dès avant la mort d’Hafez El Assad, certains intellectuels s’exprimant au Liban avaient brisé les tabous sur la Syrie. Maintenant, leur marge d’expression est devenue une lutte qui peut s’épanouir, car elle fait partie intégrante de la lutte pour la démocratie libanaise ». Le 5 juillet 2002, un sit-in de la gauche libanaise et de quelques chrétiens de l’opposition avait lieu à Hamra, artère principale de Beyrouth, pour demander la libération de M. Turk.
Le contexte régional, avec l’Intifada palestinienne, l’élection de M. Ariel Sharon, puis les attentats du 11 septembre, a placé le pays du « mauvais côté de la barrière (7) ». Le regain de tension offre au régime un prétexte pour repousser l’ouverture démocratique. Mais l’affrontement régional permet aussi à l’opposition d’exprimer, indirectement, ses critiques.
Ainsi, à partir du siège de Jénine par l’armée israélienne, au printemps 2002, des sit-in ont été organisés pendant quarante-deux jours devant le siège de l’ONU à Damas, dans le quartier chic d’Abou Roumané, sans qu’aucun slogan ni affiche fasse référence à la politique officielle du régime. Le mouvement est allé jusqu’à rassembler 5 000 personnes. « Or, commente un intellectuel, le pouvoir ne pouvait ni interdire, car, pour le principe, les manifestations propalestiniennes sont bienvenues, ni laisser faire, puisque celles-ci n’étaient pas prises en main par le parti et risquaient de finir en critiques contre l’inaction du régime face aux frères de Palestine. Il a donc décidé de neutraliser les manifestants par d’autres moyens : en faisant venir par bus entiers des centaines de jeunes appartenant au Baas ainsi qu’aux moukhabarat (services de renseignement), et en noyant ainsi la manifestation dans cette foule. »
A Damas, la vieille garde a repris le dessus. Une amnistie des prisonniers syriens, que Patrick Seale, biographe de Hafez El Assad, appelle de ses voeux (8), serait non seulement moralement nécessaire, mais également utile pour l’image du pays. Or M. Bachar El Assad donne l’impression d’agir comme s’il avait, quoi qu’il arrive, trente ans de pouvoir devant lui. Et même si l’époque des arrestations massives est passée, la façon dont le fils gère la contestation tend à montrer qu’un des slogans du temps du père (Assad lil abad wa baad al abad : « Assad jusqu’à l’éternité et après l’éternité ») a pris le sens d’une sombre prophétie. Pourtant, comme l’a si bien dit le dramaturge syrien Saadallah Wannous, décédé en 1997, les Syriens « sont condamnés à l’espoir ».
notes
(1) Sur les modalités de la succession, voir l’article d’Alain Gresh, « L’ascension programmée du « docteur Bachar » en Syrie », Le Monde diplomatique, juillet 2000, ainsi que ceux de Sakina Boukhaima et de Philippe Droz-Vincent (« Bachar Al Assad : chronique d’une succession en Syrie » et « Syrie, la « nouvelle génération » au pouvoir : une année de présidence de Bachar Al Assad », dans Maghreb-Machrek, respectivement n° 169, juillet-septembre 2000 et n° 172, juillet-septembre 2001).
(2) Le Monde, 28 juin 2000. M. Riyad Turk adopta, dans les années 1970, des positions hostiles à l’URSS et au régime en place à Damas : il créa sur cette base le PC – Bureau politique, dont il fut secrétaire général. Il passa dix-sept ans et demi dans une cellule d’isolement et fut libéré en 1998 sans avoir été jugé. Depuis septembre 2001, il est à nouveau sous les verrous et a été condamné à deux ans et demi de détention.
(3) Le 8 février 2001, dans une interview à Asharq Al-Awsat, puis en mars lors de manoeuvres militaires, M. Bachar El Assad déclare que l’unité nationale, la politique de son père, l’armée et le parti sont des sujets qui ne peuvent être critiqués. De son côté, le vice-président syrien Abdel Halim Khaddam déclarait : « L’Etat ne permettra pas que la Syrie se transforme en une autre Algérie. »
(4) Néologisme formé par le début du mot arabe signifiant république et par la fin de celui signifiant royauté. Cf. « Menaces sur le printemps de Damas », Chronique d’Amnesty, Paris, mai 2002.
(5) Chiffres de la Banque mondiale, 2000.
(6) Un tribunal syrien a débouté le géant des télécommunications Orascom dans la bataille juridique qui l’opposait à son partenaire (pour 25 %), SyriaTel. L’opérateur égyptien accusait la compagnie syrienne de vouloir détenir l’exclusivité d’accès aux comptes bancaires, contrairement aux accords passés. C’est maintenant chose faite : les 40 millions de dollars d’avoirs d’Orascom sont gelés par la justice, qui a nommé M. Makhlouf directeur général de SyriaTel.
(7) Pour rectifier son image, la Syrie collabore, depuis octobre 2001, avec la CIA. Le 21 juin 2002, M. Vincent Cannistraro, ancien chef de la CIA pour la lutte antiterroriste, déclarait au Washington Post que la Syrie « coopère entièrement dans les enquêtes sur Al-Qaida et sur les personnes liées à l’organisation. Dans certains cas, la Syrie a même reporté l’arrestation de suspects afin de suivre leurs conversations et déplacements pour en référer aux Etats-Unis ».
(8) Al-Hayat, Londres, 21 juin 2002, numéro censuré en Syrie.
Voir aussi : Rubrique Syrie, rubrique Histoire, Le mandat français en Syrie et au Liban durant les années 30 , Histoire de la Syrie, Syrie: fiche pays,

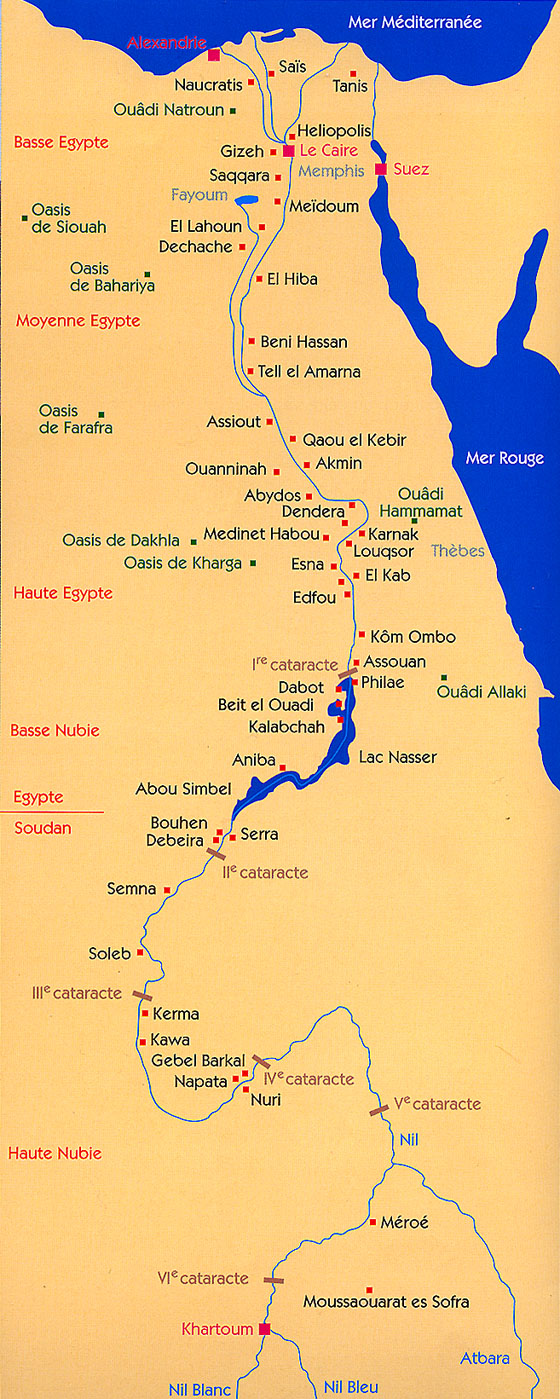 • 642 : les Arabes conquièrent l’Egypte.
• 642 : les Arabes conquièrent l’Egypte.

