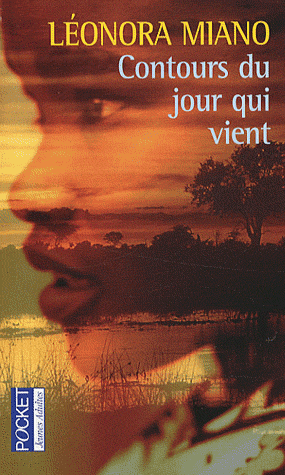Rencontre. Avec Tzetan Todorov à propos de la problématique de son essai : La littérature est-elle en péril ?
Rencontre. Avec Tzetan Todorov à propos de la problématique de son essai : La littérature est-elle en péril ?
Pas vraiment, parce que dans le milieu intellectuel des années 60, il y avait une libre circulation d’un milieu à l’autre. On pouvait s’enfermer, mais dans une servitude volontaire. Alors que dans le monde totalitaire, vous êtes contraint. Dans le privé, les gens révèlent une facette de leur être librement. Et quand ils se retrouvent dans la sphère publique, ils tiennent un discours convenu pour se soumettre aux prescriptions de l’idéologie. Quand on a vécu dans ces conditions, on comprend beaucoup de choses et on a un peu peur parce que l’on se rend compte que n’importe quelle population mise dans certaines conditions se comporterait de la même manière. On ne peut pas échapper à un pouvoir qui vous entoure de partout.
La servitude volontaire, n’est-ce pas pire ?
Cette servitude volontaire est d’une certaine manière pire parce qu’on l’accepte et elle vous contamine de l’intérieur. Alors que l’autre type de servitude est une pure contrainte. Mais le totalitarisme ne fonctionne pas comme ça. Tout le monde est à la fois maître et esclave, surveillant et surveillé et c’est cette pénétration de toute la société qui est vraiment le trait caractéristique et en même temps une révélation effrayante. Parce qu’être soumis, tout le monde peut le comprendre : on peut être vaincu par des forces plus grandes que la sienne. Mais être complice, on voudrait ne pas l’accepter.
Pourquoi écrire ce livre maintenant ?
Cela est lié à mon parcours individuel. Après mes études littéraires, j’ai éprouvé le besoin de me familiariser avec les disciplines des sciences humaines. Parce qu’il me semblait que la littérature n’est pas coupée du reste du monde. Je me suis engagé dans mes années de voyage intérieur à travers les sciences humaines. La littérature, je l’avais laissée un peu de côté et puis il y a quelques années, j’ai eu le sentiment que ce parcours était terminé. Et j’ai voulu faire le point sur ce qui avait été ma profession.
Votre propos donne à penser que l’on étudie plus la méthode que le sens des œuvres littéraires…
J’ai acquis cette connaissance concrète au sein du Conseil national des programmes. Pendant quelques temps, on s’est dit que les études littéraires pouvaient être améliorées en introduisant des concepts et des méthodes plus rigoureuses que celles qui avaient cours. Ce projet remonte aux années 60. J’y ai moi-même participé. Mais une fois introduit dans l’enseignement scolaire, cela s’est transformé en une étude des seules méthodes au détriment des textes. Ce qui devait être un instrument est devenu l’objet de l’étude même. Les fleurs du mal ou Mme Bovary deviennent des exemples illustrant les figures de rhétoriques ou les procédés narratifs au lieu que cette connaissance puisse nous servir à mieux comprendre le sens, la beauté, les idées, la pensée de ces œuvres.
Vous précisez que cela ne relève pas de la responsabilité des profs que peuvent-ils faire ?
Ils peuvent influencer leur encadrement. Moi je m’attaque plus à l’encadrement qu’aux professeurs. Pour dire la vérité, ils font les choses comme cela leur convient. Il y a une grande variété dans les classes. Mais cette variété n’est pas illimitée. Parce que vous avez des programmes nationaux qui deviennent contraignants comme au moment du Bac. Et puis il y a les inspecteurs qui viennent et qui notent. Donc on ne peut pas faire les choses à sa guise, mais ils peuvent élever la voix à travers leurs associations et leurs syndicats. Il faut revenir à une attitude beaucoup plus simple qui correspond à l’expérience des lecteurs communs. Qui lisent pour le plaisir, pour une meilleure compréhension de ce qui les entoure et d’eux-mêmes.
Il est plus facile de contrôler la méthode d’analyse que la nature de l’œuvre ?
Oui, on pourrait faire des QCM en cochant les bonnes réponses. Mais c’est une dérive à laquelle il faut absolument résister. Il faut que l’on sache comprendre, parler, s’exprimer et cela c’est plus difficile à noter. Il y a une défection massive dans cette filière. Aujourd’hui, on ne prend le Bac L que parce qu’on n’est plus capable de faire des maths. Et c’est absurde parce que la filière littéraire devrait être celle qui nous apprend le plus sur la société humaine. Et toutes les professions ont à faire aux comportements humains. Il faut partir du postulat que la littérature c’est du plaisir.
recueilli par Jean-Marie Dinh
La littérature est-elle en péril ? éditions Flammarion
Voir aussi : Rubrique Débat : Identité nationale Refuser ce débat –