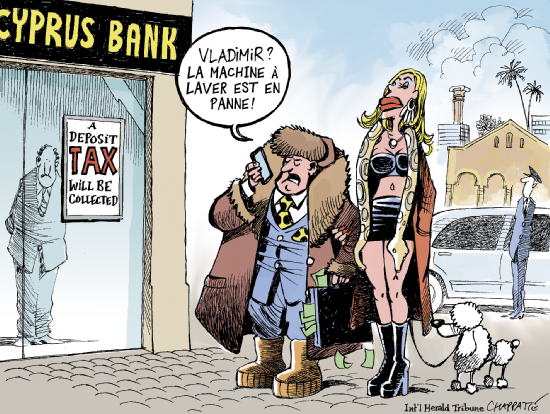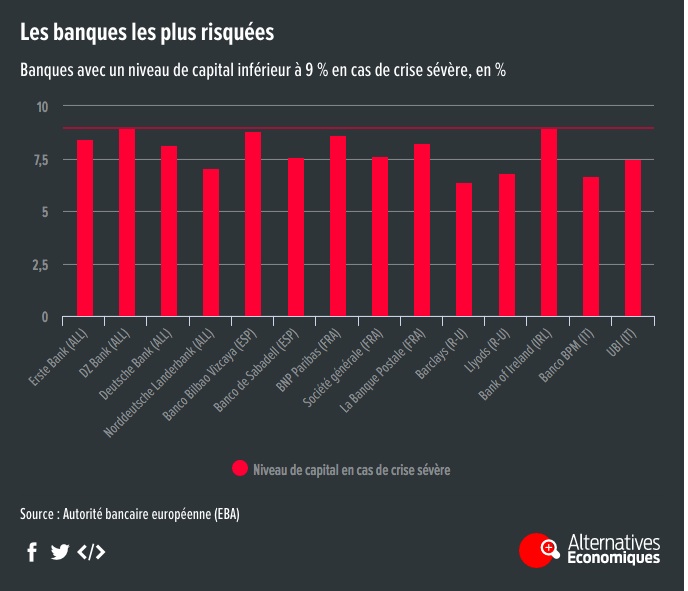A Paris, le 1er décembre. Photo Alain Jocard. AFP
Pour le philosophe Frédéric Gros, les élites sont sidérées par le caractère hétéroclite et inédit de la mobilisation des gilets jaunes. Selon lui, il faut admettre l’existence d’un certain registre de violence.
Dans son dernier livre, Désobéir (Albin Michel, 2017), il cherchait les raisons de notre passivité face à un monde toujours plus inégalitaire. Aujourd’hui, une partie de la population s’insurge et Frédéric Gros, philosophe et professeur à Sciences-Po, analyse l’expression inédite de la colère des gilets jaunes.
Salariés ou retraités, les gilets jaunes font parfois preuve de violence dans leurs propos ou dans leurs gestes. Comment l’expliquez-vous ?
Déjà, il y a la part de violences émanant d’une minorité de casseurs ou de groupuscules venant pour «en découdre». Elle est incontestable, mais il faut comprendre à quel point, en même temps, elle suscite un effroi émotionnel et un soulagement intellectuel. On demeure en terrain connu. Le vrai problème, c’est qu’elle est minoritaire. Elle est l’écume sombre d’une vague de colère transversale, immense et populaire. On ne cesse d’entendre de la part des «responsables» politiques le même discours : «La colère est légitime, nous l’entendons ; mais rien ne peut justifier la violence.» On voudrait une colère, mais polie, bien élevée, qui remette une liste des doléances, en remerciant bien bas que le monde politique veuille bien prendre le temps de la consulter. On voudrait une colère détachée de son expression. Il faut admettre l’existence d’un certain registre de violences qui ne procède plus d’un choix ni d’un calcul, auquel il est impossible même d’appliquer le critère légitime vs. illégitime parce qu’il est l’expression pure d’une exaspération. Cette révolte-là est celle du «trop, c’est trop», du ras-le-bol. Tout gouvernement a la violence qu’il mérite.
Ce qui semble violent, n’est-ce pas aussi le fait que ce mouvement ne suive pas les formes de contestations habituelles ?
Le caractère hétéroclite, disparate de la mobilisation produit un malaise : il rend impossible la stigmatisation d’un groupe et le confort d’un discours manichéen. Il a produit une sidération de la part des «élites» intellectuelles ou politiques. Non seulement elles n’y comprennent rien mais, surtout, elles se trouvent contestées dans leur capacité de représentation, dans la certitude confortable de leur légitimité. Leur seule porte de sortie, au lieu d’interroger leur responsabilité, consiste pour le moment à diaboliser ce mouvement, à dénoncer son crypto-fascisme. Cela leur permet de prendre la posture de défenseur de la démocratie en péril, de rempart contre la barbarie et de s’héroïser une nouvelle fois.
Cette forme de désobéissance, cette violente remise en cause des corps intermédiaires et de la démocratie représentative constituent-elles un danger ?
Les risques sont grands et ce spontanéisme représente un réel danger social et politique. Mais on ne va quand même pas rendre responsables de la crise de la représentation démocratique les perdants de politiques orientées toutes dans le même sens depuis trente ans. Nous payons la destruction systématique du commun durant ces «Trente Calamiteuses» : violence des plans sociaux, absence d’avenir pour les nouvelles générations, poursuite folle d’une «modernisation» qui s’est traduite par le déclassement des classes moyennes. La seule chose dont on puisse être malheureusement certain, c’est du fait que les victimes des débordements ou des retours de bâton seront les plus fragiles.
Vous avez travaillé sur la notion de sécurité (1), que pensez-vous de la réponse de l’Etat après les manifestations et les dégradations ?
De la part, cette fois, des forces de l’ordre, on entend le même discours : «Cette violence est totalement inédite, on n’avait jamais vu ça, un tel déferlement, une telle brutalité.» Il ne faudrait pas que cette mise en avant de la «nouveauté» ne serve d’écran à une augmentation de la répression.
Dans votre récent livre, Désobéir, vous analysiez les racines de notre «passivité». Que s’est-il passé pour que les gilets jaunes sortent du «confort» du conformisme ?
Notre obéissance politique se nourrit pour l’essentiel de la conviction de l’inutilité d’une révolte : «à quoi bon ?» Et puis vient le moment, imprévisible, incalculable, de la taxe «de trop», de la mesure inacceptable. Ces moments de sursaut sont trop profondément historiques pour pouvoir être prévisibles. Ce sont des moments de renversement des peurs. S’y inventent de nouvelles solidarités, s’y expérimentent des joies politiques dont on avait perdu le goût et la découverte qu’on peut désobéir ensemble. C’est une promesse fragile qui peut se retourner en son contraire. Mais on ne fait pas la leçon à celui qui, avec son corps, avec son temps, avec ses cris, proclame qu’une autre politique est possible.
Sommes-nous dans un grand moment de désobéissance collective ?
Oui, une désobéissance qui a comme repère sûr sa propre exaspération. On a tout fait depuis trente ans pour dépolitiser les masses, pour acheter les corps intermédiaires, pour décourager la réflexion critique, et on s’étonne aujourd’hui d’avoir un mouvement sans direction politique nette et qui refuse tout leadership. Cette désobéissance témoigne profondément de notre époque. Il faut en priorité en interroger les acteurs.
(1) Le Principe sécurité, Gallimard, 2012.
Source : Libération 06/12/2018