 Poésie. J-Luc Caizergues, machiniste à Montpellier, signe Mon suicide.
Poésie. J-Luc Caizergues, machiniste à Montpellier, signe Mon suicide.
C’est une vocation tardive que se découvre Jean-Luc Caizergues pour la poésie fiction. En 2004, son admiration pour Houellebecq finit par le convaincre que cette œuvre est dépassable, parce que son vide contemporain à lui outrepasse de loin celui de l’auteur de Plateforme. Il publie « La plus grande civilisation de tous les temps », peut être parce que son catalogue d’abjections est plus pauvre. La condition de tâcheron lui renvoie des images viciées qui ne sont pas celles de la petite bourgeoisie. Qu’a t-elle de plus, la condition humaine d’un ouvrier d’aujourd’hui… C’est dans le moins qu’il faut chercher.
Rien de politique pourtant, juste un fond brumeux où il faut évoluer chaque jour sans la moindre estime pour soi-même, un environnement à l’image de la démocratie abstraite. « Les machinistes ont pour mission d’installer des décors sur la scène au nom de la culture. »
Alors que faire ? Se jeter du pont pour rejoindre le fleuve de la poésie contemporaine et faire entendre la voix de tous ceux… De tous ceux dont la vie se ponctue d’échecs successifs. Exprimer cette mort-là, cette mort simple, pourrait être en rapport avec le titre de son second recueil, Mon suicide. Toujours dans la collection poésie dirigée par Yves di Manno, qui a ouvert une ligne de front chez Flammarion.
L’absence de lyrisme fait penser à Régis Jauffret dans Microfictions. Dans Suicide, on touche le cruel avec une précision chirurgicale, mais l’écriture de Caizergues se distingue par des tonalités qui annoncent de nouvelles perturbations. Il y a des miracles qui arrivent chaque jour sans que l’on s’en aperçoive : « Jauffret a du talent, affirme Jean-Luc Caizergues, c’est facile pour les gens qui ont du talent. Il peut écrire des milliers de textes, pas un machiniste dans la glaise comme moi qui est publié à perte. »
Miracle : « Je suis transporté aux urgences /où un médecin de garde m’examine et conclut / vous n’avez rien. »
Guéri : « Je me rhabille / pendant que deux infirmiers / roulent dans un drap / blanc le cadavre du médecin. »
L’expression simple rend la parole presque inaccessible. On trouve à la fin du recueil, un court texte en prose qui retentit comme un coup de fusil.
Jean-marie Dinh
Jean-Luc Caizergues Mon suicide, Flammarion, 20 euros
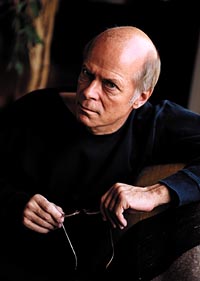 On ne naît pas impunément dans une famille de grammairiens. Mais que l’on se rassure, voir et entendre Pascal Quignard est une chose toute différente que de le lire. L’occasion nous en était donnée cette semaine à l’auditorium du Musée Fabre où le lettré était l’invité de la librairie Sauramps. Avant d’évoquer son dernier livre, Boutès, avec Nathalie Castagné, l’auteur en a lu le premier chapitre. Pris par l’expédition des Argonautes pour retrouver la toison d’or, le héros, Boutès, rencontre les sirènes. Mais à l’inverse d’Ulysse, qui reste attaché à son mât, Boutès plonge dans la mer. Ce geste, à première vue insensé, ne l’est certainement pas, suggère l’écrivain dont le cheminement vise à y trouver un sens. C’est autour de ce saut, « l’élan de Boutès vers l’animalité intérieure » que tourne son livre.
On ne naît pas impunément dans une famille de grammairiens. Mais que l’on se rassure, voir et entendre Pascal Quignard est une chose toute différente que de le lire. L’occasion nous en était donnée cette semaine à l’auditorium du Musée Fabre où le lettré était l’invité de la librairie Sauramps. Avant d’évoquer son dernier livre, Boutès, avec Nathalie Castagné, l’auteur en a lu le premier chapitre. Pris par l’expédition des Argonautes pour retrouver la toison d’or, le héros, Boutès, rencontre les sirènes. Mais à l’inverse d’Ulysse, qui reste attaché à son mât, Boutès plonge dans la mer. Ce geste, à première vue insensé, ne l’est certainement pas, suggère l’écrivain dont le cheminement vise à y trouver un sens. C’est autour de ce saut, « l’élan de Boutès vers l’animalité intérieure » que tourne son livre.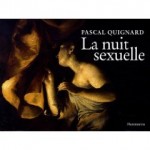
 Un livre d’actualité pour s’y retrouver, un peu, dans la grande course à l’échalotte qui anime le parti politique qui naguère structurait le débat politique français. Avec Le petit socialiste illustré, Jean-Michel Normand spécialiste du PS au Monde, dépeint le paysage baroque où les grandes joutes idéologiques ont laissé place à la médiacratie, et les programmes de société aux petites phrases assassines et glamour. Malgré ses ressources inestimables, pourrait-on croire, le PS n’a pas remporté une seule élection présidentielle depuis vingt ans. Ce livre illustré par l’exemple aide à comprendre pourquoi. Il propose de découvrir le PS sous un angle inédit : celui de son folklore, de ses manies qui font tristement sens. Du patois militant, aux tics de langage des leaders, sans oublier les tartes à la crème qui émaillent leurs discours, le livre de Normand dévoile, non sans humour, les travers d’une galaxie surréaliste souvent située aux antipodes de l’intérêt général. On tourne les pages en s’efforçant de rire, mais l’exercice est difficile. Dans la langue du crue, les pathétiques imbroglios de la tektonik du PS local ou le mariage de la carpe et du lapin pourraient se traduire ainsi. Pour se remettre en selle sous la pression du Big Boss (Frêche) qui en pince pour Stausski (DSK), la belle Hélène (Mandroux) qui avait hier rallié la motion de Bébert roi du monde (Delanoë), soutient aujourd’hui celle de La dame aux caméras (Royal). Le congrès PS en question doit être celui de sa « rénovation ». L’affaire est devenue sacrément urgente. Le pire résidant sans doute dans la propention hégémonique que le parti socialiste s’efforce sans cesse de déployer sur l’ensemble de la gauche.
Un livre d’actualité pour s’y retrouver, un peu, dans la grande course à l’échalotte qui anime le parti politique qui naguère structurait le débat politique français. Avec Le petit socialiste illustré, Jean-Michel Normand spécialiste du PS au Monde, dépeint le paysage baroque où les grandes joutes idéologiques ont laissé place à la médiacratie, et les programmes de société aux petites phrases assassines et glamour. Malgré ses ressources inestimables, pourrait-on croire, le PS n’a pas remporté une seule élection présidentielle depuis vingt ans. Ce livre illustré par l’exemple aide à comprendre pourquoi. Il propose de découvrir le PS sous un angle inédit : celui de son folklore, de ses manies qui font tristement sens. Du patois militant, aux tics de langage des leaders, sans oublier les tartes à la crème qui émaillent leurs discours, le livre de Normand dévoile, non sans humour, les travers d’une galaxie surréaliste souvent située aux antipodes de l’intérêt général. On tourne les pages en s’efforçant de rire, mais l’exercice est difficile. Dans la langue du crue, les pathétiques imbroglios de la tektonik du PS local ou le mariage de la carpe et du lapin pourraient se traduire ainsi. Pour se remettre en selle sous la pression du Big Boss (Frêche) qui en pince pour Stausski (DSK), la belle Hélène (Mandroux) qui avait hier rallié la motion de Bébert roi du monde (Delanoë), soutient aujourd’hui celle de La dame aux caméras (Royal). Le congrès PS en question doit être celui de sa « rénovation ». L’affaire est devenue sacrément urgente. Le pire résidant sans doute dans la propention hégémonique que le parti socialiste s’efforce sans cesse de déployer sur l’ensemble de la gauche.