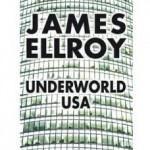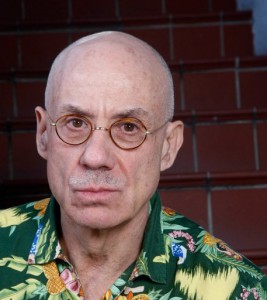Tant décriés aujourd’hui, les Soviétiques ont pourtant réussi en Afghanistan ce que la coalition occidentale cherche à faire sous le nom d' »afghanisation », c’est-à-dire partir sans débandade en laissant derrière soi un gouvernement et une armée alliés, qui ont tenu plus de trois ans… jusqu’à la disparition de l’ Union soviétique.
« Le dernier soldat soviétique à franchir le «pont de l’Amitié» sur l’Amou-Daria, ce 15 février 1989, s’appelait Boris Gromov. Il était alors un jeune général de 45 ans, à la tête de la 40e armée soviétique. Deux décennies plus tard, Gromov est gouverneur de la région de Moscou. Belle carrière. Le pont, d’une longueur de 800 mètres et construit en poutrelles métalliques, est toujours là. Il sépare désormais l’Ouzbékistan de l’Afghanistan. Les Russes ont quitté ce pays, mais la paix n’y est pas revenue. Pourtant, leur retrait – réussi – pourrait servir d’exemple aux Occidentaux quelque peu empêtrés en Afghanistan. Alors que se tient jeudi à Londres une grande conférence internationale sur l’avenir du pays, l’expérience soviétique devrait paradoxalement inciter à l’optimisme. Oui, la stratégie de transfert de responsabilités aux autorités et à l’armée afghanes – connue sous le nom d’«afghanisation» – peut marcher. La preuve ? Les Soviétiques y sont parvenus dans un contexte beaucoup plus difficile. L’Amérique d’Obama devrait au moins réussir à faire aussi bien. L’expérience soviétique montre en effet qu’il est possible de trouver une porte de sortie en laissant derrière soi un régime suffisamment stable et présentable pour partir sans honte. Que ce régime soit viable à long terme est une autre histoire…
Le problème, c’est qu’on l’avait oublié. Dans l’imaginaire collectif, hérité des dernières années de la guerre froide, l’armée soviétique a été chassée militairement d’Afghanistan par les moudjahidin soutenus par l’Occident. La réalité est un plus nuancée que cela. Lorsque les Soviétiques quittent volontairement le pays au début de l’année 1989, ils laissent derrière eux un régime prosoviétique qui se maintiendra au pouvoir plus de trois ans. Et s’il disparaît, au printemps 1992, c’est parce que son principal soutien, l’Union soviétique, a entre-temps disparu…
Retour sur ce moment de la longue histoire de la guerre civile afghane qui entrera, en avril prochain, dans sa trente-deuxième année. Mikhaïl Gorbatchev arrive au pouvoir en mars 1985. L’Armée rouge est en Afghanistan depuis plus de cinq ans : elle y est entrée au lendemain de Noël 1979 pour sauver un régime communiste menacé par le soulèvement populaire. Comme le montrent les archives du Politburo du Parti communiste d’Union soviétique, désormais accessibles, cette opération militaire était loin de faire l’unanimité au sein de la direction soviétique. En 1985, l’enlisement militaire et politique est là. Dès l’été 1986, Gorbatchev prend la décision de se retirer d’Afghanistan, mais il veut le faire dans des conditions politiques acceptables. La guerre coûte cher, de l’ordre de 50 milliards de dollars par an, elle mobilise des dizaines de milliers d’hommes, les pertes s’accumulent et la population grogne devant les «cercueils de zinc» qui rentrent au pays. Il y aura, au total, 15 000 morts en neuf ans dont une majorité par maladie, les conditions sanitaires étant épouvantables. Gorbatchev doit trouver une porte de sortie.
Première étape : Moscou débarque le dirigeant afghan Babrak Karmal, installé au pouvoir fin 1979 après que les spetsnaz (forces spéciales) du KGB eurent assassiné son prédécesseur communiste Hafizullah Amin. Karmal, lui, a la vie sauve mais il doit céder le pouvoir au docteur Najibullah, le chef des services secrets, lui-même membre du KGB depuis les années 60. Agé de 39 ans, marié à une femme de la famille royale, ce Pachtoune est surnommé «le taureau». Sa réputation souffre des méthodes expéditives et cruelles des policiers du Khad. Il va néanmoins conduire avec un certain succès une politique d’ouverture et de réconciliation nationale. C’est la méthode Gorbatchev transposée en Afghanistan. Alors que le régime s’était fait détester de la population par ses attaques contre la religion, Mohammed Najibullah tend la main à l’islam : une nouvelle Constitution, adoptée en 1987, est placée sous les auspices du «Dieu clément et miséricordieux». Le commerce est libéralisé et Najibullah joue à fond la carte des fidélités tribales et locales avec une politique clientéliste traditionnelle.
Deuxième temps : la diplomatie. Des négociations s’engagent à Genève entre l’Afghanistan, le Pakistan, l’Union soviétique et les Etats-Unis. Elles aboutissent à un accord signé le 14 avril 1988. La résistance n’est pas partie prenante de ces pourparlers, qu’elle dénonce, mais le retrait soviétique se fait donc dans un cadre de légalité internationale. Gorbatchev ne se fait pas prier : dès le mois de mai, les troupes de Moscou quittent Kandahar et Jalalabad. En août, la moitié des effectifs (130 000 hommes au total) est déjà partie.
Pour les militaires soviétiques, la situation sur le terrain s’était terriblement dégradée les deux dernières années, lorsque les Etats-Unis ont autorisé le transfert de missiles antiaériens portables Stinger et Blowpipe aux moudjahidin. En quelques semaines, les Soviétiques perdent la maîtrise du ciel. On estime que 250 avions et hélicoptères ont été abattus en trois ans… Leur défaite militaire est toutefois relative, car ils gardent le contrôle des grandes villes et des principaux axes de communication. Sans lésiner sur les moyens pour l’obtenir, avec l’usage de l’artillerie lourde contre les villages ou la pose de dizaines de milliers de mines antipersonnel.
Le 15 février 1989, le général Gromov quitte l’Afghanistan, mettant fin à plus de neuf ans de présence militaire sur le terrain. A Moscou, c’est le soulagement ; en Occident, on crie victoire. Sur le terrain, la réalité est plus contrastée. La résistance, divisée entre de nombreux groupes rivaux et parfois hostiles, perd ce qui l’unissait : la présence de l’ennemi soviétique dans le pays. La guerre oppose désormais des Afghans à d’autres Afghans. Le Pakistan reste un acteur important et pousse ses alliés, les islamistes du Hezbi-i-Islami de Gulbudin Hekmatyar – les mêmes qui affrontent aujourd’hui les soldats français dans le district de Kapissa – à passer à l’action pour renverser le régime postcommuniste.
L’assaut est donné contre la ville de Jalalabad. Au bout de quelques semaines de combat, c’est un échec militaire pour les islamistes. Les troupes fidèles au régime de Kaboul ne se sont pas débandées, bien au contraire. En partie à cause d’actes de sauvagerie commis par des djihadistes arabes, comme le raconte l’historien afghan Assem Akram (1). Une soixantaine de militaires avaient été faits prisonniers et ils furent «exécutés, coupés en morceaux, emballés dans des caisses de fruits et envoyés à la garnison de Jalalabad avec ce message : voilà ce qui attend les mécréants !» Les «mécréants», fidèles au régime de Najibullah, continuèrent le combat. D’autant qu’ils avaient les moyens de le faire. L’Union soviétique versait environ 8 millions de dollars d’aide militaire par jour. Surtout, elle avait laissé derrière elle d’importants stocks d’armes et une armée à peu près formée. L’armée afghane utilisa massivement des missiles sol-sol Scud, les même que ceux de Saddam Hussein. Les experts militaires estiment que 1 700 de ces engins furent tirés par les Afghans – ce qui fait d’eux les premiers utilisateurs au monde.
Parallèlement, le docteur Najibullah parvint à débaucher d’anciens résistants, achetant des chefs de guerre et des seigneurs locaux. «Le régime ne s’effondre pas et les moudjahidin s’avèrent incapables de gagner», constate Gilles Dorronsoro (2), l’un des meilleurs spécialistes français de ce pays. «La résistance afghane, ayant gagné sa guerre, ratait sa paix», ajoute l’Américain Michaël Barry (3). Le début de la fin commence en août 1991, lorsqu’une tentative de putsch à Moscou fragilise définitivement Gorbatchev. En décembre, l’Union soviétique disparaît et Eltsine entre au Kremlin. L’Afghanistan est le cadet de ses soucis. Ce n’est pas le cas des Pakistanais, qui détestent le docteur Najibullah et son régime postcommuniste installé à leurs portes.
A Kaboul, la décomposition du pouvoir s’accélère, faute du soutien politique et financier de Moscou. Rachid Dostom, chef de guerre ouzbek dont la milice personnelle formait la 53e division de l’armée afghane, rallie les opposants, dont le commandant Massoud. Le régime aura tenu trois ans et deux mois après le départ de ses protecteurs. Le 16 avril 1992, Najibullah démissionne alors que les milices entrent dans la capitale, où elles vont s’affronter durant des mois à l’arme lourde. Refusant de fuir en Inde, Najibullah se réfugie le 17 avril dans un bâtiment des Nations unies. Il y restera enfermé plus de quatre ans, jusqu’en septembre 1996. A cette date, les talibans entrent victorieux dans Kaboul. Ils n’ont que faire de l’immunité diplomatique des Nations unies et capturent l’ancien président de la République. Il est sauvagement assassiné, castré et son cadavre pendu à un lampadaire. La guerre civile afghane continuait sous une autre forme. Elle se poursuit toujours.
Jean-Dominique Merchet
(1) Histoire de la guerre d’Afghanistan (Balland, 1996). (2) La Révolution afghane (Karthala, 2000). (3) Le Royaume de l’insolence (Flammarion, 2002).
Voir aussi « Mourir pour l’Afghanistan » de Jean-Dominique Merchet aux Editions Jacob-Duvernet, 2008. Le blog de l’auteur