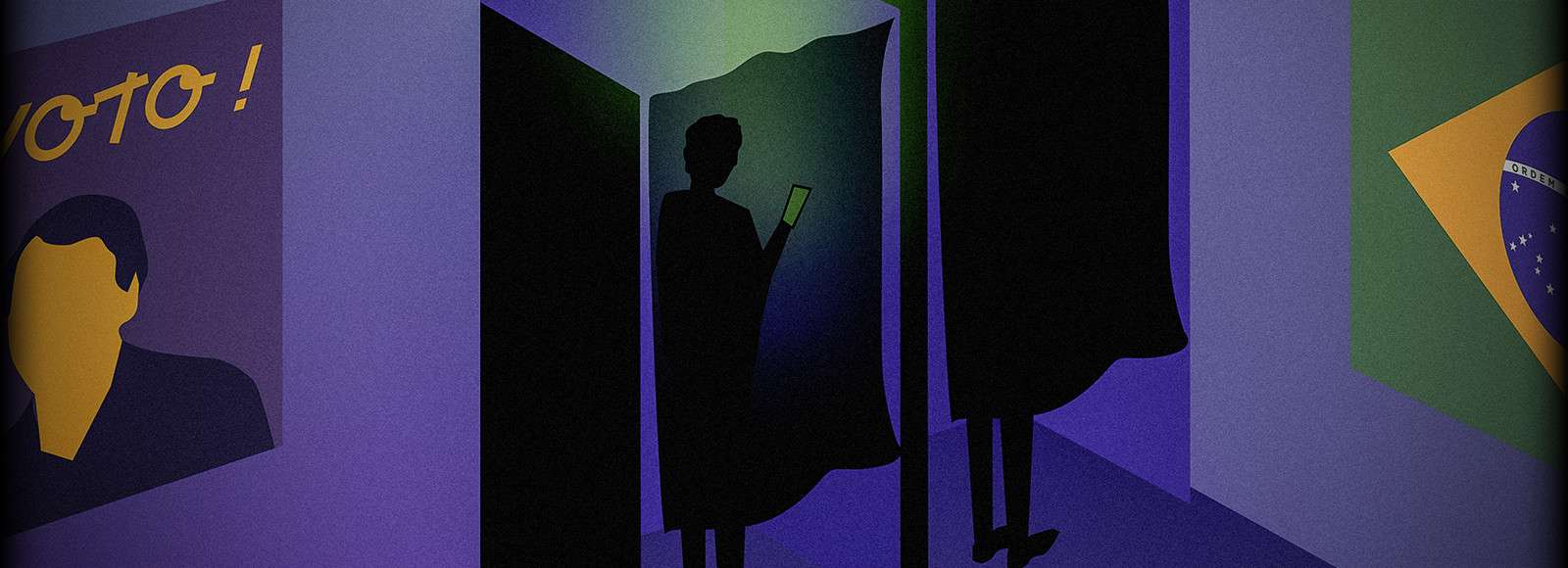 Le scrutin présidentiel brésilien est un exemple inédit de propagation de « fake news » et de propagande politique sur l’application de messagerie appartenant à Facebook.
Le scrutin présidentiel brésilien est un exemple inédit de propagation de « fake news » et de propagande politique sur l’application de messagerie appartenant à Facebook.
S’il fallait une preuve finale que la désinformation et la propagande politique peuvent se propager à travers l’application WhatsApp, les élections présidentielles brésiliennes en ont offert un exemple inquiétant. Le second tour du scrutin est prévu dimanche 28 octobre et oppose Fernando Haddad (Parti des travailleurs – PT, à gauche) et Jair Bolsonaro (Parti social libéral – PSL, extrême droite).
Depuis des semaines, le rôle et l’influence de WhatsApp font partie des thématiques de campagne, alors que des millions de messages à teneur politique circulent dans les poches des électeurs à travers cette messagerie appartenant à Facebook depuis 2014.
« Des centaines de millions de messages »
Au point où, le 18 octobre, la gauche brésilienne a demandé l’ouverture d’une enquête auprès du Tribunal supérieur électoral brésilien. Le Parti des travailleurs et ses alliés suspectent leurs adversaires politiques d’avoir orchestré une campagne de désinformation à l’encontre de Fernando Haddad et du PT, à travers des messages envoyés sur WhatsApp.
Une multitude de groupes
En quelques années, WhatsApp a largement dépassé son cadre initial de « messagerie privée » et est devenue une solution de communication publique majeure. Cela s’est traduit par une utilisation intensive de l’application à des fins de communication politique lors de l’élection présidentielle. Bien sûr, elle n’a pas remplacé les autres réseaux sociaux : le candidat d’extrême droite, Jair Bolsonaro, a bien construit une bonne partie de sa communication sur Facebook, YouTube, Instagram et Twitter, où il cumule près de 17 millions d’abonnés.
Cette demande a eu lieu au lendemain des révélations du quotidien Folha de S. Paulo, selon lesquelles quatre services spécialisés dans l’envoi de messages en masse sur WhatsApp (Quick Mobile, Yacows, Croc Services, SMS Market) ont signé des contrats de plusieurs millions de dollars avec des entreprises soutenant la campagne de Jair Bolsonaro. Ces services spécialisés sont capables d’envoyer « des centaines de millions de messages » par WhatsApp, indique le quotidien. La diffusion de tels messages est de nature à être épinglé par la loi brésilienne. « Le financement de campagne électorale par des entreprises privées est illégal. Il est question de fraude », a réagi un membre du PT.
Un autre usage illégal de WhatsApp proviendrait du fait qu’un parti politique ne peut, au Brésil, envoyer des messages qu’aux personnes recensées dans ses bases de données de sympathisants. Or, les entreprises spécialisées citées par le Folha de S. Paulo proposaient également des forfaits d’envois de messages à des listes d’utilisateurs WhatsApp qu’elles fournissaient elles-mêmes, et dont l’origine reste incertaine. Le quotidien évoque des listes de numéros obtenues « illégalement à travers des compagnies téléphoniques, ou de recouvrement de dettes ».
En réaction aux révélations du Folha de S. Paulo, WhatsApp a fermé « 100 000 comptes utilisateurs » associés aux quatre entreprises concernées, et leur a demandé de ne plus envoyer de messages en masse de la sorte.
Une application qui a remplacé les e-mails
Autant de chiffres donne le tournis. Du point de vue des utilisateurs français, un tel usage de WhatsApp à des fins de propagande électorale massive peut surprendre, alors qu’ils sont plus souvent habitués aux conversations privées, aux groupes rassemblant des collègues ou des membres de leur famille.
L’utilisation de WhatsApp est bien différente au Brésil, tant la messagerie y est populaire. En mai 2017, il s’agissait du deuxième pays le plus utilisateur de WhatsApp au monde, derrière l’Inde : 120 millions de personnes avaient alors un compte actif, sur 210 millions de Brésiliens.
« L’application est utilisée par tous les secteurs de la société. Elle a complètement remplacé les e-mails », commente Claire Wardle, directrice exécutive chez First Draft. Ces derniers mois, cette association internationale de journalistes et de chercheurs a travaillé au Brésil dans le cadre du projet collaboratif Comprova, qui collecte et dément les fausses informations qui circulent sur WhatsApp.
En 2016, une étude du Harvard Business Review indiquait que 96 % des Brésiliens ayant un smartphone utilisaient WhatsApp en priorité pour envoyer des messages. Dans un pays où les SMS coûtaient très chers, le succès de l’application, légère, rapide, et fonctionnant sur tous les modèles de smartphones, a tenu à la possibilité de s’envoyer des messages par un réseau Wi-Fi ou 3G.
Mais cela s’explique aussi par une politique agressive de la part de Facebook pour s’imposer dans les smartphones au Brésil, selon Yasodara Cordova, chercheuse en désinformation numérique à l’université d’Harvard, qui a écrit sur le sujet dans The Intercept. « 60 % des Brésiliens utilisent des forfaits prépayés, avec des limitations, mais dans lequel ils ont un accès gratuit permanent à WhatsApp et à Facebook grâce aux accords passés entre Facebook et des sociétés téléphoniques », explique-t-elle au Monde.
Sur WhatsApp, en revanche, une diffusion « verticale » de l’information depuis un compte amiral comme sur Facebook ou YouTube est impossible. Le fonctionnement de l’application n’autorise que des conversations de groupes de 256 personnes maximum : il empêche le développement de fils de discussion géants, et alimentés par des administrateurs WhatsApp qui disposeraient d’audiences considérables.
Résultat : la circulation de l’information sur WhatsApp est extrêmement fragmentée au travers des multitudes de groupes. « Les équipes de campagne ont été très fortes pour créer de multiples groupes de 256 utilisateurs, qui diffusent du contenu identique », explique Mme Wardle. La viralité d’un message ou d’une vidéo a lieu ensuite grâce au transfert de messages de groupes en groupes, que chaque utilisateur peut faire en un coup de pouce.
« La taille moyenne d’un groupe WhatsApp au Brésil est de six personnes, continue Claire Wardle. En ce qui concerne les fausses informations que nous repérons, elles circulent dans tout type de groupes. Elles peuvent partir d’un grand groupe, puis se transmettent de groupes de plus en plus petits, par l’action de chaque utilisateur, avec des transferts de messages. Elles atterrissent finalement dans des groupes WhatsApp vraiment petits, mais où les gens se font vraiment confiance. »
Un fonctionnement qui rappelle le principe de transfert de messages par e-mail, appliqué à l’écosystème de WhatsApp. Selon El Pais, qui reprend l’article de chercheurs ayant étudié pendant des mois le phénomène de viralité dans quatre-vingt-dix groupes, les techniques pour diffuser au maximum des messages sont bien rodées : des militants organisent le partage de messages, ou ciblent des régions précises du pays en étudiant les préfixes téléphoniques.
L’Agence France-Presse donne l’exemple d’un partisan de Jair Bolsonaro qui disait recevoir environ 500 messages WhatsApp par jour, pour et contre les deux candidats du second tour. « Cela ne fait pas de différence pour moi, a-t-il expliqué. Mais ma mère a reçu un message disant que Bolsonaro supprimerait le treizième mois et elle l’a cru. »
Le phénomène est global, et a concerné tous les camps politiques brésiliens pendant la campagne, quels que soient les candidats. Dans un reportage diffusé par la BBC en septembre, une journaliste ayant étudié des « milliers de groupes WhatsApp » montre aussi l’exemple d’une rumeur mensongère sur l’état de santé du candidat d’extrême droite Bolsonaro.
Des rumeurs visuelles
« Le jour du premier tour, nous avons aussi vu sur WhatsApp des fausses informations sur le processus de vote, des gens qui expliquaient par exemple que les machines de vote étaient cassées, etc. Soit le même genre de fausses informations qu’on a vu circuler aux Etats-Unis en 2016 », explique Claire Wardle, de First Draft.
En tout, depuis le mois de juin, la cinquantaine de journalistes réunis dans le projet Comprova a recensé plus de 60 000 messages signalés directement par des utilisateurs de WhatsApp, auxquels les journalistes ont répondu, tant bien que mal. Dans le New York Times, les responsables de Comprova disent aussi avoir recensé « 100 000 images à caractère politique » dans 347 groupes WhatsApp les plus populaires qu’ils ont pu intégrer grâce à des liens d’invitation.
Parmi les cinquante images les plus virales au sein de ces groupes, 56 % d’entre elles sont de fausses informations ou présentent des faits trompeurs, selon eux. « Les fausses informations sur WhatsApp sont plus visuelles qu’ailleurs : il y a beaucoup de mèmes, qui appuient sur des réactions émotionnelles autour de sujets comme l’immigration, les crimes, ou les croyances religieuses, pour créer des tensions », confirme Mme Wardle.
Ceci alors que l’utilisation de WhatsApp se fait principalement sur un écran de téléphone, et que le contexte accompagnant la photo et la vidéo, de même que son origine, sont rarement présents. Application conçue avant tout pour smartphone, WhatsApp favorise la diffusion de messages vidéo enregistrés en mode selfie, où l’on écoute une personne parler, sans avoir de titre de la vidéo, d’informations sur son origine, son nombre de vues, ou même l’identité de l’interlocuteur.
Rumeur sur l’« idéologie de genre »
Parmi les nombreuses rumeurs recensées par Claire Gatinois, correspondante du Monde au Brésil, celle du « kit gay » que Fernando Haddad, le candidat du PT, voudrait généraliser dans les écoles pour enseigner l’homosexualité au primaire. Une fausse intention, comme l’explique El Pais, mais régulièrement diffusée par les soutiens de Jair Bolsonaro.
Un utilisateur de WhatsApp au Brésil a pu ainsi recevoir, au gré des partages de groupes en groupes, un tract électoral dénonçant l’« idéologie de genre » dans les écoles, avec la photographie du candidat Haddad. Comme si on lui donnait ce tract dans la rue sans davantage d’explications.
Pour des informations supplémentaires ou du contexte, il devra se rendre sur un navigateur Internet et chercher lui-même ce qu’il en est. Ce que ne favorise pas WhatsApp. « L’application n’a pas été conçue au départ pour diffuser de l’information avec une telle ampleur. C’est avant tout une messagerie privée », abonde la chercheuse d’Harvard, Yasodara Cordova.
Elle explique que « la présentation d’une fausse information sur WhatsApp est souvent différente » d’autres plates-formes, citant une rumeur de bourrage d’urnes électroniques démentie par les fact-checkeurs de Comprova. Alors que le post Facebook dénonçant la supposée tricherie est accompagné de vidéos, la version WhatsApp de la rumeur ne fait, elle, que reprendre le texte annonçant « des urnes déjà achetées pour l’élection de 2018 ».
Des messages impossibles à identifier et réguler
Face à ce phénomène, la réponse de Facebook et WhatsApp est pour le moins timorée. Si Facebook mène la guerre aux infox sur son réseau social depuis l’élection présidentielle américaine de 2016 (notamment en participant au financement de projets de « fact-checking » comme Comprova), il ne peut appliquer ses mesures habituelles de tentatives d’endiguement sur WhatsApp.
La raison avant tout technique. L’une des fonctionnalités clés de WhatsApp est son chiffrement de bout en bout, qui empêche WhatsApp, ou n’importe quel service tiers connecté à l’application, de lire ou de rechercher le contenu des messages échangés par l’application, groupes inclus. Ce chiffrement robuste fait de WhatsApp l’une des applications grand public les plus respectueuses des communications privée des utilisateurs. Mais il rend aussi impossible toute régulation, observation centralisée ou modération des phénomènes problématiques. Ce que Mark Zuckerberg lui-même a reconnu être un problème « difficile ».
Il est impossible, par exemple, d’entraîner un logiciel d’intelligence artificielle à détecter automatiquement des messages problématiques ou violant les règles d’utilisation de la plate-forme, comme ce qui existe sur Facebook. Concernant les fausses informations, les mesures prises par Facebook depuis 2016 (signalement par les utilisateurs, modération et contexte plus clair des publicités politiques, liens fournis par des fact-checkeurs capables de repérer une fausse information) ne pourront s’appliquer à WhatsApp. De même que les lois promulguées par des Etats pour contrer la désinformation en période électorale.
Les travers du chiffrement
Le chiffrement rend également impossible de retrouver l’origine ou les auteurs d’une fausse information. « WhatsApp a un système de détection de spams, qui détecte des comportements inhabituels. Mais ils devraient faire plus : par exemple, limiter le nombre de groupes qu’un seul numéro WhatsApp peut créer, ou limiter le nombre de fois où un message peut être transféré », avance Claire Wardle, qui travaille avec le projet Comprova.
Les responsables de Comprova vont plus loin. Dans une tribune publiée dans le New York Times, ils demandent à WhatsApp de « changer ses réglages » en termes de transfert de messages ou de nombre de personnes présentes dans des groupes de discussion. Ce à quoi WhatsApp a répondu qu’il n’était pas possible d’appliquer ces changements avant la fin de l’élection.
L’une des seules mises à jour récente de l’application a été introduite en juillet, avec la généralisation d’un système marquant comme « transféré » les messages envoyés provenant d’une autre discussion. La fonctionnalité avait été testée auparavant au Brésil et en Inde, un autre pays dans lesquels la propagation de rumeurs et de fausses informations a des effets parfois gravissimes. Début 2018, sur WhatsApp, une vingtaine de personnes ont été lynchées en Inde à la suite de rumeurs sur des enlèvements.
Source : Le Monde 25/10/2018



