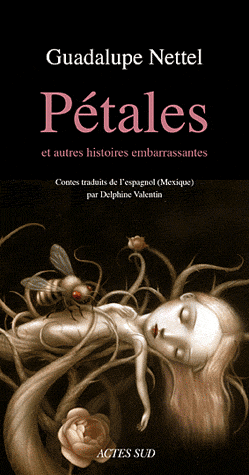Le nouveau roman de l’écrivain péruvien Mario Vargas Llosa, lauréat du prix Nobel de littérature 2010 , sort opportunément en librairie dans les pays de langue espagnole le 3 novembre. Son titre : El Sueño del Celta (Le Rêve du Celte). Son héros : Roger Casement, un personnage (réel) exceptionnel. Consul britannique en Afrique, il fut le premier à dénoncer, dès 1908, les atrocités du colonialisme d’extermination (dix millions de morts) pratiqué au Congo par Léopold II, le roi belge qui avait fait de cet immense pays et de ses populations sa propriété personnelle… Dans un autre rapport, Casement révéla l’abominable détresse des Indiens de l’Amazonie péruvienne. Pionnier de la défense des droits humains, Casement, né près de Dublin, s’engagea par la suite dans les rangs des indépendantistes irlandais. En pleine Grande Guerre, partant du principe que « les difficultés de l’Angleterre sont une chance pour l’Irlande », il rechercha l’alliance de l’Allemagne pour lutter contre les Britanniques. Il fut inculpé pour haute trahison. Les autorités l’accusèrent aussi de « pratiques homosexuelles » sur la base d’un prétendu journal intime dont l’authenticité est contestée. Il fut pendu le 3 août 1916.
Le roman n’étant pas encore disponible, on ignore comment Vargas Llosa en a construit l’architecture. Mais nous pouvons lui faire confiance. Nul autre romancier de langue espagnole ne possède comme lui l’art de captiver le lecteur, de le ferrer dès les premières lignes et de le plonger dans des trames haletantes où les intrigues se succèdent, pleines de passions, d’humour, de cruauté et d’érotisme. Ce roman a déjà un mérite : tirer de l’oubli Casement, « l’un des premiers Européens à avoir eu une idée très claire de la nature du colonialisme et de ses abominations ». Idée que l’écrivain péruvien (pourtant hostile aux mouvements indigénistes en Amérique latine) partage : « Nulle barbarie n’est comparable au colonialisme, tranche-t-il dans le débat sur les prétendus “bienfaits” de la colonisation. (…)
Igniacio Ramonet Le Monde Diplomatique