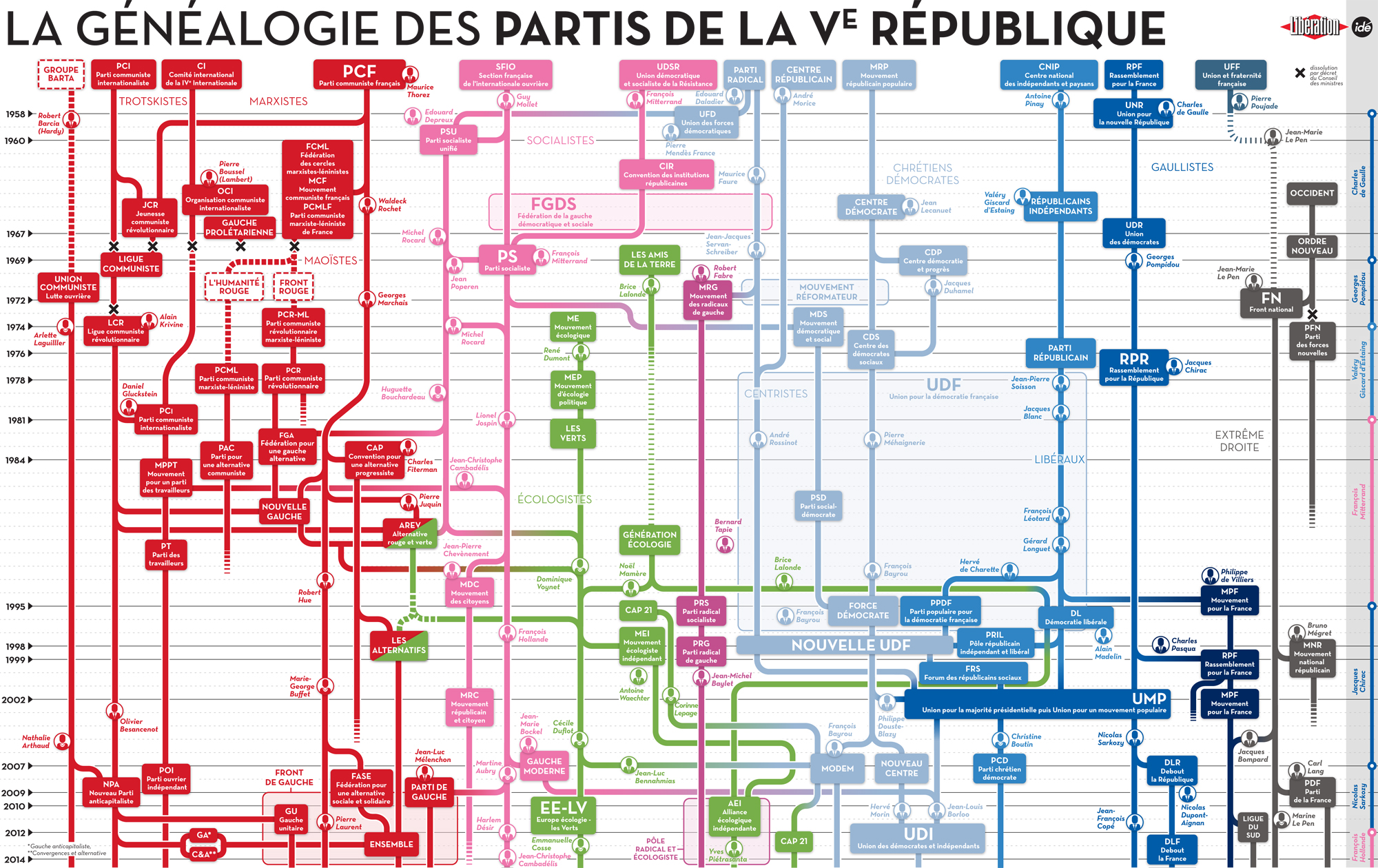A quoi servent les formations politiques ?
Plus d’un siècle s’est écoulé depuis la publication de l’essai classique de Robert Michels, « Les Partis politiques ». Mais la question qu’il soulevait conserve son actualité : nos sociétés démocratiques seraient-elles condamnées à la domination des élus sur les électeurs ?
Dès le début de son essai Les Partis politiques (1), Robert Michels écarte à la fois l’hypothèse d’un gouvernement direct du peuple et tout projet reposant sur les capacités de mobilisation spontanée des masses. Dans les pays modernes, le peuple participe à la vie publique par le biais d’institutions représentatives. Et la classe ouvrière, si elle veut défendre ses intérêts, doit s’organiser par le biais de partis et de syndicats. Paradoxe : bien que l’organisation constitue une nécessité, elle divise néanmoins « tout parti ou tout syndicat professionnel en une minorité dirigeante et une majorité dirigée ». En d’autres termes, « qui dit organisation dit tendance à l’oligarchie ». Tel est le problème qui constitue le fil conducteur de l’ouvrage et dont l’auteur tente de comprendre tant les causes que les conséquences.
L’analyse proposée a pour particularité d’être directement nourrie par l’expérience et les observations de Michels. Né à Cologne en 1876 dans un milieu favorisé, il s’est très tôt engagé au sein du puissant Parti social-démocrate allemand, le SPD, avant de mener une carrière d’écrivain politique et d’universitaire en Suisse, puis en Italie. Jeune intellectuel cosmopolite, il a fréquenté les milieux socialistes de Belgique et de France, et cette connaissance du mouvement ouvrier européen imprègne tout son propos.
Le regard se veut sans jugement moral ni pathos : Michels n’ignore pas que le fonctionnement quasi militaire des organisations ouvrières résulte de la nécessité impérieuse de constituer des structures de combat à même d’affronter la répression féroce de la bourgeoisie. Toutefois, observe-t-il, lorsqu’elles se développent et s’insèrent davantage dans la société, à l’exemple du SPD, leurs méthodes autoritaires ne disparaissent pas.
L’explication première avancée par l’auteur renvoie à la spécialisation des tâches induite par la division du travail : plus l’organisation s’étend, plus son administration s’avère complexe, et moins le contrôle démocratique est à même de s’exercer véritablement. Le travail de mobilisation politique, et partant le fonctionnement quotidien, requiert un personnel dévoué à l’exercice des activités administratives ou de direction. Inévitablement, ce personnel manifeste des connaissances spécifiques (en droit ou en économie, par exemple) et un savoir-faire (concevoir des discours, rédiger des textes…) que tout un chacun ne possède pas spontanément. D’où le rôle essentiel joué par les intellectuels au sein des mouvements ouvriers : « Seul le socialiste d’origine bourgeoise possède ce qui manque encore totalement au prolétariat : le temps et les moyens de faire son éducation politique, la liberté physique de se transporter d’un endroit à un autre et l’indépendance matérielle sans laquelle l’exercice d’une action politique au sens vrai et propre du mot est inconcevable. »
Michels teinte son analyse de considérations psychologiques sur le besoin des masses d’être guidées par des chefs ou sur la propension des représentants à considérer leur mandat comme une charge à vie. Mais le substrat de son analyse relève d’abord de la sociologie. Les conceptions et les goûts politiques des individus sont déterminés par leurs origines sociales et leurs conditions de vie. Le journaliste, même dévoué au prolétariat, n’a pas la même expérience du monde que l’ouvrier métallurgiste.
Certes, le prolétariat a besoin de transfuges de la bourgeoisie ; mais il a tout autant besoin de former et de promouvoir à la direction des partis qui le représentent des éléments issus de la classe ouvrière (lire « Comment un appareil s’éloigne de sa base »). Même d’extraction populaire, cependant, les cadres des partis peuvent s’éloigner du monde du travail et des préoccupations de la base des adhérents. Lorsqu’il décrit une bureaucratie encline à adopter un mode de vie petit-bourgeois et à défendre des positions trop timorées à son goût, Michels songe directement au SPD.
Pour ces bureaucrates qui doivent tout à l’organisation, le parti cesse d’être un moyen pour devenir une fin en soi. Toute la stratégie se trouve alors soumise à la conquête de trophées électoraux et de postes de pouvoir au sein des institutions établies. La critique de Michels est sans ambages : « A mesure qu’augmente son besoin de tranquillité, ses griffes révolutionnaires s’atrophient, il devient un parti bravement conservateur qui continue (l’effet survivant à la cause) à se servir de sa terminologie révolutionnaire, mais qui dans la pratique ne remplit pas d’autre fonction que celle d’un parti d’opposition. » D’un côté, les chefs en appellent chaque jour à la révolution ; de l’autre, leur tactique politique orchestre routine et compromis.
A la fin de l’ouvrage, Michels généralise son propos et le teinte d’une note plus pessimiste. Influencé par des auteurs conservateurs comme Gaetano Mosca (2), il énonce une « loi d’airain de l’oligarchie » rendant inévitable la domination des élus sur les électeurs, des délégués sur les mandants, de l’élite sur la masse. « Le gouvernement, ou si l’on préfère l’Etat, ne saurait être autre chose que l’organisation d’une minorité » qui impose au reste de la société un ordre correspondant à ses intérêts. Tandis que les groupes dirigeants s’affrontent entre eux pour l’exercice de l’autorité, les classes populaires demeurent spectatrices de cet affrontement, appelées seulement à trancher épisodiquement, par les urnes ou par la rue, cette lutte pour l’accession au pouvoir.
Une telle vision, qui paraît condamner tout projet émancipateur, se prête aisément à des lectures conservatrices. L’économiste américain Albert Hirschman cite d’ailleurs l’ouvrage pour décrire le versant réactionnaire d’une rhétorique affirmant la vacuité de toute action visant à changer le monde — ce qu’il appelle l’« effet d’inanité (3) ». D’autres n’ont pas manqué de remarquer que Michels, décédé en 1936, proposait une analyse quasi prophétique du fonctionnement des partis communistes et des démocraties populaires constituées dans le giron de l’Union soviétique. L’homme peut aussi aisément être perçu comme un simple déçu de la démocratie parlementaire — en 1924, Michels adhéra au régime fasciste de Benito Mussolini.
Cependant, à l’époque de la rédaction de l’ouvrage — avant la première guerre mondiale —, il est encore proche du syndicalisme révolutionnaire, qui entend remédier à l’attentisme des partis politiques et revitaliser le socialisme plutôt que le condamner. Cette sensibilité critique anime sa réflexion.
Michels précise clairement qu’il serait erroné de conclure qu’il faudrait renoncer à limiter les tendances autoritaires des organisations. S’il a écrit son essai avec « l’intention de démolir quelques-unes des faciles et superficielles illusions démocratiques », c’est pour mieux aborder cette question de front. Contrairement, selon lui, aux dirigeants des partis ou des syndicats ouvriers qui traitent l’autoritarisme bureaucratique à la manière d’un « léger atavisme » dont ils prétendent pouvoir se débarrasser une fois parvenus au pouvoir.
S’il n’existe pas de solution toute faite à ce problème, l’histoire du mouvement ouvrier est riche des combats menés pour impliquer les classes populaires et contester la centralisation de l’autorité politique. Michels croit ainsi à l’éducation politique, qui permet de « fortifier chez l’individu l’aptitude intellectuelle à la critique et au contrôle ».
Antoine Schwartz
(1) Robert Michels, Zur Soziologie des Parteiwesens in der modernen Demokratie. Untersuchungen über die oligarchischen Tendenzen des Gruppenlebens, éd. Werner Klinkhardt, Leipzig, 1911. Traduction française : Les Partis politiques. Essai sur les tendances oligarchiques des démocraties, Flammarion, Paris, 1914.
(2) Politiste italien (1858-1941), considéré comme le « père » de la théorie élitiste selon laquelle le pouvoir est toujours exercé par une minorité organisée (y compris au sein des démocraties).